|
TABLE DES MATIÈRES
Au Parlement
• Les
projets de loi à l'étude à la Chambre des
communes
• Les
amendements au serment de citoyenneté ne
contiennent
ni vérité ni réconciliation
- Steve Rutchinski -
• Le
projet de loi C-10 élimine le principe de
propriété et de contrôle canadiens dans le
système de radiodiffusion
- Anna Di Carlo -
• Promouvoir
la cybersécurité au nom
du «développement économique»
- Pierre Soublière -
Les injustices contre les peuples autochtones se
poursuivent
• Les
communautés autochtones ont un droit humain à
l'eau potable
- Philip Fernandez -
Opposition à une définition sioniste de
l'antisémitisme
• La définition sioniste de
l'antisémitisme ne doit pas passer!
- Diane Johnston -
• Des voix juives et des
universitaires juifs s'opposent
à l'adoption de la définition sioniste
Solidarité avec Cuba
• Le
Réseau canadien de solidarité enverra une
importante cargaison d'équipement médical à Cuba
• Caravane de voiture «Les
ponts d'amour» contre le blocus de Cuba
Solidarité internationale avec le peuple haïtien
• Les Montréalais expriment
leur appui au peuple haïtien
- Correspondant du LML -
• Mobilisations de masse
pour rejeter le gouvernement Moïse
et le référendum sur la constitution
• Lettre de solidarité avec
le peuple haïtien dans sa lutte
pour la démocratie, la justice et les
réparations
45e anniversaire de la Journée de la terre
palestinienne
• Soutenons le droit de
retour des Palestiniens!
Appuyons la résistance palestinienne!
• La Cour pénale
internationale commence son enquête sur les
crimes d'Israël contre le peuple palestinien
- Hilary LeBlanc -
• Israël intensifie sa
destruction illégale de maisons et
de propriétés palestiniennes
• Le refus criminel des
sionistes de fournir des vaccins aux
Palestiniens
- Nick Lin -
Au Parlement
La session du printemps du parlement qui a débuté
le 25 janvier est présentement en pause jusqu'au
12 avril. Au retour, il restera un maximum de 39
jours de session pour débattre et adopter des
projets de loi avant l'ajournement pour l'été qui
est prévu le 23 juin. Afin de réduire la
propagation de la COVID-19, le parlement continue
de se réunir selon le modèle hybride adopté l'an
dernier en vertu duquel les députés participent à
distance ou en personne.
 Les députés vont
passer une portion significative des journées de
session à venir à débattre du budget du 19 avril
du gouvernement. Celui-ci sera suivi d'un projet
de loi d'exécution du budget et le débat sur ce
projet de loi devrait être en tête de liste des
priorités législatives du gouvernement. Tout vote
sur le budget sera une motion de confiance qui
pourrait faire tomber le gouvernement. Les députés vont
passer une portion significative des journées de
session à venir à débattre du budget du 19 avril
du gouvernement. Celui-ci sera suivi d'un projet
de loi d'exécution du budget et le débat sur ce
projet de loi devrait être en tête de liste des
priorités législatives du gouvernement. Tout vote
sur le budget sera une motion de confiance qui
pourrait faire tomber le gouvernement.
Il y a présentement 18 projets de loi émanant du
gouvernement à la Chambre des communes. Treize
d'entre eux en sont à la première étape du débat à
la Chambre, soit la deuxième lecture. Un d'entre
eux, le projet de loi C-10, Loi sur la
radiodiffusion, est présentement à l'étude
du Comité permanent du patrimoine canadien. Quatre
autres projets de loi sont à l'état de rapport,
ayant été étudiés en comité parlementaire où ils
ont été débattus et peut-être amendés.
Le projet de loi C-19 donne à Élections Canada
les outils pour mener une élection pendant la
pandémie d'une façon qui, dit-on, ne compromet pas
la santé et la sécurité des électeurs et du
personnel des bureaux de scrutin. Il a été
présenté en décembre 2020 et en est maintenant à
l'étape de la deuxième lecture.
Aucun projet de loi émanant du gouvernement n'est
présentement en troisième lecture, l'étape finale
du débat à la Chambre.
Parmi les projets de loi qui sont à l'étude au
parlement, il y en a plusieurs qui changent ou
introduisent des lois pour remplir les promesses
électorales que le gouvernement libéral a faites.
Ils comprennent le projet de loi Loi pour une
juste transition pour les travailleurs qui
sont affectés par des pertes d'emplois liées à la
transition vers l'énergie propre; un projet de loi
pour « moderniser » la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement et un projet
de loi visant à créer un nouveau programme
canadien de prestations d'invalidité.
Tout ce que le gouvernement souhaite adopter
comme loi avant l'ajournement de l'été devra aussi
passer par le Sénat, où les étapes sont semblables
à celles du processus législatif de la Chambre.
Les projets de loi émanant du gouvernement à
l'étude
à la Chambre des communes
Deuxième lecture
S-2 - Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre
de la Convention sur les armes chimiques
S-3 - Loi modifiant la Loi sur la santé et la
sécurité dans la zone extracôtière
C-2 - Loi relative à la relance économique en
réponse à la COVID-19
C-11 - Loi de 2020 sur la mise en oeuvre de la
Charte du numérique
C-12 - Loi canadienne sur la responsabilité en
matière de carboneutralité
C-13 - Loi modifiant le Code criminel (paris sur
des épreuves sportives)
C-15 - Loi sur la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones
C-19 - Loi modifiant la Loi électorale du Canada
(réponse à la COVID-19)
C-20 - Loi modifiant la Loi sur les paiements de
péréquation compensatoires supplémentaires à la
Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
C-21 - Loi modifiant certaines lois et d'autres
textes en conséquence (armes à feu)
C-22 - Loi modifiant le Code criminel et la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances
C-23 - Loi modifiant le Code criminel et la Loi
sur l'identification des criminels et apportant
des modifications connexes à d'autres lois
(réponse à la COVID-19 et autres mesures)
C-25 - Loi modifiant la Loi sur les arrangements
fiscaux entre le gouvernement fédéral et les
provinces, autorisant certains paiements sur le
Trésor et modifiant une autre loi
En comité :
C-10 - Loi modifiant la Loi sur la
radiodiffusion et apportant des modifications
connexes et corrélatives à d'autres lois
À l'étape du rapport :
C-5 - Loi modifiant la Loi sur les lettres de
change, la Loi d'interprétation et le Code
canadien du travail (Journée nationale de la
vérité et de la réconciliation)
C-6 - Loi modifiant le Code criminel (thérapie
de conversion)
C-8 - Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté
(appel à l'action numéro 94 de la Commission de
vérité et réconciliation du Canada)
C-14 - Loi d'exécution de l'énoncé économique de
2020

- Steve Rutchinski -
Le Parlement est en train de modifier le serment
de citoyenneté exigé des citoyens naturalisés. Le
projet de loi C-8, Loi modifiant la Loi sur
la citoyenneté (appel à l'action numéro 94 de la
Commission de vérité et de réconciliation du
Canada), est en troisième lecture. C'est un
titre trompeur puisque ce projet de loi ne fait
rien pour réparer les torts historiques causés aux
peuples autochtones, comme le veut la Commission
de vérité et de réconciliation. Il prend comme
point de départ un serment d'allégeance à la reine
d'Angleterre qui est anachronique, quand on sait
que la majorité des Canadiens considèrent que « la
monarchie est dépassée et n'a plus sa place au
XXIe siècle ». C'est ce que démontrent notamment
les récents sondages réalisés par Angus Reid,
Abacus Data, Research Co et d'autres (qu'on dit
applicables à toutes les régions du pays et tous
les groupes d'âge), dans lesquels moins de 25 %
des répondants avaient une allégeance au maintien
de la monarchie.
Il est antidémocratique et contraire à la
volonté de la majorité d'obliger les citoyens
naturalisés à prêter allégeance à un monarque
étranger que n'appuient pas ceux qui acquièrent la
citoyenneté par la naissance. Loin d'obliger les
Canadiens naturalisés à prêter allégeance à la
reine d'Angleterre, il est grand temps de régler
la question de savoir qui choisit et comment est
choisi le chef d'État du Canada.
La monarchie est une institution qui n'est pas
seulement médiévale, elle est aussi pourrie et
corrompue jusqu'à la moelle. C'est un fardeau que
les soi-disant sujets de la reine doivent
porter – tous, mais surtout les peuples de
l'Écosse et du Pays de Galles et ceux qui vivent
dans le soi-disant duché de Cornouailles et
d'autres duchés qui sont forcés de remplir les
coffres royaux. Les modifications apportées au
serment de citoyenneté demandent maintenant non
seulement l'allégeance à la reine d'Angleterre,
appelée reine du Canada, mais aussi à la
Constitution, qui est un texte de loi déjà
anachronique et discriminatoire.
 Il s'agit d'un pas
en arrière. En soulevant la question de la
Constitution, qui n'a même jamais été signée par
le Québec, les amendements proposés dans le projet
de loi C-8 provoquent de nouvelles divisions dans
la société. Le fait d'exiger des nouveaux citoyens
qu'ils s'engagent à respecter les droits issus de
traités, mais pas les droits nationaux du Québec,
crée des problèmes et montre que le gouvernement
n'est sincère ni sur l'un ni sur l'autre. Il est
méprisable de créer ainsi l'illusion que le
gouvernement n'est pas raciste parce qu'il dit que
les citoyens doivent s'engager à respecter les
droits issus de traités quand on sait que le
respect des droits issus de traités est une
responsabilité du gouvernement et non des citoyens
comme tels, qui sont actuellement sans pouvoir sur
ces questions de toute façon. Il s'agit d'un pas
en arrière. En soulevant la question de la
Constitution, qui n'a même jamais été signée par
le Québec, les amendements proposés dans le projet
de loi C-8 provoquent de nouvelles divisions dans
la société. Le fait d'exiger des nouveaux citoyens
qu'ils s'engagent à respecter les droits issus de
traités, mais pas les droits nationaux du Québec,
crée des problèmes et montre que le gouvernement
n'est sincère ni sur l'un ni sur l'autre. Il est
méprisable de créer ainsi l'illusion que le
gouvernement n'est pas raciste parce qu'il dit que
les citoyens doivent s'engager à respecter les
droits issus de traités quand on sait que le
respect des droits issus de traités est une
responsabilité du gouvernement et non des citoyens
comme tels, qui sont actuellement sans pouvoir sur
ces questions de toute façon.
Aucun citoyen ou résident du Canada ne devrait se
voir demander de prêter allégeance à quelque
valeur que ce soit, car c'est une violation de son
droit de conscience. Il devrait suffire de
satisfaire aux exigences objectives de la
citoyenneté et de s'engager à respecter les droits
et les devoirs exigés de tous de la même manière.
Le Canada ne précise nulle part les droits et
devoirs communs à tous les citoyens, qu'ils soient
nés au pays ou naturalisés. Les personnes nées au
Canada n'ont pas à prêter un serment d'allégeance
à qui ou à quoi que ce soit, il est donc
inapproprié d'exiger que les résidents permanents
à qui l'on accorde la citoyenneté soient forcés de
le faire.
Les libéraux de Justin Trudeau ont préparé ce
projet de loi pour donner l'impression de donner
suite à la recommandation 94 de la Commission de
vérité et de réconciliation, qui préconise de
modifier le serment de citoyenneté pour que les
nouveaux citoyens « jurent d'observer fidèlement
les lois du Canada, y compris les traités avec les
peuples autochtones ». Cette recommandation n'est
pas correctement formulée dans le sens où il est
du devoir des gouvernements de faire respecter les
traités, qui sont des documents portant sur les
relations de nation à nation, et non du devoir des
citoyens individuels. La réalité est que ce sont
les citoyens qui exigent présentement des comptes
aux gouvernements pour violation des traités.
Le gouvernement libéral, par l'intermédiaire de
son ministre de l'Immigration, propose plutôt de
modifier le serment de citoyenneté comme suit : «
Je jure fidélité et sincère allégeance à Sa
Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada,
à ses héritiers et successeurs et je jure
d'observer fidèlement les lois du Canada, y
compris la Constitution, qui reconnaît et confirme
les droits – ancestraux ou issus de traités – des
Premières Nations, des Inuits et des Métis, et de
remplir loyalement mes obligations de citoyen
canadien. »
 Une
définition moderne de la citoyenneté reconnaît que
tous les membres du corps politique sont égaux,
avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Tout
citoyen, voire tout résident, est tenu de se
conformer à la loi, ce qui inclut la Constitution,
alors que gagne-t-on à obliger un citoyen
naturalisé à prêter un tel serment ? Un demandeur
qui a satisfait aux exigences d'acquisition de la
citoyenneté par naturalisation devrait simplement
s'engager à respecter les droits et les devoirs
attendus de tout citoyen, ni plus ni moins. Une
définition moderne de la citoyenneté reconnaît que
tous les membres du corps politique sont égaux,
avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Tout
citoyen, voire tout résident, est tenu de se
conformer à la loi, ce qui inclut la Constitution,
alors que gagne-t-on à obliger un citoyen
naturalisé à prêter un tel serment ? Un demandeur
qui a satisfait aux exigences d'acquisition de la
citoyenneté par naturalisation devrait simplement
s'engager à respecter les droits et les devoirs
attendus de tout citoyen, ni plus ni moins.
Il est tout à fait malhonnête de la part des
libéraux de Justin Trudeau d'insérer dans le
serment de citoyenneté l'allégeance à « la
Constitution, qui reconnaît et confirme les droits
– ancestraux ou issus de traités – des Premières
Nations, des Inuits et des Métis ». Par cette
manoeuvre sournoise, qui mentionne les traités
conclus avec les peuples autochtones, mais pas
leurs droits ancestraux inhérents, il laisse
entendre que ces droits sont définis ailleurs dans
la loi canadienne, alors qu'en vertu de la
Constitution ces droits sont interprétés par un
pouvoir supérieur, au-dessus des peuples
autochtones. C'est le langage des colonisateurs.
Il n'y a aucune vérité ou réconciliation dans le
nouveau serment que les partis du cartel vont
faire passer. Le Bloc n'est pas d'accord avec
l'inclusion de la Constitution que le Québec n'a
pas signée. Les députées bloquistes Sylvie Bérubé
et Marie-Hélène Gaudreau l'ont dit lors du débat
sur le projet de loi C-8 le 24 février. Elles ont
également souligné que la Constitution ne définit
pas la fédération canadienne comme une « libre
association de nations égales » et ne reconnaît
pas les droits inhérents des peuples autochtones.
Malgré les déclarations des libéraux selon
lesquelles le projet de loi C-8 donne suite à
l'une des recommandations de la Commission de
vérité et de réconciliation, les révisions
apportées au serment vont à l'encontre de
l'esprit, des principes et de l'objectif des
recommandations de la Commission. Le fait que le
gouvernement présente et adopte un projet de loi
qui oblige les citoyens naturalisés à prêter
serment d'allégeance à l'interprétation coloniale
canadienne de ces relations est un acte
méprisable.
Le seul serment qui pourrait être demandé aux
nouveaux citoyens est le suivant : Je m'engage à
respecter les droits et les devoirs de la
citoyenneté.

- Anna Di Carlo -
Le projet de loi C-10, Loi modifiant la Loi
sur la radiodiffusion et apportant des
modifications connexes et corrélatives à
d'autres lois, est actuellement examiné par
le Comité permanent du patrimoine canadien de la
Chambre des communes. Il a été adopté à
l'unanimité par la Chambre en deuxième lecture le
16 février 2021.
L'affaire est présentée de manière très
raisonnable, comme une question de faire en sorte
que le Canada suive les avancées technologiques et
que les géants des médias numériques comme Netflix
se conforment aux règles relatives au contenu
canadien et aux autres exigences de soutien
culturel présentées aux diffuseurs traditionnels.
« La population canadienne a de plus en plus
accès à de la musique, à des émissions de
télévision et à des films au moyen de services de
radiodiffusion en ligne. Toutefois, contrairement
aux diffuseurs traditionnels, ces services en
ligne n'ont pas été tenus de contribuer à la
création, à la production et à la diffusion de
musique et de récits canadiens. La loi canadienne
doit suivre le rythme de l'évolution
technologique, de sorte que les producteurs et les
créateurs de contenu canadien soient bien
soutenus. Les radiodiffuseurs en ligne doivent
apporter leur juste contribution. [...] », peut-on
lire dans un communiqué de presse du gouvernement
sur le projet de loi. Le communiqué de presse
poursuit:
« [Les modifications au projet de loi C-10]
obligeront les radiodiffuseurs en ligne à
contribuer au système canadien de radiodiffusion
et donneront au Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes (CRTC) les
outils modernes dont il a besoin pour suivre le
rythme de l'évolution technologique. »
Alors, de quoi s'agit-il ? Que se passe-t-il
vraiment ?
La Loi sur la radiodiffusion a été
promulguée pour la première fois en 1932 et
modifiée la dernière fois en 1991. Elle définit la
politique de radiodiffusion du pays, le rôle et
les pouvoirs de son organisme de réglementation,
le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC), et le
mandat de CBC/Radio-Canada en tant que
radiodiffuseur public. Selon le gouvernement, les
modifications actuelles ont comme objectif de
tenir compte de l'évolution de la technologie dans
le domaine de la radiodiffusion.
Avec le projet de loi C-10, des entreprises comme
Amazon, Apple, Disney et Netflix seront
assujetties à des règlements. Contrairement aux
radiodiffuseurs traditionnels, elles ne seront pas
assujetties aux exigences réglementaires en
matière de licences. Cependant, des obligations
qui n'ont pas encore été annoncées leur seront
imposées en vertu du pouvoir réglementaire du
CRTC.
Selon un autre document d'information du
gouvernement sur le projet de loi C-10, « lorsque
le Parlement aura approuvé le projet de loi, le
ministre du Patrimoine canadien a l'intention de
demander au gouverneur en conseil d'émettre des
instructions au CRTC pour le guider dans
l'utilisation des nouveaux outils réglementaires
prévue par le projet de loi.
Selon les documents d'information : « En
consultation avec les intervenants, le CRTC
élaborera et mettra en oeuvre la nouvelle
réglementation visant à assurer que les services
de radiodiffusion traditionnels et en ligne, dont
les géants du Web, offrent des niveaux
considérables de contenu canadien et contribuent à
la création de contenu canadien dans les deux
langues officielles. »
Une enquête sur la question a fait ressortir que
le projet de loi C-10 modifiera la propriété et le
contrôle du système de radiodiffusion. Cela semble
être le changement le plus important, mais ce
n'est même pas indiqué dans les documents
d'information du gouvernement qui élimine
toutefois le premier principe établi de longue
date de la politique canadienne de radiodiffusion
: la propriété et le contrôle canadiens du système
de radiodiffusion.
 Ce
principe a été formulé pour la première fois à la
fin des années 1920 et au début des années 1930, à
l'époque où la radiodiffusion des stations
américaines au Canada était considérée comme une
menace pour la culture nationale par les élites
dirigeantes. Ce principe a été inscrit dans la loi
avec la Loi canadienne sur la radiodiffusion
de 1932, qui a créé la commission
canadienne de radiodiffusion qui deviendra
Radio-Canada en 1936 comme radiodiffuseur public,
qui avait également à l'époque le pouvoir de
réglementer et d'autoriser la radiodiffusion. Ce
principe a été formulé pour la première fois à la
fin des années 1920 et au début des années 1930, à
l'époque où la radiodiffusion des stations
américaines au Canada était considérée comme une
menace pour la culture nationale par les élites
dirigeantes. Ce principe a été inscrit dans la loi
avec la Loi canadienne sur la radiodiffusion
de 1932, qui a créé la commission
canadienne de radiodiffusion qui deviendra
Radio-Canada en 1936 comme radiodiffuseur public,
qui avait également à l'époque le pouvoir de
réglementer et d'autoriser la radiodiffusion.
La Loi de 1932 interdisait la propriété étrangère
et reconnaissait que les ondes étaient un bien
public et qu'elles devaient être détenues et
contrôlées à l'échelle nationale. Le 18 mai 1932,
devant la Chambre des communes, le premier
ministre R. B. Bennett, chef du Parti
conservateur, a énoncé les principes et les
raisons de la Loi. « En premier lieu, a-t-il
déclaré, ce pays doit absolument contrôler la
radiodiffusion de source canadienne, sans
ingérence ni influence étrangères. En l'absence de
ce contrôle, la radiodiffusion ne pourra jamais
devenir une grande agence de communications pour
les affaires nationales ou pour la propagation
d'une pensée et des idéaux nationaux. Sans ce
contrôle, elle ne saurait devenir l'instrument
nécessaire à la diffusion d'une culture reflétant
l'unité nationale et la renforçant. »
Le premier ministre a poursuivi en comparant la
propriété publique à la propriété privée de la
radiodiffusion. « Deuxièmement, aucun autre régime
que celui de la propriété publique ne peut assurer
aux habitants de ce pays, sans distinction de
classe ou de lieu, une jouissance égale des
avantages et des plaisirs de la radiodiffusion. La
propriété privée doit nécessairement établir une
discrimination entre les zones densément et
faiblement peuplées. C'est le défaut impossible à
corriger de la propriété privée; c'est un tort
inéluctable et inhérent à ce système. »
Puis, Richard Bennett a énoncé la troisième
considération. « L'utilisation des ondes, ou des
ondes elles-mêmes, quel que soit le nom qu'on
veuille leur donner, qui se trouvent au-dessus du
sol ou de la terre du Canada sont une ressource
naturelle sur laquelle nous avons pleine
juridiction. [...] Je ne pense pas que le
gouvernement serait justifié de laisser les ondes
à l'exploitation privée et de ne pas les réserver
au développement à l'usage du peuple. »
Faisant preuve de clairvoyance, Bennett a ajouté
: « Il est possible qu'à un moment donné, lorsque
la science aura fait de plus grandes
découvertes... il soit souhaitable de prendre
d'autres dispositions, en tout ou en partie, mais
personne, à ce moment-ci, dans les balbutiements
de cette grande science, ne serait, je pense,
justifié de proposer que nous devrions abandonner
le contrôle de cette ressource naturelle. »
Le principe de la propriété et du contrôle
publics a été réitéré dans la Loi sur la
radiodiffusion de 1967 adoptée par les
libéraux de Pearson, en grande pompe à l'occasion
du centenaire de la Confédération. La Loi a été
modifiée pour l'adapter aux développements
technologiques et a établi l'exigence légale que
tous les radiodiffuseurs canadiens – radio,
télévision et câble – soient détenus et
contrôlés par des Canadiens. C'est cette
disposition qui est aujourd'hui éliminée par les
libéraux de Trudeau.
Depuis, la politique de radiodiffusion de la Loi
sur la radiodiffusion énonce comme premier
principe : « Il est déclaré que... a) le système
canadien de radiodiffusion doit être,
effectivement, la propriété des Canadiens et sous
leur contrôle ».
Le projet de loi C-10 remplace cet article par
une déclaration plus susceptible d'obscurcir que
d'éclairer et qui est conçue pour garantir et
accorder d'énormes pouvoirs discrétionnaires : «
(a) chaque entreprise de radiodiffusion est tenue
de contribuer à la réalisation des objectifs de
cette politique, de la manière appropriée en
fonction de la nature des services qu'elle fournit
».
Il existe vingt autres « principes » de ce type,
qui pour la plupart restent intacts dans la Loi
actuelle, comme « le système canadien de
radiodiffusion doit servir à sauvegarder, enrichir
et renforcer la structure culturelle, politique,
sociale et économique du Canada ».
L'élimination de l'article sur la propriété
canadienne a fait l'objet de beaucoup de questions
et de critiques. En réponse aux questions posées
en deuxième lecture, le ministre du Patrimoine
Steven Guilbeault a évité la question et, dans le
double langage typique des libéraux, a déclaré à
la Chambre des communes : « Nous ne changeons donc
rien sur la question de la propriété des
entreprises canadiennes. » Il a ajouté que
l'alinéa éliminé n'est pas ce « qui fait en sorte
que les entreprises canadiennes doivent demeurer
de propriété canadienne ». Vraiment ! Il a dit que
c'est le CRTC, comme organisme qui octroie des
licences aux radiodiffuseurs, qui contrôle la
propriété. Il a déclaré que cet alinéa modifié «
est justement ce qui va nous permettre de faire en
sorte que les lois canadiennes et la
réglementation canadienne s'appliquent aux géants
du Web ».
Cela pose évidemment la question : quelles lois,
quelles réglementations et qui décidera de leur
application aux « géants du Web » qui, jusqu'à
présent, fonctionnent sans aucune réglementation.
De plus, que se passe-t-il si ce sont les « géants
du Web » qui imposent leurs décisions, auquel cas
on revient au problème de qui possède et contrôle
les « géants du Web » ?
Questionné à nouveau en commission, M. Guilbeault
a insisté : « Nous ne sacrifions pas la propriété
des diffuseurs canadiens. Nous ne le faisons pas.
Ce n'est tout simplement pas le cas. Ce que nous
faisons ... c'est veiller à ce que les lois et les
règlements canadiens puissent s'appliquer aux
plateformes en ligne, ce qui n'est pas le cas en
ce moment. Si nous ne prévoyons pas un espace pour
le faire dans le projet de loi, comment
pourrons-nous appliquer nos lois et nos règlements
à ces plateformes ? »
Les experts dans le domaine, ainsi que les
députés, n'acceptent pas que Steven Guilbeault
escamote ainsi la question de la propriété, la
considérant comme un point non pertinent. Beaucoup
soulignent que le principe de la propriété
canadienne aurait pu être conservé comme il est et
que des articles spécifiques auraient pu être
ajoutés pour traiter de l'imposition et des
contributions aux efforts culturels canadiens par
les médias numériques étrangers.
En comité, la députée néodémocrate Heather
McPherson a demandé des précisions à Steven
Guilbeault et à son personnel. « J'aimerais
comprendre ce qui a motivé le changement proposé
et si cela risque de faciliter l'acquisition de
nos radiodiffuseurs par, disons, des sociétés
américaines », a-t-elle dit. Thomas Owen Ripley,
un haut fonctionnaire du ministère du Patrimoine
canadien, a répondu que « la réponse est non. À
l'heure actuelle, il existe une directive qui
s'adresse au CRTC et qui prévoit des restrictions
sur la propriété étrangère dans le cas des entités
autorisées. Le fait est que nos radiodiffuseurs en
direct et nos entreprises de distribution par
câble et par satellite ne peuvent pas appartenir à
des intérêts étrangers ni être sous leur contrôle
tant que cette directive reste en vigueur. »
Pour plus de certitude, Heather McPherson a
demandé : « À titre de précision, monsieur Ripley,
cette directive a-t-elle force exécutoire ? Ce
n'est pas quelque chose qui peut être modifié par
le CRTC ? » Thomas Owen Ripley a répondu : « En
effet, elle ne peut pas être modifiée par le CRTC.
»
Lorsque le député du Bloc Québécois Martin
Champoux a insisté sur cette question, Steven
Guilbeault a déclaré : « Le CRTC n'a aucun pouvoir
sur cette question. C'est une décision
gouvernementale. Est-ce qu'un autre gouvernement
pourrait décider de changer les choses ? Un
gouvernement est toujours souverain et libre de
prendre ses propres décisions. Quoi qu'il en soit,
le CRTC ne peut pas faire cela, et la Loi [le
projet de loi C-10] ne change rien à cela. La
directive qui est en place demeure en place. »
Toutefois, en plus de nous assurer qu'« un
gouvernement est toujours souverain et libre de
prendre ses propres décisions », c'est-à-dire
qu'il a des prérogatives au-dessus des pouvoirs
législatifs du parlement pour faire ce qu'il veut
et que la souveraineté réside dans ces pouvoirs de
police, le ministre Guilbeault ne répond toujours
pas quand on lui demande pourquoi l'article actuel
est éliminé.
La création d'un système de radiodiffusion de
moins en moins équitable entre les opérateurs
canadiens et internationaux
L'Association canadienne des radiodiffuseurs[1] a également
témoigné devant le Comité du patrimoine canadien.
Elle s'est opposée à la suppression des
dispositions relatives à la propriété et au
contrôle canadiens et en a expliqué les
conséquences. Joel Fortune, le conseiller
juridique de l'association, a déclaré : « De façon
générale, la Loi comporte deux grandes parties. Il
y a les objectifs de politique [de radiodiffusion]
énoncés à l'article 3, puis il y a les pouvoirs.
Les deux éléments sont indispensables. Il faut
avoir des objectifs stratégiques et il faut avoir
les pouvoirs voulus. On peut bien avoir tous les
nobles objectifs politiques du monde, s'il n'y a
aucun pouvoir pour les appuyer, ce n'est pas la
peine. De la même façon, on peut avoir tous les
pouvoirs du monde, mais s'il n'y a pas d'objectif
défini dans la Loi, les contestations peuvent
pleuvoir.
« Dans le cas de la propriété, tout d'abord sur
le plan des politiques, il serait incroyable pour
moi que le soutien de la propriété canadienne dans
notre système ne soit pas un objectif. Cela ne
veut pas dire que le libellé sur la propriété ne
devrait pas être modifié; peut-être devrait-il
l'être. Quoi qu'il en soit, nous avons proposé un
amendement qui, selon moi, tient compte des
plateformes mondiales tout en préservant l'espace
nécessaire aux radiodiffuseurs canadiens.
« Pourquoi ce choix ? Nous ne voulons pas que les
radiodiffuseurs canadiens soient simplement des
succursales de plateformes étrangères. [...] Sur
le plan juridique, la directive existe en vertu du
texte législatif actuel, et elle exige que le
système de radiodiffusion soit détenu et contrôlé
par des Canadiens. Cette orientation est
directement liée à cet objectif. S'il n'y a pas
d'objectif en matière de la propriété canadienne,
au nom de quoi peut-on donner cette directive ? Il
est certainement possible de contester en droit la
directive en soutenant qu'elle ne tient plus,
compte tenu des changements apportés à la
politique et à la Loi. C'est ce qui nous
préoccupe. [...] Si la directive du gouvernement
sur la propriété était contestée et était
invalidée, il n'y aurait pas de restrictions en
matière de propriété dans le secteur de la
radiodiffusion canadienne. »
Aussi inutiles qu'elles puissent paraître, les
contestations de l'affirmation libérale que la
suppression de l'article sur la propriété
canadienne est sans importance montrent qu'en fait
cet article est très important et que sa
suppression aura une incidence sur la façon dont
les décisions sont prises et sur ce qui les guide.
Il est clair que les politiques qui guident les
décisions et les règlements du CRTC sont 1)
contrôlées par le gouvernement en place; 2)
guidées par les lois qu'il adopte et 3) soumises
aux prérogatives du Cabinet, ce qui revient au
même et nous mène à la question suivante : quels
sont les intérêts privés étroits qui tirent les
ficelles ?
La suppression de l'article sur la propriété
montre la politisation des intérêts privés dans
les conditions d'une industrie de la
radiodiffusion fortement monopolisée. Richard
Stursberg, coauteur de The Tangled Garden : A
Canadian Cultural Manifesto for the Digital Age
et ancien directeur général de Téléfilm
Canada, a témoigné devant le Comité et a abordé la
question de la propriété canadienne.
« Premièrement, en vertu de la loi actuelle, les
sociétés de radiodiffusion qui exercent leurs
activités au Canada doivent être la propriété et
sous le contrôle de Canadiens. On s'est beaucoup
demandé si le projet de loi C-10 supprimait cette
exigence, a-t-il déclaré. L'enjeu juridique est
largement théorique, puisque cette obligation a
été abandonnée il y a quelques années. Au cours de
la dernière décennie, des diffuseurs étrangers
comme Netflix et Amazon n'ont cessé d'offrir des
émissions de télévision aux Canadiens, même si ces
entreprises n'appartiennent pas à des intérêts
canadiens. Il n'y a aucune chance qu'elles soient
un jour forcées de devenir canadiennes. »
Se basant sur ce fait, Richard Stursberg, ainsi
que plusieurs autres personnes qui ont témoigné
devant le comité, ont soutenu qu'au nom de
l'égalité des chances, il est peut-être temps
d'éliminer complètement la réglementation sur la
propriété étrangère dans l'industrie. Richard
Stursberg a déclaré : « Par souci d'équité, vous
devriez peut-être placer les diffuseurs canadiens
et étrangers sur un pied d'égalité, en amendant le
projet de loi C-10 de manière à supprimer
officiellement l'exigence relative à la propriété
canadienne. Ne pas le faire reviendrait à
désavantager les radiodiffuseurs canadiens dans
leur propre marché. »
En effet ! Mais qu'en est-il de la question de
quels intérêts la radiodiffusion sert et qui parle
au nom des Canadiens ?
Troy Reeb, vice-président exécutif du Réseau de
radiodiffusion de Corus Entertainment Inc., est
allé dans le même sens que M. Stursberg et a
déclaré qu'il était important « pour les
entreprises canadiennes non seulement de pouvoir
faire les investissements qu'elles souhaitent,
mais aussi d'être en mesure d'attirer des
investissements ».
Il poursuit : « Un des points positifs du projet
de loi est qu'il traite les diffuseurs Internet
étrangers de la même manière que les diffuseurs
canadiens. Ce faisant, il supprime certaines
limites à la propriété étrangère. Nous ne plaidons
pas nécessairement en faveur de la propriété
étrangère, mais nous devons avoir la capacité
d'attirer des investissements étrangers, au
besoin, pour soutenir la concurrence des géants de
la Silicon Valley et d'Hollywood qui valent des
billions de dollars. C'est là qu'intervient la
question de la souplesse. Nous voulons créer des
émissions canadiennes, mais si nos principaux
concurrents créent des émissions canadiennes avec
des milliards de dollars provenant des marchés
internationaux, nous devons avoir la capacité de
faire de même. »
Le président de l'Association canadienne des
radiodiffuseurs[2],
Kevin Desjardins, a également appelé à
l'égalisation des chances. Faisant référence aux
géants du numérique, il a déclaré : « [...] Ils
ont l'échelle de grandeur et la capacité voulues
pour recevoir la publicité et la diffuser. Leur
taille est certainement beaucoup plus imposante,
et ils sont capables de proposer des prix
inférieurs à ceux, par exemple, d'une entreprise
canadienne qui essaie de s'implanter. Ils sont en
mesure de le faire parce qu'ils sont capitalisés à
l'échelle mondiale. [...]
« Cela nous ramène à la question précédente,
celle de la propriété canadienne. Dans cette
discussion, nous revenons sans cesse sur la
création d'un système de radiodiffusion de moins
en moins équitable pour les exploitants canadiens
par rapport aux exploitants internationaux. Les
exploitants internationaux ont un vaste accès aux
marchés financiers du monde entier, et si nous
voulons dire que, eh bien, ils peuvent le faire,
et que les exploitants canadiens ne peuvent que
... La Loi sur la radiodiffusion est
fondamentalement la loi par laquelle les
radiodiffuseurs fonctionnent, et il y a beaucoup
de gens qui y ont un intérêt, alors la dernière
chose que je plaiderais, à la fois à ce comité et
au gouvernement, est de garder les radiodiffuseurs
et leur capacité future à être compétitifs au
centre des considérations à l'avenir. »
Il est donc clair que loin de moderniser la loi
sur la radiodiffusion, comme le prétendent les
libéraux, le projet de loi C-10 marque la mort
officielle de l'édification nationale en matière
de radiodiffusion, qui était ancrée dans
l'opposition à la domination culturelle des
États-Unis sur le Canada. À sa place, les intérêts
privés qui possèdent les « géants du numérique »
qui opèrent au Canada auront désormais le champ
libre sans conteste. S'agit-il de rendre le Canada
plus compétitif sur le marché mondial tel que
l'époque l'exige, comme certains le prétendent, ou
moins compétitif comme le soutiennent d'autres
avec raison ? Les réglementations promises qui
obligeront Facebook, Google et consorts à payer
des impôts et des contributions qui représentent
des sommes minuscules par rapport à leurs
mégaprofits visent-elles simplement à leur faire
payer une part équitable ce qui, selon beaucoup,
ne sera pas du tout équitable ? Ou, si l'on ajoute
les projets du gouvernement de réglementer
davantage le contenu en ligne, tout cela est-il
fait pour intégrer davantage le Canada à la «
sécurité intérieure » des États-Unis et harmoniser
les deux régimes de gouvernement ? Des preuves
irréfutables montrent qu'en fin de compte, les
intérêts privés étroits qui prennent les décisions
et établissent les règlements dans les deux pays
sont ceux de l'industrie de la défense américaine
qui cherchent à imposer le contrôle impérialiste
américain sur tous les intérêts en conflit. Ils
interviennent au Canada avec pleine liberté d'agir
avec leurs cartels et coalitions pendant que
d'autres intérêts privés sont bloqués, parce
qu'ils seraient des agents de l'ennemi qui
s'immiscent dans les institutions démocratiques
libérales du Canada et font la promotion de
valeurs « non canadiennes », lire « non
américaines »[3].
L'incorporation officielle de l'agenda néolibéral
à la Loi sur la radiodiffusion abandonne
de facto toute considération relative à la vie
économique, sociale, politique et culturelle dont
le Canada et les Canadiens ont besoin. On annule
de facto toutes les autres dispositions de la Loi
dont la raison d'être est censée être de s'assurer
que le système canadien de radiodiffusion «
encourage l'expression canadienne en proposant une
très large programmation qui traduise des
attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et
une créativité artistique canadiennes, qui mette
en valeur des divertissements faisant appel à des
artistes canadiens et qui fournisse de
l'information et de l'analyse concernant le Canada
et l'étranger considérés d'un point de vue
canadien ».
Dans cet exercice de subordination de la
politique de radiodiffusion aux intérêts privés
étroits qui possèdent et contrôlent les « géants
du numérique » sous l'emprise de l'impérialisme
américain, plusieurs éléments importants sont
complètement rayés de l'ordre du jour, comme la
destruction progressive de la Société Radio-Canada
(SRC) en tant que radiodiffuseur public national
et, en fait, sa conversion en un porte-parole des
politiques des gouvernements qui se succèdent sur
lesquelles les Canadiens n'exercent aucun
contrôle. On ne compte plus les cas où
Radio-Canada a été menacée et même mise au silence
parce que soupçonnée de ne pas suivre les
politiques fédérales à différentes époques. Le
premier ministre Jean Chrétien, par exemple, a
qualifié Radio-Canada de « boîte à séparatistes »
pendant le référendum de 1995 au Québec, se
plaignant qu'elle ne donnait pas suffisamment de
présence à ses discours. Pierre Elliott Trudeau
aussi, quand il était premier ministre du Canada,
a menacé la société d'État pour les mêmes raisons[4].
Les coupes massives effectuées à partir de la fin
des années 1980 n'ont jamais été inversées, de
sorte qu'aujourd'hui, en matière de financement
par habitant, la SRC occupe la 17e place sur la
liste des 20 sociétés de radiodiffusion d'État
dans le monde établie par l'Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE). La SRC reçoit 34 dollars par habitant
contre une moyenne de 100 dollars, ou 180 dollars
en Norvège et 97 dollars au Royaume-Uni. Bien que
le financement ait été augmenté, les niveaux n'ont
jamais été rétablis à ce qu'ils étaient avant le
lancement de l'offensive antisociale, et encore
moins augmentés à un montant qui lui permettrait
de remplir son rôle présumé.
La Loi laisse également la nomination des
directeurs de la SRC à la discrétion du parti au
pouvoir, ce qui, combiné à la menace permanente de
réductions de financement et à l'absence d'une
disposition statutaire établissant un financement
garanti, fait de Radio-Canada la proie du système
de partis cartellisés, de ses valeurs et de ses
ambitions, ainsi que des pressions des politiques
néolibérales. En plus de considérer toute forme de
subvention à des fins publiques comme un anathème,
les politiques néolibérales proposent des valeurs
et des objectifs antinationaux et bellicistes qui
sont en contradiction avec les valeurs des
Canadiens.
De plus, les objectifs politiques de la loi sur
la radiodiffusion, qui demeurent inchangés et
n'étaient même pas matière à discussion,
continuent de servir de fondement aux normes
antidémocratiques défendues par le CRTC. Un
exemple concret est son évaluation de la
couverture électorale des partis politiques du
pays sur la base du concept d'« équité » plutôt
que d'« égalité ». La plupart des plaintes
déposées au sujet de reportages électoraux biaisés
sont rejetées en invoquant le concept douteux d'«
équité ». Suivant l'« équité », l'utilisation du
terme moqueur « partis marginaux » pour désigner
certains partis et candidats à une élection est
considérée comme acceptable.
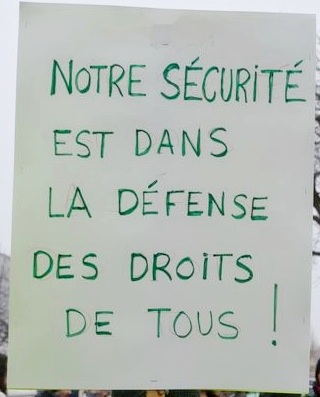 Dans la
pratique quotidienne, les politiques du CRTC
entérinent un système de radiodiffusion qui
interdit la diffusion de toutes les tendances,
opinions et persuasions politiques. Le plus
flagrant de tous est l'absence, dans la couverture
des nouvelles, de reportages sur les luttes, les
revendications et les préoccupations des
travailleurs, ainsi que sur celles des peuples
autochtones et de tous ceux qui réclament leurs
droits et se battent pour la paix, la justice et
la démocratie. Dans la
pratique quotidienne, les politiques du CRTC
entérinent un système de radiodiffusion qui
interdit la diffusion de toutes les tendances,
opinions et persuasions politiques. Le plus
flagrant de tous est l'absence, dans la couverture
des nouvelles, de reportages sur les luttes, les
revendications et les préoccupations des
travailleurs, ainsi que sur celles des peuples
autochtones et de tous ceux qui réclament leurs
droits et se battent pour la paix, la justice et
la démocratie.
Les Canadiens ont besoin d'un système de
radiodiffusion national qui sert leurs intérêts.
Celui-ci doit exprimer de façon professionnelle ce
qu'ont à dire les Canadiens de tous les horizons,
de toutes les croyances et de toutes les
convictions, ce qu'ils ont à chanter, à danser, à
écrire, à mettre en musique et en films, à
discuter et à débattre.
Aujourd'hui, des réglementations sont adoptées
par prérogative gouvernementale, sur la base de
critères invoquant la sécurité et les intérêts
nationaux, qui permettent aux « agences de
renseignement » de censurer les discours sur les
médias sociaux. Pourquoi cela ne fait-il pas
l'objet d'un débat ? Une autre affirmation
intéressée est que si les « géants du numérique »
censurent l'accès à leurs réseaux sociaux, c'est
une affaire privée qui les concernent eux, les
grands intérêts privés et les personnes visées et
pas le gouvernement. Cela ne ferait pas partie du
domaine public !
Tout cela montre que la Loi sur la
radiodiffusion du Canada est un sujet de
préoccupation sérieux pour l'ensemble du corps
politique et que les vraies questions n'ont même
pas encore été posées.
Notes
1. Le
Groupe des radiodiffuseurs indépendants est
composé de Aboriginal Peoples Television
Network Incorporated, BBC Kids, Channel Zero
Inc, Ethnic Channels Group Limited, Hollywood
Suite Inc, OUTtv Network Inc, Stingray Group
Inc, Super Channel (Allarco Entertainment),
TV5 Québec Canada et Zoomer Media Limited. (en
date de janvier 2019).
2.
L'Association canadienne des radiodiffuseurs
se décrit comme « le porte-parole national des
radiodiffuseurs privés du Canada. Elle
représente la grande majorité des services de
programmation privés canadiens, y compris les
stations de radio et de télévision, les
réseaux et les services de télévision
spécialisée, payante et à la carte ».
3. Les
diverses forces de sécurité exercent un diktat
sur ce qui est considéré comme une menace aux
valeurs canadiennes et à la sécurité du pays
dans les élections et dans les médias, en
fonction de l'adhésion ou non à la politique
officielle de l'État. Nous l'avons vu quand
des responsables du Centre de la sécurité des
télécommunications du Canada (CSTC) se sont
présentés à une réunion du Comité consultatif
électoral des partis politiques en 2017 pour
informer les partis de leur évaluation des «
menaces pour le processus démocratique
canadien ». Les « valeurs » que ces agences
défendent incluent l'adhésion du Canada à
l'OTAN et au G7, etc. Lorsqu'Anna Di Carlo lui
a demandé si le fait de demander le retrait du
Canada de l'OTAN constitue une menace pour la
sécurité nationale, un agent du CSTC a répondu
que son travail consiste simplement à défendre
les politiques du gouvernement en place.
4. David
Taras et Christopher Waddell, The End of
CBC ?, University of Toronto Press,
Toronto, 2020

- Pierre Soublière -

Cliquer pour élargir
Le 26 février, la ministre de Développement
économique Mélanie Joly a annoncé un
investissement de 3,2 millions de dollars dans ce
qu'on appelle la « grappe de la cybersécurité »
d'Ottawa-Gatineau.
Quoique Joly ait présenté l'investissement comme
faisant partie d'une « relance économique »
post-pandémique, ce secteur est promu depuis 2018.
En novembre 2018, Invest Ottawa, Ville de
Gatineau, ID Gatineau et In-Sec-M ont
officiellement annoncé le lancement d'une
stratégie commune visant à attirer « dans la
région de la capitale du Canada de nouvelles
entreprises, de nouveaux investissements, de
nouveaux talents et de nouvelles possibilités
d'affaires en cybersécurité ». La stratégie vise à
« positionner stratégiquement la région de la
capitale nationale comme un épicentre mondial » et
« aider les entreprises et les innovateurs locaux
à renforcer leur présence sur le marché mondial de
la cybersécurité », un marché lucratif,
disent-ils, « de 152,71 milliards de dollars en
2018 dont la valeur devrait atteindre 248,26
milliards de dollars d'ici 2023 ».
In-Sec-M, qui recevra 820 000 dollars, est une
organisation composée de près de 90 entreprises de
cybersécurité qui se décrit comme étant « un
écosystème canadien de l'industrie de la
cybersécurité ». Les fonds aideraient à «
consolider la compétitivité d'entreprises dans des
secteurs stratégiques au Québec en cybersécurité
».
Fondé en 2017, In-Sec-M prétend « regrouper des
entreprises, des établissements de formation et de
recherche ainsi que des acteurs gouvernementaux
pour mener des actions concertées en vue
d'augmenter la cohésion et la compétitivité de
l'industrie canadienne de la cybersécurité, à
l'échelle nationale et internationale ». En tant
que « centre d'excellence numérique », financé par
le gouvernement du Québec, In-Sec-M cherche à «
promouvoir l'industrie de la cybersécurité et
accroître les capacités d'innovation, de
commercialisation et de croissance des entreprises
dans ce domaine ». Il appuie aussi des petites et
moyennes entreprises innovatrices en leur offrant
des services-conseils en cybersécurité dans le
cadre du Programme d'aide à la recherche
industrielle (PARI) du Conseil national de
recherches Canada.
Un des partenaires de In-Sec-M est CyberQuébec,
le « Centre collégial de transfert de technologie
» affilié au Cégep de l'Outaouais depuis l'été de
2018, qui offre de l'aide technique et des
services de recherche aux entreprises spécialisant
dans le domaine. L'Université du Québec dans
l'Outaouais entreprend aussi des démarches pour
améliorer ses offres de formation en
cybersécurité.
Jusqu'à maintenant, on prétend que la principale
raison d'être de toute cette infrastructure
interreliée de la cybersécurité est de protéger
les entreprises du piratage en ligne. Mais une
déclaration du député de Gatineau, Steven
MacKinnon, le jour de l'annonce faite par Joly,
laisse entendre qu'il y a indéniablement une
relation entre ce secteur et l'appareil policier
et militaire de l'État. MacKinnon décrit
Ottawa-Gatineau comme étant la région idéale pour
développer l'« industrie » de la cybersécurité en
raison de la proximité d'agences fédérales telles
que le Centre canadien de la cybersécurité (CCC),
le Service canadien du renseignement de sécurité
(SCRS), la GRC, Services partagés Canada, et le
Ministère de la Défense nationale.
Aussi, dans une présentation du 25 mai 2020, la
ministre du Gouvernement numérique, Joyce Murray,
a parlé des défis posés par la cybersécurité
aujourd'hui. Elle a affirmé que le secrétariat du
Conseil du Trésor du Canada et Services partagés
Canada continueraient de travailler avec le CCC
pour mettre en oeuvre des mesures pour « prévenir
et détecter les menaces potentielles aux systèmes
du gouvernement et pour y répondre. ». Le CCC
lui-même fait partie du Centre de la sécurité des
télécommunications Canada, qui récemment
considérait que le ciblage du développement des
vaccins pour la COVID-19 et « les cybermenaces au
processus démocratique du Canada » représentaient
des activités menaçantes. La ministre a aussi
affirmé que « pour lutter contre la désinformation
sur la COVID 19, ainsi que la fraude », le Centre
canadien pour la cybersécurité « a travaillé avec
des partenaires de l'industrie pour retirer des
milliers de sites Web ou d'adresses de courriel
frauduleux utilisés pour des cyberactivités
malveillantes ».
En 2019, la construction d'un centre de formation
de plusieurs millions de dollars pour la police et
l'armée à proximité de l'aéroport de Gatineau a
été annoncée. Le centre servira à la formation
d'escouades tactiques, de sauvetages par
hélicoptère et il y aurait un village fictif. Lors
d'une réunion du Conseil municipal de Gatineau en
octobre 2019, deux membres du conseil ont proposé
de refuser le changement de zonage pour accommoder
le projet en soulevant entre autres que le
département d'urbanisme de la ville trouvait le
projet inacceptable. La proposition a été défaite
par la majorité des conseillers qui ont voté en
faveur du changement de zonage.
Le plan de faire de la « région de la Capitale
régionale » un écosystème de la cybersécurité
assombrit déjà la région avec son réseau complexe
d'acteurs interreliés où il est difficile de faire
la part entre gouvernements et entreprises, entre
maisons d'éducation et entreprises, etc. Au nom de
contribuer à la « relance économique », il impose
à la région une vocation de gouvernement de
police, d'espionnage et d'intrigues. Cela mérite
d'être discuté. En ces temps de pandémie et face
aux divers problèmes que nous connaissons, n'y
a-t-il pas des besoins et des préoccupations
démocratiques beaucoup plus urgents que de faire
la chasse aux menaces au « processus démocratique
» du Canada ?

Les injustices contre les peuples
autochtones se poursuivent
- Philip Fernandez -

Manifestation en 2019 à Attawapiskat pour exiger
que gouvernement assure
de l'eau potable salubre
La vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan,
a publié un rapport accablant sur le fait que le
gouvernement Trudeau ne respecte pas son
engagement d'éliminer les avis de faire bouillir
l'eau dans les communautés autochtones avant mars
2021.
L'« engagement » du gouvernement Trudeau en 2015
avait été pris envers près de 1 050 réseaux
publics d'alimentation en eau desservant près de
330 000 personnes. Plus d'un tiers de tous les
ménages n'étaient pas compris dans cet engagement
puisqu'ils obtiennent l'eau de puits privés et de
citernes, et n'ont aucune eau courante. On n'a pas
non plus tenu compte de plusieurs communautés
nordiques.
Services aux Autochtones Canada a reconnu en
décembre que l'engagement ne serait pas respecté.
Le premier ministre a dit que les difficultés
engendrées par la pandémie de la COVID-19 avaient
compliqué les choses.
 La vérificatrice
générale a cependant conclu que le gouvernement
n'avait jamais été en voie d'atteindre son
objectif – et ne le sera jamais, en raison de ses
tergiversations à vouloir régler le problème.
Quinze ans après que son ministère a fait mention
de ce problème pour la première fois en 2005 (et à
nouveau en 2011), plusieurs communautés
autochtones n'ont toujours pas d'eau potable
salubre. Elle a trouvé qu'il n'existait même pas
de régime de réglementation pour la gestion de
l'eau potable dans les communautés des Premières
Nations. La vérificatrice
générale a cependant conclu que le gouvernement
n'avait jamais été en voie d'atteindre son
objectif – et ne le sera jamais, en raison de ses
tergiversations à vouloir régler le problème.
Quinze ans après que son ministère a fait mention
de ce problème pour la première fois en 2005 (et à
nouveau en 2011), plusieurs communautés
autochtones n'ont toujours pas d'eau potable
salubre. Elle a trouvé qu'il n'existait même pas
de régime de réglementation pour la gestion de
l'eau potable dans les communautés des Premières
Nations.
Voici quelques faits saillants du rapport de la
vérificatrice générale pour 2021 :
- la formule de financement du fonctionnement et
de l'entretien des réseaux d'alimentation en eau
des Premières Nations est la même depuis sa
création, il y a 30 ans, et ne reflète pas les
avancées technologiques ni les frais réels de
fonctionnement et d'entretien des infrastructures;
- l'état des systèmes d'alimentation en eau dans
les communautés des Premières Nations, évalué en
fonction des taux de risques annuels, ne s'est pas
du tout amélioré dans les cinq dernières années –
malgré des dépenses de plus d'un milliard de
dollars;
- il y a eu en 2015 au total 160 avis à long
terme sur la qualité de l'eau potable touchant les
réseaux publics d'approvisionnement en eau. De ce
total, 60 (soit 37,5 %) demeuraient en vigueur
dans 41 collectivités des Premières Nations.
- l'année dernière, il n'y avait pas d'opérateurs
entièrement formés et agréés pour 189 réseaux
publics d'alimentation en eau sur 717 (soit 26 %)
dans les réserves des Premières Nations, et il n'y
avait pas d'opérateurs de remplacement entièrement
formés et agréés pour 401 de ces 717 réseaux. La
faiblesse des salaires contribuerait aux problèmes
de maintien en poste d'opérateurs qualifiés de
réseaux d'alimentation en eau, comparativement aux
communautés non autochtones.
La vérificatrice générale conclut que l'accès à
l'eau potable propre et salubre pour les
communautés autochtones est la clé pour respecter
l'engagement de réconciliation du gouvernement et
son échec à ce sujet met en danger la santé et la
sécurité des communautés des Premières Nations.
Seulement depuis les deux dernières décennies,
deux tiers des communautés des Premières Nations
au Canada ont eu des « avis sur la qualité des
eaux potables » à un moment donné. Le refus
continu du gouvernement Trudeau, tout comme celui
du gouvernement Harper avant lui, de régler ce
problème est en violation des droits humains
fondamentaux des peuples autochtones et la
souffrance causée à la santé et au bien-être des
peuples autochtones est un crime.
Fidèle à la tradition libérale, le gouvernement
se dit d'accord avec tout ce que la vérificatrice
générale recommande. Le responsable du ministère
s'engage – non pas à régler le problème, ce qui
serait trop demander – mais d'être « transparent
», de « fournir autant d'information que possible
à tout le monde » et de « surveiller de près les
développements » et de s'engager fermement à «
faire mieux ». Les grandes prétentions qui sont la
marque de commerce des libéraux de Trudeau se
vérifient dans les résultats de leurs engagements
de 2015.
Nous devons mettre fin aux mesures et aux
politiques racistes coloniales de l'État canadien
et de ses gouvernements à tous les niveaux en
violation des droits des peuples autochtones.

Opposition à une définition
sioniste de l'antisémitisme
- Diane Johnston -

Une motion pourrait être présentée à la réunion
mensuelle du 19 avril du Conseil municipal de
Montréal pour adopter la définition opérationnelle
utilisée par l'Alliance internationale pour la
mémoire de l'Holocauste (IHRA). Elle était
attendue à la réunion des 22-23 mars. Prévoyant
une telle réunion, près de 30 organisations
antiracistes montréalaises ont envoyé le 9 mars
une lettre ouverte à la mairesse Valérie Plante et
au conseil leur demandant de prendre position
contre la définition de l'IHRA.
Cette définition dit: «« L'antisémitisme est une
certaine perception des Juifs qui peut se
manifester par une haine à leur égard. Les
manifestations rhétoriques et physiques de
l'antisémitisme visent des individus juifs ou non
et/ou leurs biens, des institutions communautaires
et des lieux de culte. » Cette définition est à la
fois fallacieuse et étroite. Elle est imprégnée de
notions sionistes intéressées, notamment la
supposition que seuls les Juifs sont des Sémites.
En outre, sur les 11 « exemples » que l'IHRA
fournit comme lignes directrices, sept font
référence à la critique de l'État d'Israël.
Voix juives indépendantes Canada a souligné qu'«
une motion similaire a été retirée à la suite
d'une large opposition populaire en janvier 2020
».
Il est utile de revenir sur ce qui s'est passé à
l'hôtel de ville de Montréal en janvier 2020 la
première fois que la motion a été présentée et ce
qui a suivi.
 Le 27 janvier 2020,
à l'occasion du 75e anniversaire de la libération
des prisonniers d'Auschwitz par l'armée
soviétique, également connue sous le nom de
Journée internationale de commémoration en mémoire
des victimes de l'holocauste, le conseil municipal
de Montréal s'est réuni pour discuter d'une motion
visant à adopter la définition de travail de
l'IHRA de l'antisémitisme présentée par Lionel
Perez, chef de l'opposition officielle et chef par
intérim de l'Ensemble Montréal (anciennement
Équipe Denis Coderre pour Montréal), à la suite de
la défaite de Coderre aux élections municipales de
2017. Un piquetage devant l'hôtel de ville de
Montréalqui comprenait des membres de Palestiniens
et Juifs unis (PAJU), de Voix juives
indépendantes, du Parti communiste du Canada
(marxiste-léniniste) et d'autres forces
progressistes, s'est opposé à l'adoption de la
définition de l'IHRA. Le 27 janvier 2020,
à l'occasion du 75e anniversaire de la libération
des prisonniers d'Auschwitz par l'armée
soviétique, également connue sous le nom de
Journée internationale de commémoration en mémoire
des victimes de l'holocauste, le conseil municipal
de Montréal s'est réuni pour discuter d'une motion
visant à adopter la définition de travail de
l'IHRA de l'antisémitisme présentée par Lionel
Perez, chef de l'opposition officielle et chef par
intérim de l'Ensemble Montréal (anciennement
Équipe Denis Coderre pour Montréal), à la suite de
la défaite de Coderre aux élections municipales de
2017. Un piquetage devant l'hôtel de ville de
Montréalqui comprenait des membres de Palestiniens
et Juifs unis (PAJU), de Voix juives
indépendantes, du Parti communiste du Canada
(marxiste-léniniste) et d'autres forces
progressistes, s'est opposé à l'adoption de la
définition de l'IHRA.
À l'hôtel de ville de Montréal, trois citoyens
ont été choisis par tirage au sort pour poser des
questions sur la motion. Une personne s'est
identifiée comme la fille d'immigrants juifs
soviétiques dont les membres de la famille « ont
survécu et n'ont pas survécu » à l'Holocauste, une
autre comme la fille de « survivants et réfugiés
du gouvernement et de l'État allemands, des camps
de concentration et de la violence », et une
troisième comme membre de Voix juives
indépendantes[1].
L'une d'elles a noté que la définition
opérationnelle de l'IHRA « criminalise activement
les Palestiniens et les organisations
pro-palestiniennes et antisionistes » et «
obscurcit et détourne l'attention des
manifestations très violentes d'antisémitisme et
d'islamophobie, alors que les groupes
suprémacistes blancs comme Atalante et La Meute
marchent dans les rues de Montréal et de Québec et
sont souvent protégés par la police et prennent
leurs positions idéologiques des mêmes idéologies
qui ont permis l'Holocauste ». Elle a demandé
quand la ville pointerait du doigt les agents
actifs de l'antisémitisme comme les groupes
suprémacistes blancs[2].
Un autre participant a noté l'importance du débat
public, du débat et de la critique concernant les
actions et les politiques de tout État, y compris
Israël, et s'est demandé comment le débat public
et les manifestations contre Israël seraient
assurés et les voix palestiniennes entendues si la
définition de l'IHRA était adoptée.
Perez a répondu que la définition avait été
élaborée pendant 12 ans par environ 30 pays,
l'ONU, l'UNESCO et l'Union européenne. « Nous
avons tous les grands pays démocratiques, y
compris le Canada, qui l'ont adopté, et devinez
quoi ? Ils n'ont pas de souci que cela va entraver
la liberté d'expression. » Il a ajouté que même si
la critique d'Israël était bonne, si « vous
commenciez à incorporer des éléments de haine,
lorsque vous utilisez des tropes d'antisémitisme
[des éléments de conspiration], lorsque vous
commencez à parler de messages subliminaux, c'est
là que la haine entre[3]. »
En réponse à une question sur la façon de
garantir que les gens auront toujours le droit
d'étiqueter les États – que ce soit le Canada
ou Israël – comme des États racistes si la
définition est adoptée, il a répondu : « Nous
pouvons » et « devons nous en remettre à nos
institutions », et que « pour nous, cela montre
que c'est tout à fait légitime et qu'il s'agit
toujours [...] de trouver un équilibre et dans une
société libre et démocratique, ça se trouve[4]
».
Un des intervenants a demandé : « Ne pouvons-nous
pas avoir une conception plus large de
l'antisémitisme qui y voit une sorte de haine qui
n'est pas très différente de l'islamophobie ou de
l'homophobie ou de toutes les autres formes de
haine, car elle cible toutes les formes de haine
et ne divise pas les communautés [5]
? »
Le lendemain du dépôt par Perez de sa motion,
l'administration de la Ville de Montréal a décidé
de la renvoyer en comité pour étude, où elle est
restée depuis.
Cette année encore le 27 janvier, à l'occasion du
jour du Souvenir de l'Holocauste, lors d'une
réunion spéciale du conseil d'arrondissement
Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce dans l'ouest
de Montréal, dont Perez est membre, la « Motion
adoptant la définition opérationnelle de
l'antisémitisme » de l'Alliance internationale
pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA) » a été
adoptée[6].
Parmi les considérations contenues dans la
motion, on constate que « en 2015, la Ville de
Montréal a créé le Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence, qui a comme
objectif de prévenir la radicalisation menant à la
violence et les comportements à caractère haineux
». Une autre est que « à la suite de la Table
ronde de Montréal de 2015 sur la lutte contre
l'antisémitisme, le Service de police de Montréal
a établi en 2016, un Module incidents et crimes
haineux lui permettant d'enquêter plus
efficacement les signalements et plaintes reçues
en matière d'incidents et de crimes haineux ». On
peut également y lire que « en novembre 2020, le
Canada a créé le poste d'envoyé spécial pour la
préservation de la mémoire de l'Holocauste et la
lutte contre l'antisémitisme en y nommant
l'honorable Irwin Cotler, ancien ministre fédéral
de la Justice, et ce dernier mènera la délégation
du gouvernement du Canada auprès de l'IHRA ». Une
autre considération encore est que « ces dernières
années, il y a eu recrudescence des attaques
antisémites dans le monde et au Canada [7]
».
Une des résolutions de la motion stipule que « la
direction de l'arrondissement diffuse la
définition auprès des services pour qu'elle soit
utilisée selon leurs besoins respectifs ». La
motion adoptant la définition de l'antisémitisme
de l'IHRA décide également « que l'arrondissement
de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce
demande à l'administration de la Ville de Montréal
et au conseil municipal d'adopter la définition de
l'antisémitisme de l'IHRA dans les plus brefs
délais[8]. »
Le lendemain, une lettre à la rédaction a paru
dans le Montreal Gazette applaudissant
Perez et l'arrondissement d'avoir adopté la
définition de l'IHRA. Entre autres, il était dit :
« Nous encourageons les autres arrondissements et
la Ville de Montréal à emboîter le pas ». La
lettre ajoutait : « Nous travaillons avec le
gouvernement du Québec pour produire un guide
pédagogique universel sur le thème du génocide, y
compris l'Holocauste. » Il a déclaré que le guide
« aidera les jeunes à comprendre la signification
et les conséquences ultimes de la haine afin
qu'ils reconnaissent les signes avant-coureurs du
génocide et empêchent l'histoire de se répéter ».
Il a été signé par un membre de « la Fondation
pour l'étude des génocides, Montréal [9]
».
La mission de la Fondation « est de collaborer
avec les gouvernements afin que l'histoire des
génocides et les étapes qui y mènent soient
enseignées dans toutes les écoles secondaires au
Canada et aux États-Unis[10]
». Ses partenaires sont le Centre de prévention de
la radicalisation menant à la violence ainsi que
l'Institut montréalais d'études sur les génocides
et les droits de la personne qui avait organisé en
octobre 2019 la visite à l'Université Concordia du
faux-ambassadeur du Venezuela.
Le 25 juin 2019, sans consultation préalable
auprès des Canadiens ni même à la Chambre des
communes, le gouvernement libéral de Justin
Trudeau a adopté la définition de l'antisémitisme
de l'IHRA dans le cadre de « Construire une
fondation pour le changement : la stratégie
canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022 ».
Un an et demi plus tard, Trudeau a nommé Irwin
Cotler « envoyé spécial du Canada pour la
préservation du souvenir de l'Holocauste et la
lutte contre l'antisémitisme ». Cotler dirige la
délégation du gouvernement du Canada auprès de
l'IHRA[11].
Il est important de s'informer la question,
discute de ces questions avec ses collègues, amis,
voisins et familles et mette tout en oeuvre pour
bloquer le passage de la définition opérationnelle
de l'IHRA sur l'antisémitisme, que ce soit au
niveau municipal ou au sein de nos établissements
d'enseignement.
Des affirmations prétentieuses de lutte contre la
haine et l'intolérance et la défense des droits
humains sont utilisées par le gouvernement
canadien pour dissimuler le fait que l'une de ses
principales priorités a été et continue d'être la
défense du sionisme israélien, ainsi que la
criminalisation de ceux qui défendent les droits
des Palestiniens et d'autres. Cela ne doit pas
passer !
Notes
1. Conseil
municipal, lundi 27 janvier 2020, 19 h
2. Ibid
3. Ibid
4. Ibid
5. Ibid
6. Arrondissement
Côte-des-Neiges -- Notre-Dame-de-Grâce,
Séance extraordinaire du conseil
d'arrondissement), 27 janvier 2021, pages
156-158
7. Ibid
8. Ibid
9. Montreal
Gazette, « Education is key to
fighting hate », 28 janvier 2021
10. La
fondation pour l'étude des génocides
11. Les pays suivants
ont adopté la définition de l'IHRA de
l'antisémitisme (en date de février 2021) :
Albanie, Allemagne, Argentine, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Espagne,
France, Grèce, Guatemala, Hongrie, Israël,
Italie, Kosovo, Lituanie, Luxembourg,
Macédoine du Nord, Moldova, Pays-Bas,
Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie,
Suède, République Tchèque et Uruguay.

À la fin du mois de mars, les Professeurs juifs
du Canada contre l'adoption de la définition
opérationnelle de l'antisémitisme de l'Alliance
internationale pour la mémoire de l'Holocauste
(IHRA), un groupe d'environ 150 membres du corps
professoral juif à l'échelle du Canada, a publié
une déclaration s'opposant à la définition
opérationnelle de l'antisémitisme de l'Alliance
internationale pour la mémoire de l'Holocauste de
l'IIHRA.
Voix juives indépendantes Canada (VJIC) souligne
: « La définition de l'IHRA a suscité une
controverse majeure au Canada et à travers le
monde pour avoir confondu la critique et
l'opposition légitimes aux politiques du
gouvernement israélien avec l'antisémitisme. »
VJIC indique que ce groupe de professeurs juifs «
ajoutent leurs noms à plus de 600 universitaires
canadiens, à près de 20 associations de
professeurs et syndicats universitaires canadiens
et à de nombreuses organisations de la société
civile comme l'Association des libertés civiles de
la Colombie-Britannique et le Congrès du travail
du Canada qui ont adopté des positions similaires[1]
».
Le LML mensuel reproduit ci-dessous leur
déclaration :
« Nous vous écrivons en tant que professeurs
juives/juifs d'universités et de collèges de
partout au Canada pour vous faire part de notre
profonde inquiétude quant à certaines
interventions récentes sur nos campus concernant
les relations israélo-palestiniennes. Nous croyons
qu'il est impératif, à ce moment-ci de l'Histoire,
de combattre toutes les formes de racisme et de
discrimination, y compris bien sûr
l'antisémitisme. L'histoire familiale de plusieurs
signataires a d'ailleurs été profondément et
intimement marquée par l'Holocauste. C'est donc
sur la base d'un engagement ferme en faveur de la
justice que nous écrivons ceci; un engagement qui,
pour certains d'entre nous, doit être au coeur
d'une vie juive menée éthiquement.
« Nous nous joignons au mouvement international
grandissant d'universitaires juives/juifs qui
insistent pour que les politiques universitaires
conçues pour combattre l'antisémitisme ne soient
pas employées pour étouffer les critiques
légitimes de l'État israélien ou réprimer le droit
de se montrer solidaires du peuple palestinien.
Nous considérons que le mouvement de Boycott,
Désinvestissement et Sanctions (BDS) est une forme
de protestation non violente légitime. Bien que
nous n'approuvions pas unanimement le mouvement
BDS, nous nous opposons à ce que celui-ci soit
assimilé à une forme de soutien pour
l'antisémitisme. Nous sommes par ailleurs
profondément choqué.es par la recrudescence, au
cours des dernières années, de gestes à caractère
antisémite qui prennent des formes tristement
familières.
« Nous nous inquiétons particulièrement des
récents efforts de lobbying menés sur nos campus
pour faire adopter la définition de
l'antisémitisme utilisée par l'Alliance
internationale pour la mémoire de l'Holocauste
(IHRA). La manière vague dont l'IHRA redéfinit
l'antisémitisme a certainement de quoi inquiéter
: 'une certaine perception des Juifs qui peut
se manifester par une haine à leur égard' et peut
viser 'des individus juifs ou non juifs et/ou
leurs biens'. Mais le principal problème, à notre
avis, est que la définition vient avec une série
d'exemples dont plusieurs ne sont en fait que des
critiques de l'État israélien. C'est pour cette
raison précisément que la définition de l'IHRA est
l'objet de vives critiques. En plus
d'essentialiser l'identité, la culture et la
théologie juives, elle assimile la judéité et le
judaïsme à l'État d'Israël, effaçant ainsi un
débat qui perdure depuis plusieurs générations au
sein des communautés juives. La question est
d'autant plus pressante que la définition de
l'IHRA a d'ores et déjà été invoquée par des
groupes et des individus qui désirent interférer
avec la gouvernance collégiale et la vie étudiante
dans les universités canadiennes. De plus, la
définition de l'IHRA détourne l'attention des
véritables incidents de racisme anti-juif et
menace de réduire au silence toute critique
légitime des graves violations du droit
international commises par Israël, en particulier
son déni des droits humains et politiques des
Palestiniens.
« Sur les campus où cette définition a été
adoptée, elle a été employée pour intimider et
réprimer les syndicats, les associations
étudiantes, les départements et les associations
facultaires qui sont résolument engagés en faveur
de la liberté, de l'égalité et de la justice pour
le peuple palestinien. Un grand nombre
d'institutions juives internationales ont déjà
reconnu ce problème. Par exemple, le New Israel
Fund of Canada a récemment retiré son appui à la
définition de l'IHRA. Le conseil académique de la
University College de Londres (UCL) a recommandé
que l'université cherche une autre définition de
l'antisémitisme et infirme la décision d'adopter
le modèle de l'IHRA. Le conseil académique de
l'UCL se joint ainsi à un mouvement croissant, qui
compte plus de 500 universitaires canadiens, des
universitaires juifs et israéliens, des
universitaires britanniques de citoyenneté
israélienne et des spécialistes de l'histoire du
peuple juif et de l'Holocauste, pour s'opposer à
l'adoption de la définition de l'antisémitisme
mise de l'avant par l'IHRA.
« Nous sommes bien conscients que les désaccords
qui existent sur nos campus au sujet de
l'antisémitisme et des critiques de l'État
d'Israël sont importants et parfois acrimonieux.
Ces disputes, toutefois, ne seront pas résolues
par décret. Si le but de l'adoption de la
définition de l'IHRA est d'apaiser les conflits
entourant la portée des critiques à l'endroit
d'Israël, elle est assurément vouée à l'échec.
Cela s'est d'ailleurs déjà avéré dans de
nombreuses institutions. »
La déclaration est aussi disponible en français,
hébreu et en arabe. Voir la liste
des signataires ou la déclaration dans une des
autres langues
Notes
1. Le 9
mars, VJI était parmi les 27 organisations
antiracistes basées à Montréal qui ont envoyé
une lettre ouverte à la mairesse Valérie
Plante et au conseil municipal de Montréal,
exigeant qu'ils prennent position contre la
définition de l'antisémitisme dangereusement
trompeuse de l'Alliance internationale pour la
mémoire de l'Holocauste (IHRA). Bien qu'aucune
motion pour adopter l'IHRA n'ait été présentée
à la réunion de mars, les gens restent
vigilants quant à la possibilité qu'une telle
motion puisse encore être présentée. Pour lire
la lettre ouverte, cliquer
ici.
(Professeurs juives et juifs
du Canada contre l'adoption de la définition
opérationnelle de l'IHRA de l'antisémitisme)

Solidarité avec Cuba
 Le Réseau canadien
pour Cuba (RCC) prépare l'expédition à Cuba d'un
conteneur de 1 920 000 seringues en appui au
programme de vaccination de ce pays contre la
COVID-19. Cette initiative fait partie de la
campagne de collecte de fonds lancée par le RCC le
8 janvier pour faire parvenir de l'équipement
médical à Cuba. Cette campagne de solidarité a
reçu l'appui d'un grand nombre d'amis canadiens,
de Cubains et de citoyens d'autres pays résidant
au Canada. Le Réseau canadien
pour Cuba (RCC) prépare l'expédition à Cuba d'un
conteneur de 1 920 000 seringues en appui au
programme de vaccination de ce pays contre la
COVID-19. Cette initiative fait partie de la
campagne de collecte de fonds lancée par le RCC le
8 janvier pour faire parvenir de l'équipement
médical à Cuba. Cette campagne de solidarité a
reçu l'appui d'un grand nombre d'amis canadiens,
de Cubains et de citoyens d'autres pays résidant
au Canada.
À l'annonce de cette action de solidarité avec le
peuple cubain, le RCC a reconnu les réalisations
de Cuba en soins de santé et ses contributions aux
autres pays pendant la pandémie.
L'envoi est très apprécié par Cuba qui fait face
à une double pandémie : la COVID-19 et le blocus
brutal imposé par les États-Unis. À cause du
blocus américain, qui a atteint des niveaux sans
précédent, Cuba n'a pas pu se procurer des
médicaments et l'équipement médical nécessaires
pour faire face à la pandémie de la COVID-19, sans
parler des difficultés économiques causées par le
blocus illégal des États-Unis. Tout ceci crée de
grandes souffrances pour le peuple cubain.
Au nom du peuple cubain, l'ambassade de Cuba au
Canada a remercié le RCC et les donateurs à la
campagne pour leur solidarité.
Contribuez à la campagne pour envoyer
de l'équipement médical à Cuba
Le RCC accepte des dons par chèque ou par
transfert électronique, comme suit :
1) Faire le chèque à l'ordre de RCC et indiquer :
pour équipement médical. Envoyez à :
CNC c/o Sharon Skup
56 Riverwood Terrace
Bolton, ON L7E 1S4
2) Faire parvenir un montant par transfert
électronique à donate@canadiennetworkoncuba.ca.
Indiquer « équipement médical » dans le message.
IMPORTANT : Faire aussi parvenir un courriel à
Sharon Skup ou lui téléphoner au 905-951-8499 avec
l'épellation exacte de votre mot de passe/réponse
secrète et votre nom pour qu'elle puisse ouvrir
votre transfert électronique.

Les Canadiens intensifient leur appui à
l'héroïque peuple cubain en ces temps difficiles.
En plus des piquetages virtuels et en présentiel
le 17 de chaque mois, le 28 mars, pour le deuxième
mois consécutif, les gens partout au Canada ont
participé à la caravane internationale Puentes de
Amor-Ponts d'amour pour exiger que cessent le
blocus américain et les autres sanctions contre
Cuba. Des caravanes ont été organisées à Montréal,
Ottawa, Toronto, Winnipeg, Calgary, Vancouver et
Victoria pour exiger que cesse cette politique que
les peuples américain et canadien jugent
irrationnelle et criminelle, et que la vaste
majorité de la communauté internationale rejette.
Montréal

Ottawa

Toronto
 
Winnipeg

Calgary
 
Vancouver

Victoria

(Photos : Association des
résidents cubains au Canada, M.B. Diaz, D.
Peninda, M. Gorgzadeh)

Solidarité internationale avec le
peuple haïtien
- Correspondant du LML -
 
Des dizaines de Montréalais ont répondu à l'appel
de la Coalition haïtienne au Canada contre la
dictature en Haïti pour manifester leur solidarité
avec le peuple haïtien le 29 mars, de 11 h à 13 h,
devant le consulat d'Haïti à Montréal. Les vents
glaciaux et violents qui déchiraient les pancartes
et faisaient perdre l'équilibre aux gens n'ont eu
aucun impact sur la vigueur et la détermination
des manifestants.
 La manifestation
s'inscrivait dans le cadre de la Journée
internationale de solidarité avec Haïti au cours
de laquelle des actions se sont tenues à Ottawa, à
Boston, Chicago, New York, Atlanta, Miami aux
États-Unis, à Saint-Domingue en République
dominicaine, à San Juan à Porto Rico, à Caracas au
Venezuela, à Santiago au Chili et à Buenos Aires
en Argentine. Partout, les manifestants ont
exprimé leur soutien au peuple haïtien qui lutte
avec courage contre le diktat du président de
facto, Jovenel Moïse, et contre l'ingérence
étrangère qui vise à empêcher le peuple de former
un gouvernement en son propre nom qui sert ses
intérêts. La manifestation
s'inscrivait dans le cadre de la Journée
internationale de solidarité avec Haïti au cours
de laquelle des actions se sont tenues à Ottawa, à
Boston, Chicago, New York, Atlanta, Miami aux
États-Unis, à Saint-Domingue en République
dominicaine, à San Juan à Porto Rico, à Caracas au
Venezuela, à Santiago au Chili et à Buenos Aires
en Argentine. Partout, les manifestants ont
exprimé leur soutien au peuple haïtien qui lutte
avec courage contre le diktat du président de
facto, Jovenel Moïse, et contre l'ingérence
étrangère qui vise à empêcher le peuple de former
un gouvernement en son propre nom qui sert ses
intérêts.
Jeunes et moins jeunes de tous les horizons, y
compris de nombreux Québécois de la communauté
haïtienne, ont clairement indiqué qu'ils étaient
déterminés à appuyer le peuple haïtien et à
s'opposer à l'impérialisme, y compris à
l'ingérence du Canada, de l'ONU, du Core Group[1] et de
l'Organisation des États américains.
Plusieurs militants de la Coalition se sont
adressés à la foule en français et en kreyòl
ayisyen (créole haïtien). Un accent particulier a
été mis sur le rôle insidieux du gouvernement
canadien qui soutient la dictature et finance des
élections frauduleuses pour défendre des intérêts
économiques privés, en utilisant l'argent de nos
impôts. « Pas en notre nom ! », ont-ils dit. Ils
ont souligné que les peuples du Québec et du
Canada sont contre cette politique étrangère et se
tiennent aux côtés du peuple haïtien dans son
combat pour la justice et la dignité. Des appels
ont été lancés pour informer amis, voisins et
collègues de la lutte et pour les encourager à se
mobiliser pour aider à mettre fin à l'ingérence
antidémocratique du Canada.
Les discours étaient entrecoupés, et fréquemment
interrompus, par des slogans militants en français
et en créole et par les voitures, taxis et camions
klaxonnant pour exprimer leur soutien. Les gens
scandaient des slogans tels que : « Non à la
dictature ! », « Solidarité avec le peuple haïtien
! », « Vive Haïti libre ! », « Jovenel répressif,
Trudeau complice ! », « Non à l'ingérence du
Canada ! » et « Non au Core Group ! ». Les
participants ont exprimé leur détermination à
poursuivre et à amplifier les actions de soutien
au peuple haïtien à la défense de son droit
d'être.
Le Canada doit cesser d'appuyer le gouvernement
corrompu de Jovenel Moïse

 Le 21 mars dernier
à 13 heures, plusieurs dizaines de personnes se
sont rassemblées devant le bureau de Montréal de
Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères du
Canada, pour exiger du gouvernement canadien qu'il
cesse son appui au gouvernement corrompu de
Jovenel Moïse, lors d'une action organisée par
Solidarité Québec-Haïti. La politique étrangère du
Canada envers Haïti est une politique raciste et
néocoloniale, ont souligné plusieurs des
intervenants qui ont pris parole durant l'action.
L'« aide » que dit apporter le gouvernement
canadien est une ingérence ouverte dans les
affaires internes du peuple haïtien et une façon
de bloquer les efforts des Haïtiens d'établir
eux-mêmes les types d'arrangements politiques qui
les favorisent au lieu de favoriser les intérêts
privés des impérialistes américains et de leurs
laquais, dont le Canada fait partie. Le 21 mars dernier
à 13 heures, plusieurs dizaines de personnes se
sont rassemblées devant le bureau de Montréal de
Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères du
Canada, pour exiger du gouvernement canadien qu'il
cesse son appui au gouvernement corrompu de
Jovenel Moïse, lors d'une action organisée par
Solidarité Québec-Haïti. La politique étrangère du
Canada envers Haïti est une politique raciste et
néocoloniale, ont souligné plusieurs des
intervenants qui ont pris parole durant l'action.
L'« aide » que dit apporter le gouvernement
canadien est une ingérence ouverte dans les
affaires internes du peuple haïtien et une façon
de bloquer les efforts des Haïtiens d'établir
eux-mêmes les types d'arrangements politiques qui
les favorisent au lieu de favoriser les intérêts
privés des impérialistes américains et de leurs
laquais, dont le Canada fait partie.
Le gouvernement canadien doit rendre des comptes
pour les sommes d'argent énormes qu'il met à la
disposition des forces de la répression en Haïti.
Les manifestants ont pu aussi apprendre qu'une
pétition exigeant de « 1. publier tous les
documents relatifs à 'l'Initiative d'Ottawa
sur Haïti'; 2. tenir une audience du Comité
permanent des affaires étrangères et du
développement international pour déterminer
exactement les tenants et aboutissements
de 'l'Initiative d'Ottawa sur Haïti',
incluant les liens avec le 'Core Group' »,
allait être déposée le 22 mars au Parlement par le
député du Bloc Québécois de la circonscription de
la Pointe-de-l'Ȋle, Mario Beaulieu.
Les passants et les automobilistes ont été
nombreux à manifester leur appui aux demandes des
participants.
Actions de solidarité aux États-Unis
Boston, Massachusetts

Washington, DC

New York, New York
 
Chicago, Illinois

Notes
1. Le
Core Group est composé du représentant spécial
du secrétaire général des Nations unies, des
ambassadeurs du Brésil, du Canada, de la
France, de l'Allemagne, de l'Espagne, de
l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique
et du représentant spécial de l'Organisation
des États américains.


Deux jours de mobilisation de masse ont eu lieu à
travers Haïti les 28 et 29 mars, ainsi qu'au sein
de la diaspora à l'étranger. Leurs actions sont
basées sur la revendication fondamentale que le
peuple haïtien doit pouvoir exercer son droit de
décider de son propre avenir, au sein duquel il
réclame la fin de l'ingérence étrangère et la
suppression du régime illégitime du président de
facto Jovenel Moïse qui reste au pouvoir avec le
soutien des États-Unis, du Canada et d'autres
pays. Outre ces revendications, les deux jours de
contestation ont spécifiquement dénoncé les
projets du régime de facto de Jovenel Moïse pour
un référendum visant à amender la Constitution de
1987.
 Le pasteur Gérald
Bataille, un des initiateurs de l'action du 28
mars, s'est dit alarmé par la situation au pays. «
La patrie est en danger. Nous sommes sous le joug
de la dictature, des persécutions et de
l'insécurité. Nous sommes dirigés par un
gouvernement illégal. Le mandat de ce président
est arrivé à terme depuis le 7 février. Voilà
pourquoi nous sommes dans les rues. Pour crier
notre détresse et notre colère », a-t-il dit au
journal haïtien Le Nouvelliste. Il a
déclaré que les Haïtiens peuvent se gouverner
eux-mêmes et qu'aucun problème auquel est
confronté le pays ne peut être résolu avec Jovenel
Moïse au pouvoir. « Le dialogue est le point de
départ de toutes les solutions. Toutefois aucun
dialogue n'est possible avec ce monsieur (Jovenel
Moïse) », a-t-il dit. Le pasteur Gérald
Bataille, un des initiateurs de l'action du 28
mars, s'est dit alarmé par la situation au pays. «
La patrie est en danger. Nous sommes sous le joug
de la dictature, des persécutions et de
l'insécurité. Nous sommes dirigés par un
gouvernement illégal. Le mandat de ce président
est arrivé à terme depuis le 7 février. Voilà
pourquoi nous sommes dans les rues. Pour crier
notre détresse et notre colère », a-t-il dit au
journal haïtien Le Nouvelliste. Il a
déclaré que les Haïtiens peuvent se gouverner
eux-mêmes et qu'aucun problème auquel est
confronté le pays ne peut être résolu avec Jovenel
Moïse au pouvoir. « Le dialogue est le point de
départ de toutes les solutions. Toutefois aucun
dialogue n'est possible avec ce monsieur (Jovenel
Moïse) », a-t-il dit.
Le Nouvelliste a parlé avec une femme
quadragénaire durant la marche de protestation du
28 mars à Port-au-Prince, qui a dénoncé la gestion
« calamiteuse » du régime Moïse. « La situation
s'est dégradée avec Jovenel Moïse au pouvoir. Les
écoles ne peuvent plus fonctionner comme avant.
Nous ne sommes plus libres de circuler librement.
Mes fils sont obligés de retourner en province en
raison de l'insécurité. Je ne peux plus mener mes
activités au marché de Croix-des-Bossales à cause
des tirs », a-t-elle déploré.

Un autre manifestant a dit au Nouvelliste
que « Nous n'avons pas un problème de constitution
dans le pays. Ce référendum est une stratégie
utilisée par le PHTK [Parti Haïtien Tèt Kale] pour
se renouveler et se maintenir au pouvoir. C'est
une perte de temps. Le peuple s'opposera et doit
s'opposer à ce projet macabre. Nous avons d'autres
problèmes qui sont plus urgents tels que le
chômage, l'insécurité, la vie chère. On doit
savoir choisir les priorités »,
Des personnalités politiques ont également pris
part à la marche du 28 mars. L'ancien candidat à
la présidence Jean-Charles Moïse a demandé aux
Haïtiens de défendre la Constitution de 1987. «
Cette Constitution a 34 ans. On ne peut pas
permettre à un dictateur de la changer. Nous
sommes contre ce référendum. Nous demandons par
conséquent au peuple de se mobiliser contre ce
projet dictatorial, contre ce dictateur et contre
les étrangers qui tiennent le pays en otage »,
a-t-il déclaré.
 Schultz Simpssie
Cazir, secrétaire général du Parti du mouvement de
la troisième voie (MTV), s'est insurgé contre la
situation du pays. « Ma présence dans les rues
aujourd'hui est pour dénoncer et protester
énergiquement contre l'insécurité, les
persécutions et l'intimidation politiques, la
corruption, l'impunité et les multiples cas de
violation de la Constitution par un pouvoir
illégitime qui agit en toute illégalité. Marcher
pacifiquement aujourd'hui pour moi exprime mon
rejet du plan dictatorial de Jovenel Moïse de nous
imposer une constitution à travers un référendum
inconstitutionnel, sans un large consensus avec
les forces vives du pays », a-t-il dit. Schultz Simpssie
Cazir, secrétaire général du Parti du mouvement de
la troisième voie (MTV), s'est insurgé contre la
situation du pays. « Ma présence dans les rues
aujourd'hui est pour dénoncer et protester
énergiquement contre l'insécurité, les
persécutions et l'intimidation politiques, la
corruption, l'impunité et les multiples cas de
violation de la Constitution par un pouvoir
illégitime qui agit en toute illégalité. Marcher
pacifiquement aujourd'hui pour moi exprime mon
rejet du plan dictatorial de Jovenel Moïse de nous
imposer une constitution à travers un référendum
inconstitutionnel, sans un large consensus avec
les forces vives du pays », a-t-il dit.
Maryse Narcisse, la porte-parole du Parti Fanmi
Lavalas, a dit au Nouvelliste que le
président Jovenel Moïse n'a aucune légitimité pour
changer la Constitution. « C'est un président de
facto. Il n'a aucun droit pour convoquer un
référendum pour changer la Constitution »,
a-t-elle déclaré, appelant à l'intensification de
la mobilisation contre Jovenel Moïse.

Ce 29 mars, le jour du 34e anniversaire de la
Constitution de 1987, les manifestants sont
demeurés dans les rues. Certains ont apporté des
exemplaires de la Constitution de 1987 en signe de
leur engagement à la défendre. « À bas faux
référendum. À bas fausse constitution »,
scandaient-ils. La police a fait usage de gaz
lacrymogène et de balles en caoutchouc pour
disperser les manifestants dans l'aire du Champ de
Mars à Port-au-Prince.
Un sit-in a eu lieu à l'entrée du marché communal
de Jacmel (ville principale du département sud-est
d'Haïti), pour exiger le respect de la
Constitution. « L'Organisation des États
américains (OÉA) et le Bureau intégré des Nations
unies en Haïti (BINUH) = système d'exploitation
[d'Haïti]. Haïti ne retournera pas à la dictature.
Non à l'insécurité », figuraient parmi les
messages sur les banderoles lors de l'action.
Les manifestants ont déclaré qu'ils fermeraient
le pays si le régime de facto poursuit ses plans
pour une nouvelle Constitution qu'il a rédigée
unilatéralement.



Les manifestations se poursuivent en Haïti, le 1er
avril 2021. (C. Sylvain)
Au secrétaire général des Nations unies,
António Guterres
Au secrétaire général de l'OÉA, Luis Almagro
Aux gouvernements des pays membres de l'ONU
et de l'OÉA
Au peuple d'Haïti et à ses organisations
Haïti est une fois de plus au coeur d'une crise
très profonde. Actuellement, un élément central de
cette crise est la lutte contre la dictature
imposée par l'ancien président Jovenel Moïse.
Depuis l'année dernière, après avoir décrété la
cessation des activités du Parlement, celui-ci
gouverne par décret, violant ainsi de manière
permanente la constitution du pays. Ainsi, par
exemple, il refuse de quitter le pouvoir alors que
son mandat a expiré le 7 février 2021, prétendant
qu'il prend fin le 7 février de l'année prochaine,
sans aucune base juridique. Il le fait malgré les
multiples prises de position contre lui des
principales instances juridiques du pays, telles
que le CSPJ (Conseil Supérieur du Pouvoir
Judiciaire), la Fédération qui regroupe les
Barreaux haïtiens, ainsi que les Fédérations
religieuses et de nombreuses institutions
représentatives de la société. À cette époque, en
outre, il y a eu une grève des fonctionnaires de
la Justice qui a laissé le pays sans aucun organe
judiciaire en fonctionnement.
En même temps, cette crise institutionnelle
s'inscrit dans le cadre d'une insécurité qui
touche pratiquement tous les secteurs de la
société haïtienne. Une insécurité qui s'exprime
par la répression sauvage des mobilisations
populaires par la PNH (Police Nationale d'Haïti) à
la botte de l'Exécutif, par des attaques contre
les journalistes, par différents massacres dans
les quartiers populaires, par des assassinats et
des arrestations arbitraires d'opposants, par
l'arrestation d'un juge de la Cour de cassation
sous le prétexte qu'il fomentait un prétendu
complot contre la sécurité de l'État et pour
l'assassiner, par la révocation illégale et
arbitraire de trois juges de cette Cour, par la
création de centaines de groupes armés qui sèment
la terreur sur tout le territoire national et qui
répondent au pouvoir, transformant l'enlèvement de
personnes en une industrie très prospère pour ces
criminels.
Les 13 années d'occupation militaire par les
troupes des Nations unies par le biais de la
MINUSTAH, ainsi que les opérations de prolongation
d'une situation de tutelle par le biais de la
MINUJUSTH (Mission des Nations unies pour l'appui
à la Justice en Haïti) et du BINUH (Bureau intégré
des Nations Unies en Haïti) ont aggravé la crise
haïtienne, en soutenant les secteurs rétrogrades,
anti-démocratiques et mafieux. En outre, ils ont
commis des crimes graves contre la population
haïtienne et ses droits fondamentaux (comme
l'introduction du choléra) pour lesquels il faut
établir des processus de justice et de réparation
exemplaires. Le peuple haïtien a payé très cher
l'intervention de la MINUSTAH : 30 000 MORTS du
choléra transporté par les soldats, des milliers
de femmes violées, qui ont maintenant des enfants
orphelins de pères en vie mais retournés dans
leurs pays d'origine. Rien n'a changé de manière
positive en 13 ans, plus d'inégalité sociale, plus
de pauvreté, plus de difficultés pour le peuple et
l'absence de démocratie.
Les conditions de vie des secteurs populaires se
sont considérablement détériorées à la suite de
plus de 30 années de politiques néolibérales
imposées par les institutions financières
internationales (IFI), par une grave crise du taux
de change, par le gel du salaire minimum et par un
taux d'inflation de plus de 20 % au cours des
trois dernières années.
Malgré cette situation dramatique, le peuple
haïtien reste ferme et se mobilise constamment
pour empêcher la consolidation de cette dictature
en exigeant le départ immédiat de l'ancien
président Jovenel Moïse. Récemment, les 14 et 28
février, des centaines de milliers de citoyens ont
clairement exprimé dans la rue leur rejet de la
dictature et leur ferme engagement à respecter la
Constitution.
Compte tenu de l'importance de cette lutte et du
fait que ce régime dictatorial bénéficie toujours
du soutien de gouvernements impérialistes tels que
les États-Unis, le Canada, la France et
d'organisations internationales telles que l'ONU,
l'OEA, l'Union européenne et le FMI, nous appelons
à écouter le peuple haïtien qui exige la fin de la
dictature ainsi que le respect de sa souveraineté
et de son autodétermination et l'établissement
d'un régime de transition politique contrôlé par
les acteurs haïtiens qui disposerait d'un espace
suffisant pour lancer un processus de véritable
reconstruction nationale.
Nous demandons à l'ONU et à l'OÉA – qui n'a
certainement ni le droit ni le droit moral de
s'ingérer dans les élections et autres affaires
internes des pays membres – et aux
gouvernements de tous les pays, en particulier
ceux qui se sont offerts pour « occuper » Haïti
pendant 13 ans, par le biais de la MINUSTAH, de
cesser de se comporter comme si Haïti était leur
colonie. Assez d'ingérence ! Leur devoir est autre
: assurer la justice et la réparation de tous les
crimes qu'ils ont commis contre ce peuple et ce
pays, notamment l'introduction du choléra, les
viols et les abus sexuels, l'impunité de leur
manipulation électorale et l'utilisation de la «
coopération » à leurs propres fins.
Seul le peuple haïtien peut décider de son
avenir, mais dans ce parcours, il peut compter sur
notre solidarité et notre volonté de le soutenir
par toutes les actions à notre portée. Nous
soutenons le peuple et les mouvements d'Haïti afin
qu'ils puissent élire un gouvernement populaire de
transition et une Constituante de manière
démocratique.
Pour un Haïti libre et
souverain !
Pour télécharger la déclaration ainsi que ses
signataires, cliquer
ici.

45e anniversaire de la Journée de
la terre palestinienne

Célébration de la Journée de la terre en Palestine
le 30 mars 2021
Cette année est le 45e anniversaire de la Journée
de la terre qui commémore les événements du 30
mars 1976, lorsque six Palestiniens de villages
arabes à l'intérieur de la Ligne verte ont été
abattus par des forces israéliennes alors qu'ils
protestaient contre la confiscation de 5 500 acres
de terre de la Galilée. Depuis ce jour, la Journée
de la terre a été commémorée par les Palestiniens
à l'intérieur d'Israël de même qu'en Cisjordanie,
à Gaza et à Jérusalem et partout dans le monde.
Ces actions ont été organisées cette année encore
en dépit des limitations imposées par la pandémie.
En Palestine, des rassemblements et des marches
ont marqué la Journée de la terre en Palestine, en
particulier dans les villes où les six martyrs ont
été tués il y a 45 ans et les Palestiniens ont
déposé des gerbes sur leur tombe. Les médias
locaux rapportent que des dizaines de Palestiniens
ont été arrêtés par les forces israéliennes dans
les villes de Ramallah, Hébron, Jénine, Salfit,
Nilin, Naplouse et Sebastia en Cisjordanie.
Les actions en appui à la Palestine sont encore
plus importantes en ce moment-ci parce que les
sionistes, appuyés et encouragés par les
impérialistes américains et leurs alliés comme le
Canada intensifient leur violation du droit
international et des droits humains des
Palestiniens dans le cadre d'un programme global
de dépossession et de génocide.

Rassemblement de la Journée de la terre près de la
frontière palestino-libanaise
En cette occasion de la Journée de la terre de
2021, Ola Awad, Ph. D., la présidente du Bureau
central palestinien pour les statistiques (BCPS),
a émis une déclaration dans laquelle elle
commémore la Journée de la terre en Palestine par
des données statistiques. Ola Awad souligne que la
confiscation continue par Israël des terres des
Palestiniens signifie que 85 % du territoire total
de la Palestine historique est maintenant sous
contrôle israélien. Elle souligne également que
l'expansion des colonies de peuplement illégales
dans les territoires palestiniens s'accompagne
d'un nombre croissant d'attaques violentes visant
à déplacer les Palestiniens. En 2020, on a signalé
1 090 attaques de ce genre, une augmentation de 9
% par rapport à 2019, qui comprennent la
démolition de propriétés, la destruction de
milliers d'arbres, l'abattage de centaines de
bêtes, les assauts avec véhicules et fusils et les
tentatives d'enlèvement. Les colons commettent ces
attaques sous la protection des soldats
israéliens.
Ola Awad attire l'attention sur la pratique
continue des forces d'occupation de démolir les
édifices palestiniens sous tous les prétextes
possibles, et souligne que « pendant l'année 2020,
l'occupation israélienne a démoli et détruit 976
édifices palestiniens; environ 30 % d'entre eux
étaient dans le gouvernorat de Jérusalem, et, sur
296 démolitions, 180 édifices faisaient partie des
quartiers de Jérusalem. Il y a eu 89 opérations de
démolition d'édifices palestiniens, la plupart
situés dans le gouvernorat de Jérusalem. En 2020,
les forces d'occupation israélienne ont ordonné de
démolir et d'arrêter de construire ou de rénover
environ 1 012 édifices de la Cisjordanie et de
Jérusalem, soit une augmentation de près de 45 %
par rapport à 2019. Les autorités d'occupation
mettent aussi des obstacles à l'émission de permis
de construction aux Palestiniens. »
 En même temps, le
nombre massif de blessures, de détentions et de
décès causés par l'occupation et l'expansion
violente de colonies de peuplement continue de
croître. Selon le BCPS « le nombre de martyrs
palestiniens et arabes tués depuis la Nakba de
1948 jusqu'à la Journée de la terre palestinienne
de 2021 (à l'intérieur et à l'extérieur de la
Palestine) se monte maintenant à environ 100 000.
En plus, le nombre de martyrs tués lors de
l'Intifada Al-Aqsa entre le 29 septembre 2000 et
le 31 décembre 2020 est de 10 969. On dit que
l'année la plus sanglante a été 2014, avec 2 240
martyrs palestiniens, dont 2 181 lors de la guerre
dans la Bande de Gaza. En 2020, il y a eu 43
martyrs palestiniens, dont neuf enfants et trois
femmes. Pendant la même année, environ 1 650
Palestiniens ont été blessés. À la fin de 2020, il
y avait 4 400 détenus palestiniens dans les
prisons sous occupation israélienne, dont 170
enfants et 35 femmes. En ce qui concerne les cas
de détention pendant toute l'année 2020, il y en a
eu environ 4 634, dont 543 enfants et 128 femmes.
» En même temps, le
nombre massif de blessures, de détentions et de
décès causés par l'occupation et l'expansion
violente de colonies de peuplement continue de
croître. Selon le BCPS « le nombre de martyrs
palestiniens et arabes tués depuis la Nakba de
1948 jusqu'à la Journée de la terre palestinienne
de 2021 (à l'intérieur et à l'extérieur de la
Palestine) se monte maintenant à environ 100 000.
En plus, le nombre de martyrs tués lors de
l'Intifada Al-Aqsa entre le 29 septembre 2000 et
le 31 décembre 2020 est de 10 969. On dit que
l'année la plus sanglante a été 2014, avec 2 240
martyrs palestiniens, dont 2 181 lors de la guerre
dans la Bande de Gaza. En 2020, il y a eu 43
martyrs palestiniens, dont neuf enfants et trois
femmes. Pendant la même année, environ 1 650
Palestiniens ont été blessés. À la fin de 2020, il
y avait 4 400 détenus palestiniens dans les
prisons sous occupation israélienne, dont 170
enfants et 35 femmes. En ce qui concerne les cas
de détention pendant toute l'année 2020, il y en a
eu environ 4 634, dont 543 enfants et 128 femmes.
»
En cette occasion de la Journée de la terre
palestinienne de 2021, le Parti communiste du
Canada (marxiste-léniniste) salue le peuple
palestinien et son courage, son ingéniosité et sa
résistance inébranlable à la défense de son droit
d'être et lance l'appel à tous à intensifier leurs
efforts pour développer l'appui à la Palestine.
Vive la lutte du peuple palestinien !

Journée de la Terre à Younis, dans le sud de la
bande de Gaza

Journée de la terre à Gaza, près de la clôture
avec Israël. Il n'y a pas eu d'actions de la
Grande Marche pour le retour cette année à cause
de la pandémie.
Actions de la Journée de la terre en solidarité
avec le peuple palestinien
Liban, Jardin des Martyrs du retour
 
Irak
 
Tunisie


Indonésie

Australie

Angleterre

France
 
Espagne

Suède


- Hilary LeBlanc -
Le 3 mars, la Cour pénale internationale (CPI) de
La Haye a annoncé qu'elle débutera son
enquête sur la « situation en Palestine ».
L'enquête de la CPI est le résultat de requêtes
des Palestiniens, qui sont devenus un « État
partie » de la CPI en 2015.
À la suite de cette requête en 2015, la
procureure en chef de la CPI, Fatou Bensouda, a
commencé un examen préliminaire de la « situation
en Palestine ». Après une enquête approfondie,
elle a conclu, en décembre 2019, qu'elle était
convaincue parce qu'il y avait des preuves
suffisantes que des crimes de guerre ont été
commis dans quatre aspects de l'enquête, soit : 1)
la guerre d'Israël contre Gaza en 2014; 2) les «
colonies » illégales en Cisjordanie, incluant
Jérusalem-Est; 3) les morts de manifestants aux
mains d'Israël à Gaza en 2018-2019; et 4) les tirs
aveugles de roquettes par les Palestiniens.
 Dans son annonce du
3 mars, madame Bensouda écrit : « La décision
d'ouvrir une enquête fait suite à l'examen
préliminaire minutieusement mené par mon bureau
pendant près de cinq ans. Au cours de cette
période, conformément à la pratique établie par le
bureau, ce dernier a été en contact avec un grand
nombre de parties prenantes et a notamment eu
régulièrement des échanges fructueux avec des
représentants des gouvernements palestinien et
israélien. » Dans son annonce du
3 mars, madame Bensouda écrit : « La décision
d'ouvrir une enquête fait suite à l'examen
préliminaire minutieusement mené par mon bureau
pendant près de cinq ans. Au cours de cette
période, conformément à la pratique établie par le
bureau, ce dernier a été en contact avec un grand
nombre de parties prenantes et a notamment eu
régulièrement des échanges fructueux avec des
représentants des gouvernements palestinien et
israélien. »
Elle souligne que l'enquête sera menée « en toute
indépendance, impartialité et objectivité, sans
crainte ni parti pris » et que son bureau «
exercera ses responsabilités conformément à ces
principes et de manière impartiale, comme il l'a
fait pour toutes les situations dont il a été
saisi par le passé ». Elle a ajouté : « En
définitive, ce sont les victimes tant
palestiniennes qu'israéliennes du long cycle de
violence et d'insécurité, qui a causé de profondes
souffrances et un terrible sentiment de désespoir
quel que soit leur camp, qui doivent être au
centre de nos préoccupations. »
La procureure en chef a aussi souligné qu'un soin
méticuleux a été pris pour garantir la portée de
l'enquête. À cet égard, afin « d'obtenir au
préalable une décision judiciaire sur cette
question, car il nous semblait crucial d'obtenir
d'emblée ces précisions afin que les futures
enquêtes reposent sur une base solide et éprouvée
sur le plan juridique », elle a demandé à la
Chambre préliminaire I de la CPI de se prononcer
sur la question. Elle souligne que, le 5 février,
« la Chambre a statué, à la majorité de ses juges,
que la cour pouvait exercer sa compétence pénale
dans la situation en Palestine et que sa
compétence territoriale s'étendait à Gaza et à la
Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est », le
territoire palestinien qu'Israël occupe depuis
1967.
 La décision de la
CPI est historique. Elle est saluée par le peuple
palestinien et toutes les personnes éprises de
justice et de paix au Canada et dans le monde qui
ont pris position depuis plus de 70 ans à la
défense des droits du peuple palestinien. Le
ministre palestinien des Affaires étrangères a dit
: « Ce geste attendu depuis longtemps sert
l'effort vigoureux de la Palestine de réaliser la
justice et la responsabilité en tant que bases
indispensables à la paix. » Il a appelé à une
conclusion rapide de l'enquête à la lumière des
crimes continus des dirigeants de l'occupation
contre le peuple palestinien, lesquels sont «
permanents, systématiques et très étendus ». La décision de la
CPI est historique. Elle est saluée par le peuple
palestinien et toutes les personnes éprises de
justice et de paix au Canada et dans le monde qui
ont pris position depuis plus de 70 ans à la
défense des droits du peuple palestinien. Le
ministre palestinien des Affaires étrangères a dit
: « Ce geste attendu depuis longtemps sert
l'effort vigoureux de la Palestine de réaliser la
justice et la responsabilité en tant que bases
indispensables à la paix. » Il a appelé à une
conclusion rapide de l'enquête à la lumière des
crimes continus des dirigeants de l'occupation
contre le peuple palestinien, lesquels sont «
permanents, systématiques et très étendus ».
L'État sioniste d'Israël a condamné la décision
de la CPI. Le premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu a dit : « La décision de la cour
internationale d'ouvrir une enquête contre Israël
aujourd'hui pour crimes de guerre est absurde.
C'est de l'antisémitisme à l'état pur et le comble
de l'hypocrisie. Israël a entrepris depuis une
campagne internationale pour attaquer la décision
de la CPI sous prétexte que la CPI « n'a pas la
qualité pour agir. Pas de compétence. Pas de
cause. »
Les États-Unis ont la même position. Le
secrétaire d'État Anthony Blinken a dit : « Les
États-Unis s'opposent fermement et sont
profondément déçus de cette décision. La CPI n'a
pas de compétence en cette matière. Israël n'est
pas un État partie de la CPI et n'a pas donné son
consentement à la compétence de la cour, et nous
avons de sérieuses préoccupations en ce qui
concerne la tentative de la CPI d'exercer sa
compétence touchant le personnel israélien. Les
Palestiniens n'ont pas la qualité d'un État
souverain, ne sont pas qualifiés pour obtenir un
statut de membre en tant qu'État, pour participer
en tant qu'État à la CPI ou lui déléguer une
compétence. »
La position du Canada sur cette question est
aussi entièrement méprisable. Lorsque la Chambre
préliminaire 1 de la CPI a rendu sa décision, le 5
février, que la procureure en chef pouvait
procéder à l'enquête, le ministre canadien des
Affaires étrangères Marc Garneau a dit : «
[...] la position de longue date du Canada reste
la même : le Canada ne reconnaît pas un État
palestinien et ne reconnaît donc pas son adhésion
aux traités internationaux, y compris le Statut de
Rome de la Cour pénale internationale. Le Canada a
exprimé cette position à la Cour à diverses
occasions. » Une semaine plus tard, le 14 février,
incité par Netanyahu, le premier ministre Justin
Trudeau a écrit à la CPI pour exprimer
l'opposition du Canada à sa décision.
 Toutes les
personnes éprises de paix et de justice doivent
dénoncer la position sans principes du Canada à
cette décision juste et légale de la CPI. La CPI
est une cour des Nations unies qui a le mandat de
poursuivre les individus accusés de perpétration
de génocide, de crimes contre l'humanité et de
crimes de guerre sur le territoire d'États parties
du Statut de Rome, son traité fondateur. Israël,
comme son parrain les États-Unis, n'est pas membre
de la CPI, mais l'autorité palestinienne l'est.
L'Autorité palestinienne a d'abord cherché à
devenir un « État partie » de la CPI en 2009, mais
celle-ci avait conclu au terme d'une délibération
que le statut de la Palestine en tant qu'entité
observatrice à l'ONU ne remplissait pas les
critères juridiques pour se joindre à la cour.
C'est seulement en novembre 2012, après que
l'Assemblée générale des Nations unies a adopté,
par une majorité écrasante, la Résolution 67/19
accordant « à la Palestine le statut d'État non
membre observateur auprès de l'Organisation des
Nations unies », que la Palestine a été admissible
à se joindre au Statut de Rome. La résolution a
été adoptée par un vote de 138 en faveur, 9 contre
(dont le Canada) et 41 abstentions. Toutes les
personnes éprises de paix et de justice doivent
dénoncer la position sans principes du Canada à
cette décision juste et légale de la CPI. La CPI
est une cour des Nations unies qui a le mandat de
poursuivre les individus accusés de perpétration
de génocide, de crimes contre l'humanité et de
crimes de guerre sur le territoire d'États parties
du Statut de Rome, son traité fondateur. Israël,
comme son parrain les États-Unis, n'est pas membre
de la CPI, mais l'autorité palestinienne l'est.
L'Autorité palestinienne a d'abord cherché à
devenir un « État partie » de la CPI en 2009, mais
celle-ci avait conclu au terme d'une délibération
que le statut de la Palestine en tant qu'entité
observatrice à l'ONU ne remplissait pas les
critères juridiques pour se joindre à la cour.
C'est seulement en novembre 2012, après que
l'Assemblée générale des Nations unies a adopté,
par une majorité écrasante, la Résolution 67/19
accordant « à la Palestine le statut d'État non
membre observateur auprès de l'Organisation des
Nations unies », que la Palestine a été admissible
à se joindre au Statut de Rome. La résolution a
été adoptée par un vote de 138 en faveur, 9 contre
(dont le Canada) et 41 abstentions.

Israël a démoli plus de 1 000 maisons et édifices
palestiniens en 2020 et dans les trois premiers
mois de 2021, affectant plus de 1 500
Palestiniens, y compris près de 600 enfants, qui
sont maintenant sans domicile. Une grande part des
victimes ont par conséquent aussi perdu leur moyen
de subsistance et l'accès aux services vitaux, en
plus d'être encore plus vulnérables à la pandémie
mondiale du coronavirus.
 Bien qu'il se soit
engagé à cesser la destruction des propriétés
palestiniennes en raison de la pandémie, l'État
sioniste a, au contraire, intensifié ses crimes.
Les maisons et les propriétés ont été détruites ou
saisies dans la bande de Gaza ainsi qu'en
Cisjordanie, où Israël a revendiqué 60 % des
terres saisies illégalement aux Palestiniens à la
suite de la soi-disant Guerre des Six Jours en
1967. Israël poursuit un programme de démolition
et de confiscation des propriétés palestiniennes
dans ce qu'on appelle la Zone C et Al-Quds
(Jérusalem-Est) dans le but d'écraser la lutte et
les revendications historiques du peuple
palestinien pour une Palestine indépendante avec
Al-Quds comme capitale. Bien qu'il se soit
engagé à cesser la destruction des propriétés
palestiniennes en raison de la pandémie, l'État
sioniste a, au contraire, intensifié ses crimes.
Les maisons et les propriétés ont été détruites ou
saisies dans la bande de Gaza ainsi qu'en
Cisjordanie, où Israël a revendiqué 60 % des
terres saisies illégalement aux Palestiniens à la
suite de la soi-disant Guerre des Six Jours en
1967. Israël poursuit un programme de démolition
et de confiscation des propriétés palestiniennes
dans ce qu'on appelle la Zone C et Al-Quds
(Jérusalem-Est) dans le but d'écraser la lutte et
les revendications historiques du peuple
palestinien pour une Palestine indépendante avec
Al-Quds comme capitale.
Le Bureau de l'ONU de la Coordination des
affaires humanitaires dans les territoires
palestiniens (CAHTP) a rapporté qu'en février 2021
seulement, l'armée israélienne a soit détruit ou
saisi 153 structures appartenant aux Palestiniens.
Il s'agit du nombre le plus élevé de cas mensuels
depuis 2009. Il semblerait que depuis l'annonce
récente d'une enquête menée par la Cour pénale
internationale (CPI) sur la « Situation en
Palestine », l'État sioniste ait intensifié ses
crimes contre le peuple palestinien.
En novembre 2020, Israël a détruit les tentes
servant d'habitations et les propriétés des
Bédouins palestiniens vivant à Khirbet Humsa dans
la partie supérieure de la vallée du Jourdain,
touchant 75 personnes au total, y compris 45
enfants. Les experts des droits humains de l'ONU
ont dénoncé ce cas de destruction des propriétés
palestiniennes, le plus grave depuis 2010,
condamné la campagne illégale et constante de
destruction, surtout en temps de pandémie, et
souligné que de tels actes sont de graves
violations des droits humains des Palestiniens.
Ils ont ajouté : « Nous appelons Israël à
immédiatement cesser les démolitions de propriétés
dans les territoires occupés, de veiller à ce que
ses actions soient conformes à ses obligations
envers les droits humains et l'humanitarisme
international, et qu'il s'engage à protéger,
plutôt qu'à déplacer, la population protégée. »
Pendant des décennies, le Conseil de sécurité de
l'ONU, le secrétaire général de l'ONU et le
Conseil des droits de l'homme de l'ONU et d'autres
organisations internationales de droits humains
ont adopté des résolutions et dénoncé Israël pour
la destruction des maisons et des propriétés
palestiniennes ainsi que d'autres crimes et
atrocités contre les droits humains. Le Conseil
des droits de l'homme de l'ONU a officiellement
condamné Israël au moins 50 fois pour une
multitude de violations contre le peuple
palestinien et, malgré tout, rien n'a été fait
pour concrètement arrêter ces crimes. Maintenant
que la Cour pénale internationale – le « tribunal
de l'ultime recours » – a décidé d'enquêter,
les États-Unis et leurs alliés, y compris le
Canada, la Grande-Bretagne, la France,
l'Allemagne, l'OTAN et d'autres instruments de
l'hégémonisme au Moyen-Orient se font tous
entendre, non pas pour dénoncer Israël, mais pour
dénoncer la CPI pour son « parti pris » contre
Israël ! C'est ce qui permet à l'État sioniste de
poursuivre ses activités en toute impunité.
Le facteur décisif de cette situation intenable
est la résistance du peuple palestinien face à la
position sioniste et sa lutte incessante pour
affirmer ses droits qui ne seront pas éteints
advienne que pourra. Le peuple palestinien a
l'appui indéfectible du peuple canadien et des
peuples du monde à leur juste cause et à leurs
droits nationaux, y compris le droit de retour. Et
il connaîtra la victoire, puisque l'histoire lui
donne raison.

- Nick Lin -
Alors que divers pays connaissent des problèmes
dans la livraison large et en temps requis des
vaccins pour la COVID-19, Israël est présenté
comme un modèle d'efficacité et des chiffres sont
donnés pour illustrer la vitesse et la précision
avec lesquelles il a vacciné sa population.
Ce discours est un déni total du traitement
brutal et raciste par Israël du peuple
palestinien. Sur près de 14 millions de
Palestiniens dans le monde, quelque 5,2 millions
vivent sous occupation israélienne. Bien que les
sionistes voudraient avoir les mains libres pour
commettre leurs crimes en toute impunité, le droit
international impose certaines obligations à une
puissance occupante[1].
Cela comprend s'assurer que les personnes sous
occupation soient vaccinées contre la COVID-19.
Le 14 janvier, deux rapporteurs spéciaux des
Nations unies ont publié une déclaration qui dit :
« Israël n'a pas veillé à ce que les Palestiniens
sous occupation en Cisjordanie et à Gaza aient
accès dans un proche avenir aux vaccins
disponibles. La pandémie de la COVID-19 a fait des
ravages en Cisjordanie et à Gaza au cours des
derniers mois, et a fracturé un système de soins
de santé palestinien déjà très à court de
ressources. Nous sommes particulièrement
préoccupés par la détérioration de la situation
sanitaire à Gaza, qui souffre d'un blocus qui dure
depuis 13 ans, de pénurie sérieuse d'eau et
d'électricité et de pauvreté et de chômage
endémiques. » Ils ont noté à ce moment que les
vaccins commandés par l'Autorité palestinienne
n'étaient pas attendus avant de nombreuses
semaines. « Cela signifie que plus de 4,5 millions
de Palestiniens resteront non protégés et exposés
à la COVID-19, tandis que les citoyens israéliens
vivant à proximité et parmi eux – y compris
la population de colons Israéliens – seront
vaccinés. Moralement et légalement, cet accès
différent aux soins de santé nécessaires au milieu
de la pire crise sanitaire mondiale depuis un
siècle est inacceptable[2].
»
À la fin février, un conseiller médical de
Médecins Sans Frontières a noté qu'Israël avait
réussi à vacciner près de 4,2 millions de
personnes (environ 50 % des Israéliens) avec une
première dose et 2,8 millions de personnes avec
deux doses (environ 30 % des Israéliens), mais que
« seules plusieurs milliers de doses sont
disponibles en Cisjordanie palestinienne, et une
livraison de 20 000 doses qui seraient arrivées en
fin de semaine dernière à Gaza effleure à peine la
surface des besoins. Tout au plus, en supposant
que les 35 000 vaccins Spoutnik et Moderna
signalés sont tous disponibles, cela toucherait
environ 0,8 % de la population palestinienne. » Il
a noté qu'à ce moment-là, Israël s'apprêtait à
vacciner des segments jeunes et en bonne santé de
la population considérés comme à faible risque. «
Si on me demande pourquoi les personnes
vulnérables ne peuvent pas être vaccinées en
Palestine, je ne sais pas comment répondre. C'est
inexplicable et incroyable. Pire que cela –
c'est injuste et cruel », a-t-il ajouté.
Le conseiller a ensuite décrit les difficultés
dans diverses régions de la Palestine, et a
souligné la situation particulièrement désastreuse
à Gaza où « ils ont des pénuries beaucoup plus
graves de fournitures médicales et de produits
pharmaceutiques parce que le blocus est si strict.
Leur capacité de traitement de la COVID-19 est
plus faible, de sorte que leur besoin de vaccins
est encore plus élevé. Et la livraison récente de
20 000 vaccins ne suffira pas à protéger à la fois
les travailleurs de la santé et les personnes les
plus vulnérables du besoin d'avoir des soins
médicaux critiques contre la COVID-19[3]. »
Jusqu'à la mi-mars, c'était même la politique
officielle du ministère israélien de la Santé de
refuser la vaccination aux Palestiniens vivant en
Israël. On prétend que le ministère autorise
maintenant les Palestiniens en Israël qui ont des
permis de travail à se faire vacciner.
Un aspect important de la lutte mondiale contre
la pandémie de COVID-19 en ce moment est de faire
en sorte que le plus de personnes possible soient
vaccinées. L'Organisation mondiale de la Santé et
d'autres ont même mis en place l'initiative
COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) pour
distribuer plus largement les vaccins, en
particulier face au stockage par des pays riches,
tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada
et Israël, entre autres.
La BBC a rapporté le 22 mars que « le premier
envoi de vaccins fournis par le programme COVAX
pour aider les pays les plus pauvres à accéder aux
fournitures est maintenant arrivé en Cisjordanie
et à Gaza.
« 37 440 doses du vaccin Pfizer-BioNTech et 24
000 doses du vaccin AstraZeneca ont été livrées,
selon un communiqué de l'UNICEF.
« Le programme international COVAX, soutenu par
l'OMS, devrait couvrir jusqu'à 20 % des besoins en
vaccins des Palestiniens.
« Les Palestiniens se sont procuré des quantités
limitées de vaccins ailleurs.
« Une livraison de 10 000 doses de vaccin de
fabrication russe [Spoutnik V] est arrivée, dont 2
000 ont été envoyées à Gaza. Gaza a également reçu
20 000 doses de vaccin russe données par les EAU.
[...]
« Un rapport récent de la Banque mondiale indique
que les Palestiniens auront besoin de plus d'aide
financière et logistique pour couvrir 60 % de la
population.
« Il a exhorté Israël à envisager de donner aux
Palestiniens des doses supplémentaires qu'il a
commandées, mais dont il n'a pas besoin.
« Israël dit qu'il donne 5 000 doses aux
Palestiniens, dont 2 000 ont été livrées en
Cisjordanie jusqu'à présent. »
Notes
1. En
vertu de la Quatrième Convention de Genève,
Israël a la responsabilité, en tant que
puissance occupante, d'assurer
l'approvisionnement en fournitures médicales
aux populations occupées, « notamment en
adoptant et en appliquant les mesures
prophylactiques et préventives nécessaires
pour combattre la propagation des maladies
contagieuses et des épidémies », « dans toute
la mesure de ses moyens ».
2. «
Israel/OPT : UN experts call on Israel to
ensure equal access to COVID-19 vaccines for
Palestinians », Haut-Commissariat des Nations
unies aux droits de l'homme, 14 janvier 2021
3. « In
Israel, you're 60 times more likely to have a
COVID vaccine than in Palestine », Matthias
Kennes, Conseiller médical de Médecins Sans
Frontières, Palestine, 22 février 2021
4. «
COVID-19 : Palestinians lag behind in vaccine
efforts as infections rise », BBC News, 22
mars 2021

(Pour voir les articles
individuellement, cliquer sur le titre de
l'article.)
PDF
ARCHIVES |
ACCUEIL
Site Web : www.pccml.ca
Courriel : redaction@cpcml.ca
|

 Les députés vont
passer une portion significative des journées de
session à venir à débattre du budget du 19 avril
du gouvernement. Celui-ci sera suivi d'un projet
de loi d'exécution du budget et le débat sur ce
projet de loi devrait être en tête de liste des
priorités législatives du gouvernement. Tout vote
sur le budget sera une motion de confiance qui
pourrait faire tomber le gouvernement.
Les députés vont
passer une portion significative des journées de
session à venir à débattre du budget du 19 avril
du gouvernement. Celui-ci sera suivi d'un projet
de loi d'exécution du budget et le débat sur ce
projet de loi devrait être en tête de liste des
priorités législatives du gouvernement. Tout vote
sur le budget sera une motion de confiance qui
pourrait faire tomber le gouvernement.
 Il s'agit d'un pas
en arrière. En soulevant la question de la
Constitution, qui n'a même jamais été signée par
le Québec, les amendements proposés dans le projet
de loi C-8 provoquent de nouvelles divisions dans
la société. Le fait d'exiger des nouveaux citoyens
qu'ils s'engagent à respecter les droits issus de
traités, mais pas les droits nationaux du Québec,
crée des problèmes et montre que le gouvernement
n'est sincère ni sur l'un ni sur l'autre. Il est
méprisable de créer ainsi l'illusion que le
gouvernement n'est pas raciste parce qu'il dit que
les citoyens doivent s'engager à respecter les
droits issus de traités quand on sait que le
respect des droits issus de traités est une
responsabilité du gouvernement et non des citoyens
comme tels, qui sont actuellement sans pouvoir sur
ces questions de toute façon.
Il s'agit d'un pas
en arrière. En soulevant la question de la
Constitution, qui n'a même jamais été signée par
le Québec, les amendements proposés dans le projet
de loi C-8 provoquent de nouvelles divisions dans
la société. Le fait d'exiger des nouveaux citoyens
qu'ils s'engagent à respecter les droits issus de
traités, mais pas les droits nationaux du Québec,
crée des problèmes et montre que le gouvernement
n'est sincère ni sur l'un ni sur l'autre. Il est
méprisable de créer ainsi l'illusion que le
gouvernement n'est pas raciste parce qu'il dit que
les citoyens doivent s'engager à respecter les
droits issus de traités quand on sait que le
respect des droits issus de traités est une
responsabilité du gouvernement et non des citoyens
comme tels, qui sont actuellement sans pouvoir sur
ces questions de toute façon. Une
définition moderne de la citoyenneté reconnaît que
tous les membres du corps politique sont égaux,
avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Tout
citoyen, voire tout résident, est tenu de se
conformer à la loi, ce qui inclut la Constitution,
alors que gagne-t-on à obliger un citoyen
naturalisé à prêter un tel serment ? Un demandeur
qui a satisfait aux exigences d'acquisition de la
citoyenneté par naturalisation devrait simplement
s'engager à respecter les droits et les devoirs
attendus de tout citoyen, ni plus ni moins.
Une
définition moderne de la citoyenneté reconnaît que
tous les membres du corps politique sont égaux,
avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Tout
citoyen, voire tout résident, est tenu de se
conformer à la loi, ce qui inclut la Constitution,
alors que gagne-t-on à obliger un citoyen
naturalisé à prêter un tel serment ? Un demandeur
qui a satisfait aux exigences d'acquisition de la
citoyenneté par naturalisation devrait simplement
s'engager à respecter les droits et les devoirs
attendus de tout citoyen, ni plus ni moins. Ce
principe a été formulé pour la première fois à la
fin des années 1920 et au début des années 1930, à
l'époque où la radiodiffusion des stations
américaines au Canada était considérée comme une
menace pour la culture nationale par les élites
dirigeantes. Ce principe a été inscrit dans la loi
avec la Loi canadienne sur la radiodiffusion
de 1932, qui a créé la commission
canadienne de radiodiffusion qui deviendra
Radio-Canada en 1936 comme radiodiffuseur public,
qui avait également à l'époque le pouvoir de
réglementer et d'autoriser la radiodiffusion.
Ce
principe a été formulé pour la première fois à la
fin des années 1920 et au début des années 1930, à
l'époque où la radiodiffusion des stations
américaines au Canada était considérée comme une
menace pour la culture nationale par les élites
dirigeantes. Ce principe a été inscrit dans la loi
avec la Loi canadienne sur la radiodiffusion
de 1932, qui a créé la commission
canadienne de radiodiffusion qui deviendra
Radio-Canada en 1936 comme radiodiffuseur public,
qui avait également à l'époque le pouvoir de
réglementer et d'autoriser la radiodiffusion.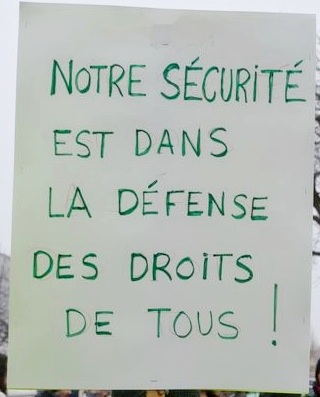 Dans la
pratique quotidienne, les politiques du CRTC
entérinent un système de radiodiffusion qui
interdit la diffusion de toutes les tendances,
opinions et persuasions politiques. Le plus
flagrant de tous est l'absence, dans la couverture
des nouvelles, de reportages sur les luttes, les
revendications et les préoccupations des
travailleurs, ainsi que sur celles des peuples
autochtones et de tous ceux qui réclament leurs
droits et se battent pour la paix, la justice et
la démocratie.
Dans la
pratique quotidienne, les politiques du CRTC
entérinent un système de radiodiffusion qui
interdit la diffusion de toutes les tendances,
opinions et persuasions politiques. Le plus
flagrant de tous est l'absence, dans la couverture
des nouvelles, de reportages sur les luttes, les
revendications et les préoccupations des
travailleurs, ainsi que sur celles des peuples
autochtones et de tous ceux qui réclament leurs
droits et se battent pour la paix, la justice et
la démocratie.

 La vérificatrice
générale a cependant conclu que le gouvernement
n'avait jamais été en voie d'atteindre son
objectif – et ne le sera jamais, en raison de ses
tergiversations à vouloir régler le problème.
Quinze ans après que son ministère a fait mention
de ce problème pour la première fois en 2005 (et à
nouveau en 2011), plusieurs communautés
autochtones n'ont toujours pas d'eau potable
salubre. Elle a trouvé qu'il n'existait même pas
de régime de réglementation pour la gestion de
l'eau potable dans les communautés des Premières
Nations.
La vérificatrice
générale a cependant conclu que le gouvernement
n'avait jamais été en voie d'atteindre son
objectif – et ne le sera jamais, en raison de ses
tergiversations à vouloir régler le problème.
Quinze ans après que son ministère a fait mention
de ce problème pour la première fois en 2005 (et à
nouveau en 2011), plusieurs communautés
autochtones n'ont toujours pas d'eau potable
salubre. Elle a trouvé qu'il n'existait même pas
de régime de réglementation pour la gestion de
l'eau potable dans les communautés des Premières
Nations.
 Le 27 janvier 2020,
à l'occasion du 75e anniversaire de la libération
des prisonniers d'Auschwitz par l'armée
soviétique, également connue sous le nom de
Journée internationale de commémoration en mémoire
des victimes de l'holocauste, le conseil municipal
de Montréal s'est réuni pour discuter d'une motion
visant à adopter la définition de travail de
l'IHRA de l'antisémitisme présentée par Lionel
Perez, chef de l'opposition officielle et chef par
intérim de l'Ensemble Montréal (anciennement
Équipe Denis Coderre pour Montréal), à la suite de
la défaite de Coderre aux élections municipales de
2017. Un piquetage devant l'hôtel de ville de
Montréalqui comprenait des membres de Palestiniens
et Juifs unis (PAJU), de Voix juives
indépendantes, du Parti communiste du Canada
(marxiste-léniniste) et d'autres forces
progressistes, s'est opposé à l'adoption de la
définition de l'IHRA.
Le 27 janvier 2020,
à l'occasion du 75e anniversaire de la libération
des prisonniers d'Auschwitz par l'armée
soviétique, également connue sous le nom de
Journée internationale de commémoration en mémoire
des victimes de l'holocauste, le conseil municipal
de Montréal s'est réuni pour discuter d'une motion
visant à adopter la définition de travail de
l'IHRA de l'antisémitisme présentée par Lionel
Perez, chef de l'opposition officielle et chef par
intérim de l'Ensemble Montréal (anciennement
Équipe Denis Coderre pour Montréal), à la suite de
la défaite de Coderre aux élections municipales de
2017. Un piquetage devant l'hôtel de ville de
Montréalqui comprenait des membres de Palestiniens
et Juifs unis (PAJU), de Voix juives
indépendantes, du Parti communiste du Canada
(marxiste-léniniste) et d'autres forces
progressistes, s'est opposé à l'adoption de la
définition de l'IHRA.  Le Réseau canadien
pour Cuba (RCC) prépare l'expédition à Cuba d'un
conteneur de 1 920 000 seringues en appui au
programme de vaccination de ce pays contre la
COVID-19. Cette initiative fait partie de la
campagne de collecte de fonds lancée par le RCC le
8 janvier pour faire parvenir de l'équipement
médical à Cuba. Cette campagne de solidarité a
reçu l'appui d'un grand nombre d'amis canadiens,
de Cubains et de citoyens d'autres pays résidant
au Canada.
Le Réseau canadien
pour Cuba (RCC) prépare l'expédition à Cuba d'un
conteneur de 1 920 000 seringues en appui au
programme de vaccination de ce pays contre la
COVID-19. Cette initiative fait partie de la
campagne de collecte de fonds lancée par le RCC le
8 janvier pour faire parvenir de l'équipement
médical à Cuba. Cette campagne de solidarité a
reçu l'appui d'un grand nombre d'amis canadiens,
de Cubains et de citoyens d'autres pays résidant
au Canada.










 La manifestation
s'inscrivait dans le cadre de la Journée
internationale de solidarité avec Haïti au cours
de laquelle des actions se sont tenues à Ottawa, à
Boston, Chicago, New York, Atlanta, Miami aux
États-Unis, à Saint-Domingue en République
dominicaine, à San Juan à Porto Rico, à Caracas au
Venezuela, à Santiago au Chili et à Buenos Aires
en Argentine. Partout, les manifestants ont
exprimé leur soutien au peuple haïtien qui lutte
avec courage contre le diktat du président de
facto, Jovenel Moïse, et contre l'ingérence
étrangère qui vise à empêcher le peuple de former
un gouvernement en son propre nom qui sert ses
intérêts.
La manifestation
s'inscrivait dans le cadre de la Journée
internationale de solidarité avec Haïti au cours
de laquelle des actions se sont tenues à Ottawa, à
Boston, Chicago, New York, Atlanta, Miami aux
États-Unis, à Saint-Domingue en République
dominicaine, à San Juan à Porto Rico, à Caracas au
Venezuela, à Santiago au Chili et à Buenos Aires
en Argentine. Partout, les manifestants ont
exprimé leur soutien au peuple haïtien qui lutte
avec courage contre le diktat du président de
facto, Jovenel Moïse, et contre l'ingérence
étrangère qui vise à empêcher le peuple de former
un gouvernement en son propre nom qui sert ses
intérêts.
 Le 21 mars dernier
à 13 heures, plusieurs dizaines de personnes se
sont rassemblées devant le bureau de Montréal de
Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères du
Canada, pour exiger du gouvernement canadien qu'il
cesse son appui au gouvernement corrompu de
Jovenel Moïse, lors d'une action organisée par
Solidarité Québec-Haïti. La politique étrangère du
Canada envers Haïti est une politique raciste et
néocoloniale, ont souligné plusieurs des
intervenants qui ont pris parole durant l'action.
L'« aide » que dit apporter le gouvernement
canadien est une ingérence ouverte dans les
affaires internes du peuple haïtien et une façon
de bloquer les efforts des Haïtiens d'établir
eux-mêmes les types d'arrangements politiques qui
les favorisent au lieu de favoriser les intérêts
privés des impérialistes américains et de leurs
laquais, dont le Canada fait partie.
Le 21 mars dernier
à 13 heures, plusieurs dizaines de personnes se
sont rassemblées devant le bureau de Montréal de
Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères du
Canada, pour exiger du gouvernement canadien qu'il
cesse son appui au gouvernement corrompu de
Jovenel Moïse, lors d'une action organisée par
Solidarité Québec-Haïti. La politique étrangère du
Canada envers Haïti est une politique raciste et
néocoloniale, ont souligné plusieurs des
intervenants qui ont pris parole durant l'action.
L'« aide » que dit apporter le gouvernement
canadien est une ingérence ouverte dans les
affaires internes du peuple haïtien et une façon
de bloquer les efforts des Haïtiens d'établir
eux-mêmes les types d'arrangements politiques qui
les favorisent au lieu de favoriser les intérêts
privés des impérialistes américains et de leurs
laquais, dont le Canada fait partie.





 Le pasteur Gérald
Bataille, un des initiateurs de l'action du 28
mars, s'est dit alarmé par la situation au pays. «
La patrie est en danger. Nous sommes sous le joug
de la dictature, des persécutions et de
l'insécurité. Nous sommes dirigés par un
gouvernement illégal. Le mandat de ce président
est arrivé à terme depuis le 7 février. Voilà
pourquoi nous sommes dans les rues. Pour crier
notre détresse et notre colère », a-t-il dit au
journal haïtien Le Nouvelliste. Il a
déclaré que les Haïtiens peuvent se gouverner
eux-mêmes et qu'aucun problème auquel est
confronté le pays ne peut être résolu avec Jovenel
Moïse au pouvoir. « Le dialogue est le point de
départ de toutes les solutions. Toutefois aucun
dialogue n'est possible avec ce monsieur (Jovenel
Moïse) », a-t-il dit.
Le pasteur Gérald
Bataille, un des initiateurs de l'action du 28
mars, s'est dit alarmé par la situation au pays. «
La patrie est en danger. Nous sommes sous le joug
de la dictature, des persécutions et de
l'insécurité. Nous sommes dirigés par un
gouvernement illégal. Le mandat de ce président
est arrivé à terme depuis le 7 février. Voilà
pourquoi nous sommes dans les rues. Pour crier
notre détresse et notre colère », a-t-il dit au
journal haïtien Le Nouvelliste. Il a
déclaré que les Haïtiens peuvent se gouverner
eux-mêmes et qu'aucun problème auquel est
confronté le pays ne peut être résolu avec Jovenel
Moïse au pouvoir. « Le dialogue est le point de
départ de toutes les solutions. Toutefois aucun
dialogue n'est possible avec ce monsieur (Jovenel
Moïse) », a-t-il dit.
 Schultz Simpssie
Cazir, secrétaire général du Parti du mouvement de
la troisième voie (MTV), s'est insurgé contre la
situation du pays. « Ma présence dans les rues
aujourd'hui est pour dénoncer et protester
énergiquement contre l'insécurité, les
persécutions et l'intimidation politiques, la
corruption, l'impunité et les multiples cas de
violation de la Constitution par un pouvoir
illégitime qui agit en toute illégalité. Marcher
pacifiquement aujourd'hui pour moi exprime mon
rejet du plan dictatorial de Jovenel Moïse de nous
imposer une constitution à travers un référendum
inconstitutionnel, sans un large consensus avec
les forces vives du pays », a-t-il dit.
Schultz Simpssie
Cazir, secrétaire général du Parti du mouvement de
la troisième voie (MTV), s'est insurgé contre la
situation du pays. « Ma présence dans les rues
aujourd'hui est pour dénoncer et protester
énergiquement contre l'insécurité, les
persécutions et l'intimidation politiques, la
corruption, l'impunité et les multiples cas de
violation de la Constitution par un pouvoir
illégitime qui agit en toute illégalité. Marcher
pacifiquement aujourd'hui pour moi exprime mon
rejet du plan dictatorial de Jovenel Moïse de nous
imposer une constitution à travers un référendum
inconstitutionnel, sans un large consensus avec
les forces vives du pays », a-t-il dit.




 En même temps, le
nombre massif de blessures, de détentions et de
décès causés par l'occupation et l'expansion
violente de colonies de peuplement continue de
croître. Selon le BCPS « le nombre de martyrs
palestiniens et arabes tués depuis la Nakba de
1948 jusqu'à la Journée de la terre palestinienne
de 2021 (à l'intérieur et à l'extérieur de la
Palestine) se monte maintenant à environ 100 000.
En plus, le nombre de martyrs tués lors de
l'Intifada Al-Aqsa entre le 29 septembre 2000 et
le 31 décembre 2020 est de 10 969. On dit que
l'année la plus sanglante a été 2014, avec 2 240
martyrs palestiniens, dont 2 181 lors de la guerre
dans la Bande de Gaza. En 2020, il y a eu 43
martyrs palestiniens, dont neuf enfants et trois
femmes. Pendant la même année, environ 1 650
Palestiniens ont été blessés. À la fin de 2020, il
y avait 4 400 détenus palestiniens dans les
prisons sous occupation israélienne, dont 170
enfants et 35 femmes. En ce qui concerne les cas
de détention pendant toute l'année 2020, il y en a
eu environ 4 634, dont 543 enfants et 128 femmes.
»
En même temps, le
nombre massif de blessures, de détentions et de
décès causés par l'occupation et l'expansion
violente de colonies de peuplement continue de
croître. Selon le BCPS « le nombre de martyrs
palestiniens et arabes tués depuis la Nakba de
1948 jusqu'à la Journée de la terre palestinienne
de 2021 (à l'intérieur et à l'extérieur de la
Palestine) se monte maintenant à environ 100 000.
En plus, le nombre de martyrs tués lors de
l'Intifada Al-Aqsa entre le 29 septembre 2000 et
le 31 décembre 2020 est de 10 969. On dit que
l'année la plus sanglante a été 2014, avec 2 240
martyrs palestiniens, dont 2 181 lors de la guerre
dans la Bande de Gaza. En 2020, il y a eu 43
martyrs palestiniens, dont neuf enfants et trois
femmes. Pendant la même année, environ 1 650
Palestiniens ont été blessés. À la fin de 2020, il
y avait 4 400 détenus palestiniens dans les
prisons sous occupation israélienne, dont 170
enfants et 35 femmes. En ce qui concerne les cas
de détention pendant toute l'année 2020, il y en a
eu environ 4 634, dont 543 enfants et 128 femmes.
»














 Dans son annonce du
3 mars, madame Bensouda écrit : « La décision
d'ouvrir une enquête fait suite à l'examen
préliminaire minutieusement mené par mon bureau
pendant près de cinq ans. Au cours de cette
période, conformément à la pratique établie par le
bureau, ce dernier a été en contact avec un grand
nombre de parties prenantes et a notamment eu
régulièrement des échanges fructueux avec des
représentants des gouvernements palestinien et
israélien. »
Dans son annonce du
3 mars, madame Bensouda écrit : « La décision
d'ouvrir une enquête fait suite à l'examen
préliminaire minutieusement mené par mon bureau
pendant près de cinq ans. Au cours de cette
période, conformément à la pratique établie par le
bureau, ce dernier a été en contact avec un grand
nombre de parties prenantes et a notamment eu
régulièrement des échanges fructueux avec des
représentants des gouvernements palestinien et
israélien. » La décision de la
CPI est historique. Elle est saluée par le peuple
palestinien et toutes les personnes éprises de
justice et de paix au Canada et dans le monde qui
ont pris position depuis plus de 70 ans à la
défense des droits du peuple palestinien. Le
ministre palestinien des Affaires étrangères a dit
: « Ce geste attendu depuis longtemps sert
l'effort vigoureux de la Palestine de réaliser la
justice et la responsabilité en tant que bases
indispensables à la paix. » Il a appelé à une
conclusion rapide de l'enquête à la lumière des
crimes continus des dirigeants de l'occupation
contre le peuple palestinien, lesquels sont «
permanents, systématiques et très étendus ».
La décision de la
CPI est historique. Elle est saluée par le peuple
palestinien et toutes les personnes éprises de
justice et de paix au Canada et dans le monde qui
ont pris position depuis plus de 70 ans à la
défense des droits du peuple palestinien. Le
ministre palestinien des Affaires étrangères a dit
: « Ce geste attendu depuis longtemps sert
l'effort vigoureux de la Palestine de réaliser la
justice et la responsabilité en tant que bases
indispensables à la paix. » Il a appelé à une
conclusion rapide de l'enquête à la lumière des
crimes continus des dirigeants de l'occupation
contre le peuple palestinien, lesquels sont «
permanents, systématiques et très étendus ».