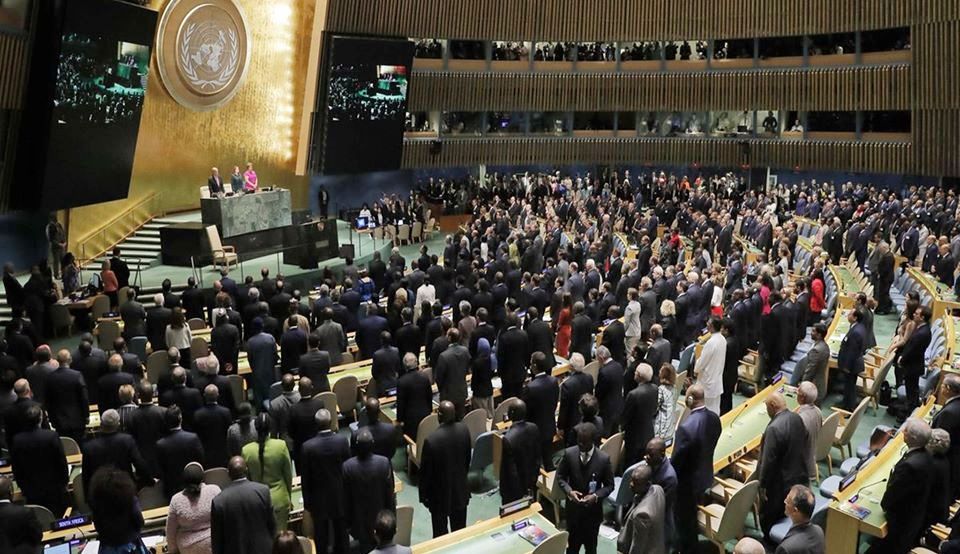|
Numéro 41 - 21 décembre 2019
Des sujets de préoccupation pour
les Canadiens
L'intégration du Canada à
l'économie de guerre impérialiste américaine
- K.C. Adams -
À
titre d'information
• La
production et la vente de matériel de guerre
• L'économie
de guerre mondiale
• Le
soleil ne se couche jamais sur les Forces armées
canadiennes
- Yves Engler -
États-Unis
• La
procédure de destitution, la responsabilisation
et
la bataille de la démocratie
• Des
organisations de défense des droits luttent pour
mettre
fin aux détentions, aux expulsions et à la
militarisation de
la frontière Mexique-États-Unis
• La
détérioration des conditions sociales aux
États-Unis
Développements en Amérique latine et dans les
Caraïbes
• Quinze
années à la défense de l'unité, de la paix et de
l'intégration
- Déclaration du XVIIe
Sommet des chefs d'État et
de gouvernement de l'ALBA-TCP -
• Notre
Amérique face aux attaques de l'impérialisme et
des oligarchies
- Ministère des Relations
extérieures de Cuba -
• 30e
anniversaire de l'invasion de Panama par les
États-Unis
- Carlos Perez Morales -
Bolivie
• Défaite
retentissante des États-Unis à l'Organisation
des États américains après l'adoption de la
résolution caribéenne
- Cubadebate -
Venezuela
• Le
gouvernement bolivarien rejette la loi des
États-Unis qui approfondit l'agression contre le
peuple vénézuélien
- Communiqué du
gouvernement bolivarien du Venezuela -
• Les
États-Unis adoptent une nouvelle loi renforçant
les mesures coercitives unilatérales
- Misión
Verdad -
• Un
juge de la Cour suprême rejette les tentatives
du président
autoproclamé d'établir un « Congrès virtuel »
Colombie
• Plus
de 200 000 corps non identifiés
trouvés dans des fosses secrètes
Des sujets de préoccupation pour
les Canadiens
- K.C. Adams -

L'intégration du Canada à l'économie de guerre
impérialiste américaine est un grand sujet de
préoccupation pour les Canadiens. L'économie de
guerre des États-Unis étend ses tentacules à tous
les États américains ainsi qu'au Canada et à
d'innombrables autres endroits à l'étranger.
L'économie de guerre englobe la production et la
vente de biens et services militaires à des
clients militaires aux États-Unis et à l'étranger
et toute la valeur fixe et circulante dont elle a
besoin pour fonctionner, comme les bâtiments et le
carburant. Elle comprend des milliers de bases
militaires, d'aéroports, de collèges, de centres
de recherche, d'agences de renseignement et de
centres d'essai et une vaste armée d'hommes et de
femmes en service actif, de réservistes et de
services aux anciens combattants.
 Avec la
militarisation de l'appareil de maintien de
l'ordre depuis l'adoption des lois de sécurité
intérieure et à cause d'autres facteurs, les
forces policières sont devenues d'importantes
consommatrices de matériel de guerre. Un aspect
important de l'économie de guerre est la
propagande générée dans la culture générale pour
faire la promotion de l'armée impérialiste et sa
contribution à la vie et faire la promotion de la
violence organisée par l'État pour défendre les
biens et les intérêts des oligarques financiers et
leur lutte pour l'hégémonie mondiale aux dépens
des peuples du monde. Avec la
militarisation de l'appareil de maintien de
l'ordre depuis l'adoption des lois de sécurité
intérieure et à cause d'autres facteurs, les
forces policières sont devenues d'importantes
consommatrices de matériel de guerre. Un aspect
important de l'économie de guerre est la
propagande générée dans la culture générale pour
faire la promotion de l'armée impérialiste et sa
contribution à la vie et faire la promotion de la
violence organisée par l'État pour défendre les
biens et les intérêts des oligarques financiers et
leur lutte pour l'hégémonie mondiale aux dépens
des peuples du monde.
L'économie de guerre américaine existe en
relation avec la lutte pour l'hégémonie mondiale
de l'oligarchie financière centrée aux États-Unis.
Le vol de la richesse sociale des peuples du monde
et la concurrence avec d'autres grandes puissances
alimentent l'économie de guerre qui, à son tour,
engendre l'instabilité, la violence et d'autres
guerres.
L'économie de guerre se contracterait
considérablement si les bases américaines à
l'étranger étaient fermées et que les troupes
américaines rentraient chez elles. Cette
transition est favorisée par l'insistance des
peuples aux États-Unis, au Canada et dans le monde
entier à réclamer une nouvelle direction de
l'économie pour répondre aux besoins de la
population et développer le commerce sur la base
de l'avantage réciproque. Pour cela, il faut
rompre le rapport entre l'économie nationale et la
lutte pour l'hégémonie mondiale de l'oligarchie
financière par des interventions militaires
actives à l'étranger contre ses rivaux ou ceux qui
refusent de se soumettre, l'instigation de la
guerre et les menaces de guerre, le changement de
régime et l'organisation d'opérations spéciales
militaires pour conquérir des marchés, des sources
de matières premières, des occasions
d'investissement et des travailleurs à exploiter.
Il faut donner à l'économie un nouveau but, pour
remplacer le but antisocial actuel par lequel une
petite classe de riches oligarques conspire et
rivalise pour exproprier le maximum de profit de
la richesse sociale que les travailleurs
produisent au pays et à l'étranger.
Un nouveau but de l'économie, prosocial,
correspondrait au caractère socialisé des forces
productives modernes et serait fidèle à l'ensemble
des relations humaines et ce qu'elles révèlent.
Les travailleurs produisent collectivement de la
richesse sociale. En se donnant le pouvoir de
décision, ils interdiront l'exploitation de ceux
qui produisent la richesse sociale, affirmeront
les droits de tous, humaniseront l'environnement
social et naturel et garantiront que le pays est
une zone de paix.
Pour l'emporter sur l'économie de guerre et
l'oligarchie financière qui en profite, les
peuples partout dans le monde continueront de se
mobiliser en 2020 pour atteindre les objectifs
qu'ils fixent pour l'économie et le pays. En
s'organisant politiquement pour changer la
direction de l'économie et les conditions
politiques et sociales d'une manière qui les
favorise plutôt que de favoriser les riches
oligarques, des progrès vont être faits.
La transition et la sortie de l'économie de
guerre ne sont pas aussi impossibles qu'on le
laisse entendre. L'économie de guerre consomme
essentiellement de la richesse sociale déjà
produite en échange de matériel de guerre et du
facteur humain nécessaire pour faire la guerre. La
guerre impérialiste et son matériel de guerre sont
des instruments de destruction et d'oppression et
ne contribuent pas au bien-être des peuples et de
la Terre Mère. Une grande partie de la richesse
sociale utilisée pour payer l'économie de guerre
provient de l'impôt, car les gouvernements sont le
principal organisateur et contributeur financier
de la guerre. Avec un objectif prosocial et une
nouvelle direction de l'économie, d'autres
utilisations peuvent être trouvées pour cette
richesse sociale et la force productive humaine
libérée de l'économie de guerre. Il est clair que
les propositions et les solutions pour humaniser
l'environnement social et naturel ont une portée
considérable.

À titre
d'information
Les États-Unis et d'autres gouvernements vont
généralement se procurer du matériel de guerre
auprès d'entreprises privées. Cela signifie que le
contrôle politique est fondamentalement important
pour ceux qui profitent de la production de
matériel de guerre et des services qui s'y
rattachent. Un exemple récent de l'importance du
contrôle politique est la perte par Amazon d'un
contrat « cloud » de 10 milliards de dollars
octroyé par le Pentagone à son concurrent
Microsoft. Amazon a immédiatement lancé une
contestation judiciaire de la décision et a
directement attaqué l'administration Trump
l'accusant d'ingérence dans l'attribution du
contrat. L'antagonisme entre le président Trump et
Amazon, en particulier son PDG Jeff Bezos,
propriétaire et éditeur du Washington Post,
est intense.[1]
 Bon nombre des plus
grandes entreprises impliquées dans l'économie de
guerre utilisent les contrats militaires garantis
par l'État comme base pour accroître leurs ventes
de biens et services non militaires. Boeing, le
deuxième plus grand producteur d'armes au monde,
en est un exemple. Il a enregistré 29,2
milliards de dollars de ventes d'armes au pays et
à l'étranger en 2018, ce qui a servi de point
d'ancrage ou de plateforme au point de
représenter 29 % du revenu brut total
réalisé de 101,1 milliards de dollars de
ventes. Bon nombre des plus
grandes entreprises impliquées dans l'économie de
guerre utilisent les contrats militaires garantis
par l'État comme base pour accroître leurs ventes
de biens et services non militaires. Boeing, le
deuxième plus grand producteur d'armes au monde,
en est un exemple. Il a enregistré 29,2
milliards de dollars de ventes d'armes au pays et
à l'étranger en 2018, ce qui a servi de point
d'ancrage ou de plateforme au point de
représenter 29 % du revenu brut total
réalisé de 101,1 milliards de dollars de
ventes.
L'Institut international de recherche sur la paix
de Stockholm (SIPRI) compile chaque année des
données sur les ventes d'armes à l'échelle
mondiale, à l'exclusion de la Chine. Les données
pour 2018 montrent que 43 entreprises
basées aux États-Unis ont généré un revenu brut
total de 246 milliards de dollars provenant
de la vente de biens et services militaires au
pays et à l'étranger. Cela représente une
augmentation de 7,2 % des ventes par
rapport à 2017 et représente 59 %
du total des revenus bruts provenant des ventes
d'armes des 100 plus grandes entreprises du
monde. Les données n'incluent pas la recherche, la
production et les ventes dans les entreprises
militaires publiques ni l'entretien « à
l'interne » des actifs militaires.
En ce qui concerne l'importance des ventes
d'armes par rapport aux dépenses militaires
totales, le SIPRI écrit : « En général, les
dépenses en armes, systèmes et plateformes d'armes
et autres équipements spécifiquement militaires (y
compris la recherche et le développement de ces
équipements) ne représentent pas plus d'un tiers
des dépenses militaires, et beaucoup moins dans
les pays non producteurs d'armes. Aux États-Unis,
les achats et la recherche et développement ont
généralement représenté environ 30 % des
dépenses totales de la ‘Défense nationale'
depuis 2005. »
Les cinq plus grands producteurs d'armes au monde
sont basés aux États-Unis et ont généré à eux
seuls 148 milliards de dollars de revenus
bruts et 35 % du total des ventes
d'armes des 100 plus grandes entreprises
en 2018. Ce sont :
Lockheed Martin Corp dont les revenus bruts
militaires sont de 47,26 milliards de
dollars : Lockheed Martin, le plus
grand producteur d'armes au monde, a vu ses ventes
d'armes augmenter de 5,2 % en 2018,
ce qui représentait 11 % du revenu brut
des 100 plus grandes entreprises du monde.
Lockheed Martin produit les avions de combat F-35
achetés par de nombreux pays au sein du système
impérialiste d'États dirigé par les États-Unis.
Boeing avec des revenus de 29,150
milliards de dollars : les ventes
d'armes de Boeing, le deuxième plus grand
producteur d'armes au monde, ont augmenté
de 5,7 % en 2018 et ont
totalisé 6,9 % des ventes mondiales
des 100 plus grandes entreprises.
Northrop Grumman Corp. avec des revenus
de 26,19 milliards de dollars :
les ventes d'armes de Northrop Grumman ont
augmenté de 14 % en 2018, soit une
augmentation de 3,3 milliards de dollars.
Cela est dû en partie à son acquisition du
producteur d'armes Orbital-ATK et à la forte
demande nationale et internationale pour ses
armes, y compris les missiles balistiques
intercontinentaux et les systèmes de défense
antimissile. [2]
Les ventes d'armes de Raytheon
représentent 23,44 milliards de dollars
(au quatrième rang) et ont augmenté
de 3,9 %.
Les ventes d'armes de General Dynamics Corp
ont augmenté de 10 % pour
atteindre 22 milliards de dollars
(cinquième rang).
Notes
1. Le journal Business
Insider titrait le 9 décembre : «
Amazon a récemment perdu face à Microsoft un
contrat de 10 milliards de dollars pour des
services informatiques hébergés (« cloud
computing ») pour le ministère de la Défense.
« Amazon a contesté devant un tribunal la
décision concernant l'octroi du contrat intitulé «
Joint Enterprise Defense Infrastructure »,
alléguant que la partialité du président Donald
Trump contre Amazon a joué un rôle dans la
décision.
« Dans des documents rendus publics lundi, Amazon
a déclaré que Trump avait mené ‘des attaques
publiques et en coulisse répétées' pour s'assurer
qu'Amazon n'obtienne pas le contrat afin de nuire
au PDG Jeff Bezos, ‘perçu comme son ennemi
politique'.
« Trump n'a pas caché son aversion pour
Amazon : il a accusé l'entreprise ‘d
‘échapper aux sanctions fiscales' et a accusé
Bezos d'utiliser la publication qu'il possède, le
Washington Post, comme une ‘arme de
lobbyiste'. »
2. Un développement
en 2018 dans l'industrie de l'armement aux
États-Unis a été la tendance croissante des
regroupements parmi certains des plus grands
producteurs d'armes. Par exemple, deux des cinq
premiers, Northrop Grumman et General Dynamics,
ont fait des acquisitions de plusieurs milliards
de dollars en 2018. SPIRI écrit : « 'Les
entreprises américaines se préparent pour le
nouveau programme de modernisation des armements
annoncé en 2017 par le président Trump',
explique Aude Fleurant, directrice du programme
Armes et dépenses militaires du SIPRI. ‘Les
grandes entreprises américaines fusionnent pour
pouvoir produire la nouvelle génération de
systèmes d'armes et ainsi être mieux placées pour
décrocher des contrats avec le gouvernement
américain.'
« Le résumé de la stratégie de défense nationale
des États-Unis pour 2018 publié par
l'administration du président Donald J. Trump a
déclaré que l'environnement de sécurité actuel
était caractérisé par une « concurrence
stratégique inter étatique » et que
l'avantage militaire américain s'était atrophié et
devait être rebâti afin de répondre à la
concurrence stratégique de la Chine et de la
Russie. Ce document souligne l'engagement des
États-Unis à poursuivre et à renforcer leur
programme de modernisation à grande échelle des
armes annoncé en 2017. Suite à cette annonce,
plusieurs entreprises américaines d'armes incluses
dans les 100 plus grandes entreprises ont
fusionné ou acquis en 2017 et 2018 les
secteurs d'activité d'autres sociétés, en partie
dans le but d'obtenir un avantage sur leurs
concurrents. Les transactions les plus importantes
incluaient l'acquisition par Northrop Grumman
d'Orbital-ATK, l'acquisition par United
Technologies de Rockwell Collins et l'acquisition
par General Dynamics de CSRA. Il y a également eu
des transactions de moindre envergure comme
l'acquisition par CACI International de la
division commerciale de General Dynamics et
l'acquisition par Engility du segment des
technologies de l'information (TI) de SAIC. »
« La principale motivation des regroupements
en 2017 et 2018 était le programme de
modernisation complet et ambitieux des États-Unis
visant à concevoir et produire une nouvelle
génération de systèmes d'armes. »
3. Outre des informations détaillées sur
les 100 plus grandes sociétés productrices
d'armes qui fournissent aussi des services
militaires : « Le SIPRI dispose
d'informations sur les dépenses militaires totales
pour chaque pays, avec une catégorie spécifique de
dépenses pour les armes. Les dépenses militaires
sont définies comme les dépenses militaires en
général, y compris les dépenses liées au personnel
(c.-à-d. les salaires et avantages sociaux des
troupes et du personnel civil), les opérations et
l'entretien (c.-à-d. les dépenses de fournitures
générales, de services et de transport),
l'équipement (par exemple, armes, autres
équipements militaires et équipement non
militaire), la construction (par exemple, des
bases militaires) et de la recherche et du
développement. »
Pour accéder au rapport complet 2018 de
SIPRI, en anglais, cliquer ici.

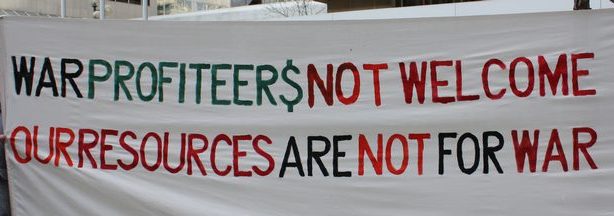
Le revenu brut mondial provenant des ventes
d'armes des 100 plus grandes sociétés de
production d'armes et de services militaires au
monde, à l'exclusion de la Chine, était
de 420 milliards de dollars en 2018, soit une
augmentation de 4,6 % par rapport
à 2017. Ce total annuel en dollars constants
de 2018 était de 47 % de plus
qu'en 2002. La croissance de 2017
à 2018 est principalement attribuable aux
ventes des cinq principales sociétés américaines
qui, selon l'Institut international de recherche
sur la paix de Stockholm (SIPRI), « peuvent être
attribuées à l'augmentation des dépenses
militaires mondiales, en particulier
l'augmentation des dépenses américaines
de 2017 à 2018 ».
Les ventes de 70 entreprises basées aux
États-Unis et en Europe
représentent 83 % du total des ventes
d'armes du Top 100. À 348 milliards de
dollars en 2018, leurs ventes d'armes
combinées étaient de 5,2 % supérieures à
celles de 2017, augmentation essentiellement
attribuable aux entreprises américaines. Les
ventes d'armes des sociétés du Top 100 basées
en Europe ont totalisé 102 milliards de
dollars en 2018 et une bonne partie de cette
production s'est faite aux États-Unis. Par
exemple, les ventes d'armes de la filiale
américaine de BAE Systems se sont élevées à
environ 10 milliards de dollars en 2018,
soit 48 % des ventes d'armes totales de
BAE Systems de 21,2 milliards de dollars.
Dix entreprises en Russie figurent dans le
Top 100 avec un revenu brut combiné
de 36,2 milliards de dollars. Le SIPRI
signale que, bien que ce chiffre soit resté
pratiquement inchangé par rapport à 2017,
leur part des ventes totales d'armes dans le
Top 100 est passée de 9,7 %
à 8,6 % en 2018 en raison de « la
croissance substantielle des ventes combinées
d'armes des entreprises américaines et
européennes ».
Le plus grand producteur d'armes de la Russie,
Almaz-Antey, était la seule entreprise russe
classée dans le Top 10 (au 9e rang) et
représentait 27 % du total des ventes
d'armes des entreprises russes dans le
Top 100. Les ventes d'armes d'Almaz-Antey ont
augmenté de 18 % en 2018, pour
atteindre 9,6 milliards de dollars, « en
raison non seulement de la forte demande
intérieure, mais également de la croissance
continue des ventes à l'étranger, en particulier
du système de défense aérienne S-400 », écrit
la chercheuse du SIPRI Alexandra Kuimova.
Vingt entreprises du Top 100 se trouvent en
dehors des États-Unis, d'Europe et de Russie. Six
sont au Japon, trois en Israël, en Inde et en
République de Corée (Corée du sud), deux en
Turquie et une à Singapour, en Australie et au
Canada (CAE Inc. au 87e rang avec 1,01
milliard de dollars de ventes d'armes, soit une
croissance sur un an de 19 %).
Les six sociétés japonaises ont réalisé un revenu
brut combiné de la vente d'armes de 9,9
milliards de dollars, ce qui
représente 2,4 % du total du
Top 100.
Les ventes d'armes de trois sociétés
israéliennes, d'une valeur de 8,7 milliards
de dollars, représentaient 2,1 % du
total du Top 100.
Les ventes d'armes combinées des trois sociétés
d'armes indiennes figurant dans le Top 100
s'élevaient à 5,9 milliards de dollars
en 2018.
Les trois sociétés basées en Corée du sud ont
réalisé des ventes d'armes combinées de 5,2
milliards de dollars en 2018,
soit 1,2 % du total du Top 100.
Les ventes d'armes des deux sociétés turques
figurant dans le Top 100 ont augmenté
de 22 % en 2018, pour
atteindre 2,8 milliards de dollars. Le SIPRI
écrit : « La Turquie cherche à développer et
à moderniser son industrie de l'armement et les
entreprises turques ont continué de bénéficier de
ces efforts en 2018. »

- Yves Engler -
La plupart des Canadiens seraient surpris
d'apprendre que le soleil ne se couche jamais sur
les Forces armées dont ils sont les contribuables.
Ce pays n'est pas officiellement en guerre et
pourtant plus de 2 100 soldats canadiens
sont déployés ici et là dans le monde. Selon les
Forces armées, ces soldats participent à 28
missions internationales.
 Il y a 850
troupes canadiennes en Irak et dans les environs.
Deux cents membres de forces spéciales hautement
qualifiées ont formé des forces kurdes et leur
fournissent du soutien au combat, ces mêmes forces
qui sont souvent accusées de nettoyage ethnique
dans les régions de l'Irak qu'elles ont capturées.
Un détachement d'hélicoptères tactiques, des
officiers du renseignement et un hôpital militaire
ainsi que 200 Canadiens, à partir d'une base
au Koweït, appuient les forces spéciales en Irak. Il y a 850
troupes canadiennes en Irak et dans les environs.
Deux cents membres de forces spéciales hautement
qualifiées ont formé des forces kurdes et leur
fournissent du soutien au combat, ces mêmes forces
qui sont souvent accusées de nettoyage ethnique
dans les régions de l'Irak qu'elles ont capturées.
Un détachement d'hélicoptères tactiques, des
officiers du renseignement et un hôpital militaire
ainsi que 200 Canadiens, à partir d'une base
au Koweït, appuient les forces spéciales en Irak.
Avec la mission des forces spéciales, le Canada
commande la mission de l'OTAN en Irak. La
brigadière générale Jennie Carigan commande près
de 600 soldats de l'OTAN, dont 250
Canadiens.
Un nombre comparable de troupes est stationné sur
les frontières de la Russie. Près de 600
Canadiens font partie d'une mission de l'OTAN
dirigée par le Canada en Lettonie et 200
soldats font partie d'un projet de formation en
Ukraine. Soixante-quinze membres du personnel des
Forces armées canadiennes sont présentement en
Roumanie.
Certaines opérations plus limitées sont cependant
hautement politiques. Sous l'égide d'Opération
Proteus, une douzaine de soldats contribuent au
Bureau de coordination de sécurité des États-Unis,
un soutien à l'appareil de sécurité mis en place
pour protéger l'Autorité palestinienne de la
colère populaire en raison de son acquiescement à
la colonisation israélienne continue.
Par le biais de l'Opération Fondation, 15
soldats contribuent aux efforts anti-terroristes
des États-Unis en Moyen-Orient, en Afrique du Nord
et en Asie du Sud-Ouest. En tant que participant à
l'Opération Fondation, le brigadier-général A.R.
Day, par exemple, dirige le Centre d'opérations
aérospatiales conjointes dans la base de l'armée
américaine d'Al Udeid au Qatar.
Au nombre des 2 100 soldats mentionnés
par l'armée, il faut ajouter les centaines, sinon
les milliers, de membres du personnel naval qui
patrouillent les points chauds partout dans le
monde. Récemment, un ou deux navires canadiens —
avec près de 200 membres du personnel chacun
— ont patrouillé l'Asie de l'Est. Les navires
apportent un renfort à la campagne des États-Unis
pour isoler la Corée du nord et appliquer les
sanctions de l'ONU. Ces navires canadiens ont
aussi participé à des exercices belliqueux «
liberté de naviguer » dans les eaux
internationales que revendique Pékin dans le sud
de la mer de Chine, le détroit de Taiwan et l'est
de la mer de Chine.
Un navire canadien patrouille aussi la mer
d'Arabie et le golfe Persique. Récemment, des
navires canadiens sont aussi entrés dans la mer
Noire, aux frontières de la Russie. Des navires
canadiens sont aussi fréquemment déployés dans les
Caraïbes.
Il faut ajouter aux 2 100 soldats les
colonels appuyés par des sergents et parfois un
second officier qui sont des attachés militaires
basés dans 30 postes diplomatiques partout
dans le monde (et qui ont des accréditations
transfrontalières dans les pays voisins).
Aussi, 150 membres du personnel militaire
sont stationnés dans le quartier général du
Commandement de défense aérospatiale de l'Amérique
du Nord au Colorado et un nombre plus restreint au
centre de NORAD près de Tampa Bay, en Floride. Ces
bases soutiennent des frappes américaines dans
plusieurs endroits.
Des dizaines de soldats canadiens sont stationnés
dans les quartiers généraux de l'OTAN à Bruxelles.
Ils assistent cette organisation dans ses
déploiements internationaux.
Il est possible qu'il y ait des déploiements qui
ne sont pas mentionnés ici. Des dizaines de
soldats canadiens participent à des programmes
d'échange avec les États-Unis et d'autres armées
et certains pourraient participer à des
déploiements à l'étranger. Aussi, les forces
spéciales canadiennes peuvent être déployées sans
que cela soit rendu public, comme cela s'est
produit à de nombreuses reprises.
L'ampleur de l'intervention militaire
internationale est incompatible avec l'idée d'une
force qui défend le Canada. C'est pourquoi des
représentants militaires parlent de l'importance
d'une « défense vers l'avant ». Selon Protection,
sécurité Engagement, qui énonce la politique
de défense du gouvernement canadien de 2017,
le Canada doit « répondre activement aux menaces à
l'étranger pour assurer la stabilité au
pays » et « la défense du Canada et des
intérêts canadiens requiert [...] un engagement
actif à l'étranger ».
Évidemment, cette logique peut servir à justifier
la participation du Canada à d'infinies activités
militaires dirigées par les États-Unis. Voilà la
vraie raison pour laquelle le soleil ne se couche
jamais sur les Forces armées canadiennes.

États-Unis
Le 18 décembre 2019, la Chambre des
représentants, où les représentants du Parti
démocrate sont majoritaires, a voté pour la
destitution du président Donald Trump en adoptant
deux motions : dans l'une, Trump est accusé
d'abus de pouvoir et dans l'autre d'obstruction au
Congrès. Selon le Règlement du Sénat, un procès de
destitution commence le lendemain du jour où la
Chambre dépose les articles de destitution à moins
que ce jour ne soit un dimanche. Une fois que le
Sénat est saisi, il doit d'abord voter sur les
règles pour le procès de destitution et déterminer
quels seront les témoins appelés/autorisés à
comparaître. Les républicains détiennent une
majorité de 53-47 au Sénat, et 67 voix
sont nécessaires pour condamner un président.
 Toutefois, après
avoir voté la mise en accusation du président, les
démocrates à la Chambre ont pris la décision de
retarder la transmission des chefs d'accusation au
Sénat. La présidente de la Chambre des
représentants, Nancy Pelosi, a parlé de la crainte
que les républicains qui dominent le Sénat ne
tiennent pas un « procès équitable ». En
clair, les démocrates ne sont ni d'accord avec les
règles que les républicains cherchent à établir
pour le procès au Sénat, ni avec les témoins
proposés, s'il y en a. C'est la première fois
qu'une procédure de destitution d'un président est
entamée alors que les deux chambres du Congrès ne
sont pas dominées par le même parti. Il n'est pas
clair si les tractations qui ont lieu donneront
satisfaction à l'un ou l'autre des partis dans
cette affaire. Étant donné la façon dont les
factions rivales parmi les dirigeants et leurs
représentants s'alignent actuellement, peu de gens
pensent que la destitution du président réussira.
Entre temps les deux chambres devraient prendre un
congé de deux semaines pour la période des fêtes. Toutefois, après
avoir voté la mise en accusation du président, les
démocrates à la Chambre ont pris la décision de
retarder la transmission des chefs d'accusation au
Sénat. La présidente de la Chambre des
représentants, Nancy Pelosi, a parlé de la crainte
que les républicains qui dominent le Sénat ne
tiennent pas un « procès équitable ». En
clair, les démocrates ne sont ni d'accord avec les
règles que les républicains cherchent à établir
pour le procès au Sénat, ni avec les témoins
proposés, s'il y en a. C'est la première fois
qu'une procédure de destitution d'un président est
entamée alors que les deux chambres du Congrès ne
sont pas dominées par le même parti. Il n'est pas
clair si les tractations qui ont lieu donneront
satisfaction à l'un ou l'autre des partis dans
cette affaire. Étant donné la façon dont les
factions rivales parmi les dirigeants et leurs
représentants s'alignent actuellement, peu de gens
pensent que la destitution du président réussira.
Entre temps les deux chambres devraient prendre un
congé de deux semaines pour la période des fêtes.
Cependant, il ressort clairement du spectacle qui
se donne à la Chambre des représentants que la
procédure de destitution ne force pas le président
à rendre compte de ses actes et que le tout sert à
priver le peuple américain d'un point de vue qui
favorise sa lutte pour s'investir du pouvoir.
« Le président doit rendre des comptes, personne
n'est au-dessus de la loi », a annoncé Nancy
Pelosi. La procédure de destitution est présentée
comme un mécanisme qui permet d'exiger des comptes
et, plus généralement, cette procédure est censée
envoyer le message au public que le « système
fonctionne » et qu'il n'est pas nécessaire de
lutter pour de nouveaux arrangements.
En fait, les dispositions actuelles ne règlent
pas les luttes intestines entre les factions de la
classe dirigeante. Le scénario deguerre civile
entre les factions dirigeantes aux États-Unis,
ainsi que les chefs d'accusation très limités de
destitution qui sont présentés - abus de pouvoir,
mais seulement en ce qui concerne l'affaire
Ukraine/Biden, et obstruction de la justice - font
douter que la procédure de destitution obligera le
président Trump à rendre des comptes.
Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne
les crimes qui préoccupent le plus le peuple, qui
sont complètement absents des chefs d'accusation
bien que les preuves soient accablantes. Il s'agit
notamment des actes criminels de séparation des
familles et des camps d'internement des enfants,
même de bébés. Il y a également les crimes de
guerre, ceux commis contre le Yémen, l'Irak et
l'Afghanistan avec l'utilisation de drones et
d'armes chimiques et d'autres armements. Ils
comprennent la punition collective de populations
entières en utilisant des sanctions comme celles
imposées au Venezuela, à Cuba, à la République
populaire démocratique de Corée, à l'Iran et à
bien d'autres pays.
Voice of Revolution, le journal de
l'Organisation marxiste-léniniste des États-Unis,
indique que les gens à travers le pays, ainsi que
ceux qui résident à l'étranger, mènent des
batailles pour les droits et exigent des
changements sur ces questions.[1] On lit dans le
journal :
« La procédure de destitution ne force pas le
gouvernement à rendre des comptes alors qu'il
refuse de le faire. Parmi les nombreuses actions
qui ont eu lieu, on compte les manifestations aux
États-Unis et les milliers d'autres
internationalement pour défendre la Terre Mère
le 29 novembre et la poursuite des
manifestations hebdomadaires partout à travers le
pays, la continuation des actions communes des
deux côtés de la frontière sud pour défendre les
migrants ainsi que le récent verdict de
non-culpabilité d'un militant qui a aidé deux
jeunes migrants à traverser le désert en Arizona,
les actions contre la guerre, notamment contre
l'OTAN à Londres, à New York et ailleurs, les
grèves des enseignants qui prennent leurs
responsabilités sociales sur des problèmes comme
l'itinérance et le manque de conseillers et
d'infirmières dans leurs écoles et bien d'autres
encore.
 « Ces batailles
pour la démocratie contribuent aux efforts
déployés partout au pays pour faire entendre la
voix des revendications du peuple et pour
l'affirmation de ses droits. Elles mettent en
évidence également la question centrale de la
bataille de la démocratie d'aujourd'hui, de qui
décide, la minorité ou la majorité ? La
bataille de la démocratie est la bataille pour
faire avancer le contenu et la forme de la
démocratie et mettre en place les institutions qui
la servent pour qu'elle corresponde à l'époque
moderne. Il faut donner au peuple, à la majorité,
le pouvoir de gouverner et de décider. C'est cette
démocratie qui mettrait en place les moyens pour
que soit respectée la volonté antiguerre et
prosociale du peuple qu'expriment les nombreuses
actions, réunions, pétitions, grèves. C'est
précisément ce que les dirigeants s'efforcent
d'empêcher. La procédure de destitution fait
partie de cet effort visant à entraîner tout le
monde à prendre parti pour et contre pour un camp
ou l'autre, tout en tentant de détourner la lutte
du peuple pour devenir lui-même le décideur. « Ces batailles
pour la démocratie contribuent aux efforts
déployés partout au pays pour faire entendre la
voix des revendications du peuple et pour
l'affirmation de ses droits. Elles mettent en
évidence également la question centrale de la
bataille de la démocratie d'aujourd'hui, de qui
décide, la minorité ou la majorité ? La
bataille de la démocratie est la bataille pour
faire avancer le contenu et la forme de la
démocratie et mettre en place les institutions qui
la servent pour qu'elle corresponde à l'époque
moderne. Il faut donner au peuple, à la majorité,
le pouvoir de gouverner et de décider. C'est cette
démocratie qui mettrait en place les moyens pour
que soit respectée la volonté antiguerre et
prosociale du peuple qu'expriment les nombreuses
actions, réunions, pétitions, grèves. C'est
précisément ce que les dirigeants s'efforcent
d'empêcher. La procédure de destitution fait
partie de cet effort visant à entraîner tout le
monde à prendre parti pour et contre pour un camp
ou l'autre, tout en tentant de détourner la lutte
du peuple pour devenir lui-même le décideur.
« La démocratie à l'américaine assure la
domination d'une petite minorité sur la majorité,
problème que la destitution ne résoudra pas. Elle
ne règle pas non plus le problème de la
responsabilisation. La Constitution et la loi
actuelle ne prévoient aucun mécanisme qui permette
au peuple de tenir le président responsable de ses
crimes. Le ministère de la Justice dit depuis
longtemps qu'il est inconstitutionnel de porter
des accusations contre un président en exercice et
il ne l'a pas fait. Un citoyen ne peut pas non
plus arrêter un président en exercice, car une
telle tentative serait bloquée par les services
secrets et des accusations portées contre le
citoyen.
« La nécessité d'un mécanisme par lequel le
peuple peut tenir le président responsable des
crimes amène au premier plan la nécessité de faire
avancer la bataille de la démocratie - la bataille
pour de nouvelles institutions de gouvernance, une
nouvelle constitution, qui inclut la
responsabilisation. Les gens n'aiment pas du tout
le fait que le gouvernement, en particulier le
président, ait la capacité de commettre des crimes
en toute impunité. Même les élections, qui
permettraient, dit-on, de régler ce problème, ne
permettent pas de porter des accusations
criminelles. En effet, comme la destitution, il
s'agit d'un autre mécanisme où le peuple ne décide
pas du résultat ; le résultat est décidé par
la minorité qui domine.
« La bataille de la démocratie est la lutte pour
le pouvoir politique, la bataille pour de nouveaux
arrangements qui permettent au peuple de gouverner
et de décider. Une nouvelle constitution et les
nouvelles institutions devraient servir à
harmoniser les relations humaines du présent,
l'ensemble des relations entre les êtres humains
et entre les êtres humains et la nature.
L'harmonisation et la responsabilisation sont
interreliées et c'est pourquoi cette question doit
également être abordée. Les pas faits aujourd'hui
dans cette direction comprennent l'intensification
des luttes organisées pour que le peuple, les
individus et les collectifs qui le composent,
puissent s'exprimer en leur nom, exprimer leurs
préoccupations et défendre leur propre ordre du
jour pour apporter les changements nécessaires.
Cela comprend la discussion et le débat sur le
problème de l'imputabilité, ce qu'il faut pour la
rendre possible et comment y parvenir en rapport
avec l'avancement de la bataille du peuple pour
gouverner et prendre des décisions. »
Note
1. Voice of Revolution, 13
décembre 2019

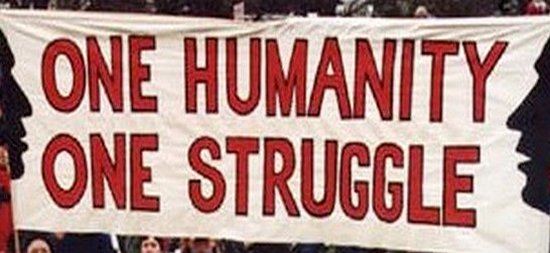 Par une variété de
moyens, des organisations de défense des droits de
l'immigration se font entendre et dénoncent les
détentions, les expulsions et la militarisation de
la frontière dans laquelle sont encore mobilisés
des milliers de soldats. Elles tiennent des
manifestations, font des propositions pour «
repenser » l'approche à l'immigration et
adopter des lois qui reconnaissent les droits,
fournissent de l'aide juridique et humanitaire sur
le terrain, de l'eau et de la nourriture par
exemple à ceux qui doivent traverser le désert,
font des poursuites judiciaires, etc. Par une variété de
moyens, des organisations de défense des droits de
l'immigration se font entendre et dénoncent les
détentions, les expulsions et la militarisation de
la frontière dans laquelle sont encore mobilisés
des milliers de soldats. Elles tiennent des
manifestations, font des propositions pour «
repenser » l'approche à l'immigration et
adopter des lois qui reconnaissent les droits,
fournissent de l'aide juridique et humanitaire sur
le terrain, de l'eau et de la nourriture par
exemple à ceux qui doivent traverser le désert,
font des poursuites judiciaires, etc.
Les revendications comprennent un moratoire
immédiat sur les expulsions et les détentions et
leur élimination. Elles appellent à « mettre
l'accent sur les droits des travailleurs » au
pays et à l'étranger, en considérant l'immigration
comme un enjeu mondial où les États-Unis
contribuent beaucoup à la violence et à la
dévastation qui frappent les peuples au pays et à
l'étranger. Il existe une reconnaissance que les
détentions et qu'un grand nombre des expulsions,
qui ont été faites sous Bush et Obama, sont des
crimes. Le gouvernement continue d'agir en toute
impunité et personne ne rend de comptes pour les
morts, la violence et la séparation de familles
qui se produisent sur une base quotidienne.
Les résidents des villes dans tout le pays
dénoncent régulièrement la séparation des familles
et les détentions, en particulier celles des
enfants. Plusieurs disent que « tout cela n'est
pas mon Amérique » et se joignent aux luttes
pour les droits et pour une nouvelle direction du
pays qui est prosociale et prohumanité.
En opposition à ce que réclame le public, les
camps de détention continuent de se répandre, ce
qui indique qu'ils ne sont pas uniquement pour les
immigrants et les réfugiés, mais pour ceux qui
font du travail d'organisation et que le
gouvernement cible en tant que « menaces ».
Ou alors, comme cela s'est déjà produit, ils sont
accusés de trafic humain simplement pour avoir
fourni de l'aide à des immigrants sans papiers.
Cela veut donc dire que non seulement le
gouvernement ne rend pas de comptes, mais qu'il
criminalise ceux qui organisent la défense des
droits. La militarisation accrue de la frontière
et les camps de détention dans des installations
militaires indiquent de manière toujours plus
claire que, loin de résoudre quelque problème que
ce soit, le gouvernement criminalise encore plus
la résistance, y compris l'aide humanitaire.
Les différentes organisations qui défendent les
droits au pays et à l'étranger contribuent à
ouvrir une voie qui défend les intérêts des
peuples. C'est cet esprit et cette prise de
position que personne n'est illégal et que nous
formons une seule humanité engagée dans une seule
lutte pour nos droits que nous allons renforcer le
travail qui est organisé.


La nécessité d'une
politique indépendante de la classe ouvrière
et d'une direction prosociale antiguerre pour
l'économie
Dans une série d'articles, les médias de masse
ont dressé un sombre tableau des conditions de vie
inhumaines aux États-Unis. Ils ont décrit les
conditions sociales intenables de nombreuses
personnes dans les villes de la Californie et du
nord-ouest, de New York et d'ailleurs. Ville après
ville, des milliers de personnes vivent dans les
rues et dans les parcs, avec un accès limité à des
installations sanitaires et aux autres services
publics. La situation du logement des travailleurs
de la Silicon Valley est si désespérée qu'Apple a
décidé d'investir 2,5 milliards de dollars
pour construire des logements locatifs pour ses
travailleurs et d'autres sur des terrains qu'elle
possède à San Francisco.
Le New York Times a détaillé de graves
problèmes sociaux en matière de soins de santé,
d'éducation, de logement et l'influence
corruptrice des gros capitaux du système des
partis cartellisés démocrate et républicain. Les
articles laissent entendre que l'inégalité de la
richesse sociale entre riches et pauvres est le
problème fondamental et non le symptôme d'un
problème plus profond, et qu'une répartition de la
richesse accumulée est nécessaire pour résoudre
les problèmes sociaux.
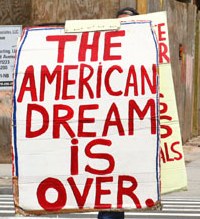 D'autres articles
réfutent cette approche et affirment que le « rêve
américain » de devenir riche et de faire «
chacun pour soi » a permis à la nation de
dominer les affaires mondiales et que la
répartition de la richesse est contraire au « mode
de vie américain ». Le conflit est souvent
présenté comme une différence dans les visions du
monde et les énoncés de politique des deux partis
cartellisés établis et au sein du Parti démocrate. D'autres articles
réfutent cette approche et affirment que le « rêve
américain » de devenir riche et de faire «
chacun pour soi » a permis à la nation de
dominer les affaires mondiales et que la
répartition de la richesse est contraire au « mode
de vie américain ». Le conflit est souvent
présenté comme une différence dans les visions du
monde et les énoncés de politique des deux partis
cartellisés établis et au sein du Parti démocrate.
Les articles sur l'inégalité des richesses
s'appuient, entre autres, sur les recherches
récentes des économistes Emmanuel Saez et Gabriel
Zucman, qui figurent dans leur livre Le
Triomphe de l'injustice : Comment les
riches esquivent les impôts et comment faire
pour qu'ils les payent, dans lequel ils
soutiennent que la concentration de la richesse
dans les mains de quelques-uns est devenue si
grande qu'elle devient intenable, ce qui entraîne
des problèmes sociaux non résolus que seule une
augmentation de l'impôt pour les riches peut
résoudre.
Les données révèlent que 400 familles
américaines possèdent actuellement plus de
richesses sociales que la population totale de
personnes d'ascendance africaine, soit
environ 48 millions, plus le quart de celles
d'ascendance latino-américaine et hispanique, soit
un autre 14 millions. La tranche la plus
riche des 0,1 % a accaparé une partie
presque trois fois plus grande de la richesse
sociale des États-Unis, passant de 7 %
à 20 %, entre la fin des
années 1970 et 2016, tandis que la
tranche inférieure des 90 % a vu sa part
de la richesse passer de 35 % à
25 %.
Les 130 000 familles les plus riches
des États-Unis détiennent maintenant presque
autant de richesse sociale que les 117
millions de familles les plus pauvres réunies.
Le 1 % supérieur possède 42 %
de l'ensemble de la richesse sociale du pays. Les
articles ne précisent pas ce qui constitue la
richesse à part donner des références générales
sur la propriété d'actions et d'obligations, la
propriété de sociétés et de biens immobiliers, des
maisons, des voitures, des revenus disponibles,
etc.
De cette masse de richesses accumulées et
d'investissements, de propriété de biens et de
sociétés et de postes de cadres dirigeants et
d'administrateurs, les individus les plus riches,
qui représentent 1 % de la population
totale, réalisent des revenus annuels
correspondant à 20 % du total des
revenus déclarés aux États-Unis. Cependant, les
revenus déclarés par la grande majorité des
travailleurs ne proviennent pas des
investissements et de la propriété, mais de la
vente de leur capacité de travail à ceux qui
possèdent et contrôlent l'économie socialisée.
Selon les recherches sur les impôts effectuées
par Saez et Zucman, les familles dans la tranche
du 0,1 % les plus riches vont
devoir 3,2 % de leur richesse et de
leurs revenus totaux en impôts fédéraux, étatiques
et locaux pour 2019, tandis que
les 99 % de la tranche inférieure vont
devoir 7,2 % de leur richesse et de
leurs revenus accumulés.
Les données et les analyses sont centrées sur la
possession et la distribution de la richesse
sociale sous forme d'argent. À partir de là,
l'analyse aboutit à la conclusion que
l'augmentation de la charge fiscale des riches
réglera les problèmes auxquels le peuple fait
face. Mais le manque d'argent est-il la cause des
terribles conditions et problèmes sociaux ?
 Saez et Zucman
invoquent une période de l'histoire des
États-Unis, du début de la Deuxième Guerre
mondiale aux années 1970, où les riches
payaient beaucoup plus d'impôts et où leur part de
la richesse était le tiers de celle qu'ils
contrôlent aujourd'hui. Or, cela n'a pas mené à la
réalisation du droit de tous à la santé, à
l'éducation, au logement, à des installations
sanitaires et à la sécurité durant la retraite et
lorsqu'ils sont blessés, malades ou handicapés.
L'augmentation des fonds entre les mains du
gouvernement par rapport à la richesse sociale
totale pendant et après la Deuxième Guerre
mondiale a mené à la militarisation de l'économie
américaine. L'élite dirigeante des États-Unis n'a
pas utilisé l'augmentation des fonds pour garantir
les droits des Américains avec des programmes
sociaux étendus et des services publics gratuits,
mais pour établir des milliers de bases militaires
aux États-Unis et dans le monde entier, mener des
guerres incessantes sous le drapeau impérialiste
de « l'endiguement du communisme » et
construire son arsenal d'armes modernes, notamment
des flottes militaires, des avions de guerre, des
chars, de l'artillerie, des fusils d'assaut et un
grand nombre de bombes et de missiles nucléaires. Saez et Zucman
invoquent une période de l'histoire des
États-Unis, du début de la Deuxième Guerre
mondiale aux années 1970, où les riches
payaient beaucoup plus d'impôts et où leur part de
la richesse était le tiers de celle qu'ils
contrôlent aujourd'hui. Or, cela n'a pas mené à la
réalisation du droit de tous à la santé, à
l'éducation, au logement, à des installations
sanitaires et à la sécurité durant la retraite et
lorsqu'ils sont blessés, malades ou handicapés.
L'augmentation des fonds entre les mains du
gouvernement par rapport à la richesse sociale
totale pendant et après la Deuxième Guerre
mondiale a mené à la militarisation de l'économie
américaine. L'élite dirigeante des États-Unis n'a
pas utilisé l'augmentation des fonds pour garantir
les droits des Américains avec des programmes
sociaux étendus et des services publics gratuits,
mais pour établir des milliers de bases militaires
aux États-Unis et dans le monde entier, mener des
guerres incessantes sous le drapeau impérialiste
de « l'endiguement du communisme » et
construire son arsenal d'armes modernes, notamment
des flottes militaires, des avions de guerre, des
chars, de l'artillerie, des fusils d'assaut et un
grand nombre de bombes et de missiles nucléaires.
L'État des États-Unis ne manque pas d'argent. Son
budget de guerre annuel s'élève à environ un
billion de dollars et des milliards de plus sont
consacrés à la « sécurité intérieure », à
d'innombrables agences d'espionnage et de police
internes et externes, à l'ingérence «
diplomatique » dans les affaires souveraines
d'autrui, aux stratagèmes pour payer les riches
pour la grande entreprise, à la propagande
impérialiste pro-guerre, à l'armement de
mercenaires et aux prisons pour incarcérer plus de
deux millions de ses citoyens.
La recherche et la série d'articles dans les
médias de masse qui mènent à la conclusion que la
cause de l'impossibilité de résoudre les problèmes
est le manque d'argent ne tiennent pas compte des
rapports de production dépassés entre la classe
ouvrière et l'oligarchie financière et de la
contradiction entre le caractère socialisé de
l'économie et son contrôle par des intérêts privés
concurrents, qui sont la racine du problème de
l'inégalité et du manque de pouvoir des
travailleurs face à leurs conditions. Ceux qui
travaillent et vendent leur capacité de travail
aux riches n'ont aucun contrôle économique ou
politique sur l'économie et n'ont accès qu'à la
partie de la valeur nouvelle qu'ils produisent qui
leur est versée en salaires et par les programmes
sociaux qui existent en échange de leur capacité à
travailler.
Les riches qui possèdent et contrôlent les forces
productives, la direction de l'économie et le
système politique de partis cartellisés des partis
démocrate et républicain exproprient la valeur
ajoutée de la valeur nouvelle que les travailleurs
produisent. La fiscalité est devenue un moyen
général de l'oligarchie financière pour reprendre
aux travailleurs ce qui leur a été payé en échange
de leur capacité de travailler. L'élite dirigeante
des factions concurrentes de l'oligarchie
financière et leurs représentants politiques
contrôlent la manière dont cette valeur est
distribuée et utilisée. Les rapports de production
dominants dictent le contrôle des impérialistes
dominants sur l'économie et sa direction. La
politique du système de partis cartellisés des
partis démocrate et républicain reflète le
contrôle et la domination des factions
concurrentes de l'élite dirigeante.
La plupart des programmes sociaux, comme
l'éducation et les soins de santé, augmentent la
valeur de la capacité de travailler de la classe
ouvrière. Les entreprises qui consomment cette
valeur devraient la payer non pas sous forme
d'impôts, mais en payant directement les
institutions qui produisent la valeur. Pour
accroître la valeur reproduite individuelle et
sociale, il faut prendre des mesures pour
accroître les investissements dans les programmes
sociaux et les services publics gratuits,
augmenter les salaires, les pensions et les
avantages sociaux des travailleurs, arrêter de
payer les riches et donner une nouvelle
orientation antiguerre et prosociale à l'économie.
La classe ouvrière des États-Unis fait face à une
lutte de classe pour s'organiser comme force
sociale viable capable de défendre ses droits,
d'obliger les riches à augmenter la valeur
reproduite que les travailleurs reçoivent en
échange de leur capacité de travail et, par sa
propre politique indépendante, d'ouvrir la voie du
renouveau démocratique et à une nouvelle direction
de l'économie.
Le programme politique indépendant et le projet
d'édification de la nation de la classe ouvrière
et de ses alliés pour se donner le pouvoir par le
renouveau démocratique doivent comprendre
l'augmentation des investissements dans les
programmes sociaux et des services publics
gratuits pour garantir les droits de tous et de
toutes, ainsi que des actions pour arrêter de
payer les riches et pour démanteler l'économie de
guerre et donner à l'économie une nouvelle
direction prosociale. Cela peut être accompli par
le développement de la politique indépendante
organisée de la classe ouvrière et de sa propre
pensée, conception du monde et ordre du jour
contre la politique, la conception du monde et
l'ordre du jour des riches et leur système
politique de partis cartellisés des factions
concurrentes de l'oligarchie financière.
La classe ouvrière et ses alliés doivent
développer leur propre politique indépendante,
leurs médias, leur voix et leur personnalité
démocratique. Ils ne peuvent pas compter sur les
riches et leurs représentants politiques du
système de partis cartellisés et des médias de
masse pour agir ou parler en leur nom, pour
résoudre les problèmes sociaux auxquels le pays
fait face, donner une nouvelle direction
prosociale et antiguerre à l'économie et au pays
et ouvrir la voie à l'émancipation de la classe
ouvrière.

Développements en Amérique latine
et dans les Caraïbes
- Déclaration du XVIIe Sommet des
chefs d'État et de gouvernement de l'ALBA-TCP -

1. Les chefs d'État et de gouvernement et les
chefs de délégations des pays membres et invités
de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de
Notre Amérique-Traité de commerce entre les
peuples (ALBA-TCP), se sont réunis à La Havane à
l'occasion du 15e anniversaire de l'Alliance,
fondée par Fidel Castro et Hugo Rafael Chavez,
avec la ferme volonté de l'approfondir en tant
qu'expression des aspirations à l'indépendance
régionale et rempart de l'intégration face aux
menaces croissantes contre l'autodétermination, la
souveraineté, la paix et la stabilité régionales.[1]
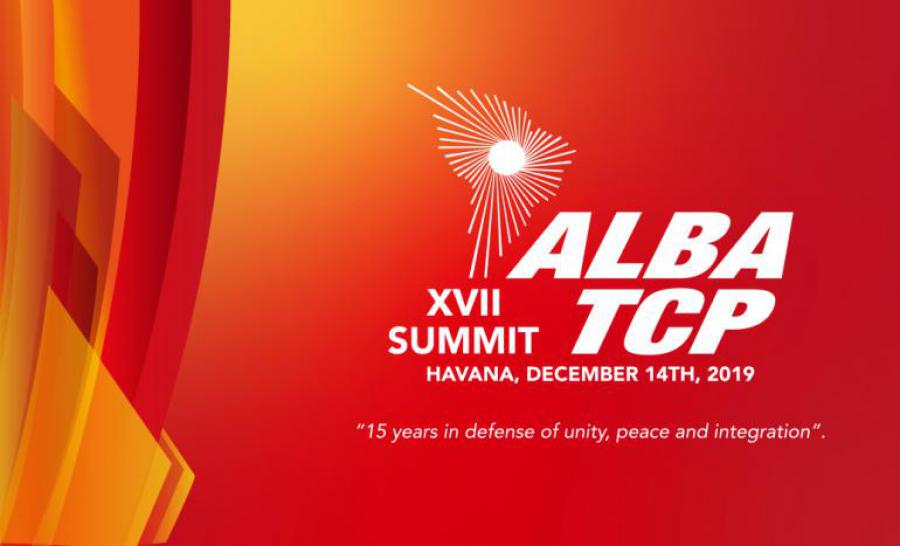 2. Nous
revendiquons les idées de Bolivar, Marti, San
Martin, Sucre, O'Higgins, Petion, Morazan,
Sandino, Maurice Bishop, Garvey, Tupac Katari,
Bartolina Sisa, Chatoyer et d'autres héros de
l'indépendance. 2. Nous
revendiquons les idées de Bolivar, Marti, San
Martin, Sucre, O'Higgins, Petion, Morazan,
Sandino, Maurice Bishop, Garvey, Tupac Katari,
Bartolina Sisa, Chatoyer et d'autres héros de
l'indépendance.
3. Nous soulignons que l'unité et l'intégration
régionales sont le seul moyen de faire face à la
domination exercée par les structures hégémoniques
du pouvoir mondial, qui ont laissé nos peuples
dans une situation historique de subordination.
4. Nous exprimons que l'ALBA-TCP est le premier
front d'intégration authentiquement
latino-américain et caribéen, fondé sur les
principes de solidarité, de justice sociale, de
défense de l'indépendance et de la souveraineté,
d'autodétermination des peuples, de coopération et
de complémentarité économiques, fruit de la
profonde vocation intégrationniste de ses membres
et de leur volonté politique de progresser
ensemble vers un développement durable.
5. Nous soulignons les réalisations sociales de
l'ALBA-TCP, axées sur les êtres humains, sans
distinction d'origine ethnique, sociale, de
croyance ou de position politique.
6. Nous soulignons le Programme
d'alphabétisation, la mission Miracle, le
programme de soins pour les handicapés, le
Programme de cardiologie pour enfants d'Amérique
latine, la formation de médecins intégraux à
l'École latino-américaine de médecine à Cuba et au
Venezuela, et PetroCaribe, ainsi que les Maisons
de l'ALBA, les Jeux sportifs ALBA, TeleSur et
Radio del Sur.
7. Nous soulignons les progrès réalisés par
l'ALBA-TCP dans le domaine économique et
financier, notamment 11 ans après la création
de la Banque de l'ALBA, période au cours de
laquelle divers projets ont été mis en oeuvre.
8. Nous ratifions notre engagement à construire
un modèle alternatif de souveraineté économique,
exprimé dans une Nouvelle architecture financière,
afin de consolider un système d'échanges et de
coopération solidaire, participatif et
complémentaire.
9. Nous réaffirmons notre volonté de continuer à
travailler et à coopérer dans la lutte contre le
changement climatique, un phénomène qui est le
produit du système capitaliste, avec ses modes de
production et de consommation irrationnels
10. Nous mettons l'accent sur la participation et
la pleine présence des mouvements sociaux, des
mouvements de solidarité et des secteurs
populaires dans le processus d'intégration, afin
de progresser dans la construction de sociétés
inclusives, culturellement diverses et
responsables.
11. Nous condamnons la politique agressive et
interventionniste du gouvernement des États-Unis
qui, avec la complicité des oligarchies nationales
et des médias corporatifs, associée aux
conséquences de l'application brutale de modèles
néolibéraux inhumains, sont les principales causes
de la dangereuse instabilité régionale.
12. Nous rappelons que la politique actuelle du
gouvernement des États-Unis à l'égard de Notre
Amérique pose des problèmes qui entraînent des
violations manifestes des principes consacrés par
la Charte des Nations unies et le droit
international, ainsi que des postulats de la
Proclamation de l'Amérique latine et des Caraïbes
comme Zone de paix.
13. Nous rejetons les menaces de recours à la
force du gouvernement des États-Unis contre la
République bolivarienne du Venezuela et le
maintien et l'expansion des mesures coercitives
unilatérales criminelles contre son peuple. Nous
manifestons notre soutien à la Révolution
bolivarienne, à l'unité civile et militaire de son
peuple et au président constitutionnel du
Venezuela.
14. Nous rejetons l'activation du Traité
interaméricain d'assistance réciproque (TIAR)
contre la République bolivarienne du Venezuela,
qui représente un danger pour la paix, et pourrait
faciliter la fabrication d'un prétexte et jeter
les bases pour une éventuelle intervention
militaire.
15. Nous condamnons le coup d'État contre le
gouvernement constitutionnel d'Evo Morales en
Bolivie, qui constitue une expression claire de la
stratégie impérialiste des États-Unis et de leur
intention permanente de violer l'autodétermination
de nos peuples. La complicité de l'oligarchie
bolivienne dans l'attaque violente contre les
institutions démocratiques et le soutien d'autres
oligarchies de la région à cette violation
flagrante de l'État de droit et des droits de
l'Homme, ne laissent planer aucun doute.
16. Nous soulignons qu'en vue de récupérer les
espaces conquis par les peuples avec des
gouvernements progressistes, le gouvernement des
États-Unis, en collusion avec les oligarchies de
la région, relance des méthodes qui semblaient
avoir été surmontées en Amérique latine et
applique de nouvelles formules de guerre non
conventionnelle.
17. Nous dénonçons le fait qu'en Bolivie,
l'intolérance, le racisme et la répression brutale
contre les mouvements sociaux et les peuples
autochtones se sont multipliés, avec la ferme
volonté de renverser les acquis obtenus sous la
présidence d'Evo Morales Ayma.
18. Nous dénonçons le fait que les menaces et les
tentatives répétées de déstabilisation contre le
gouvernement légitime de la République soeur du
Nicaragua constituent une violation du Droit
international. Le gouvernement sandiniste du
Nicaragua et son président, Daniel Ortega
Saavedra, comptent sur notre solidarité et notre
soutien.
19. Nous exprimons notre solidarité avec le
peuple frère du Commonwealth de la Dominique et
félicitons le premier ministre Roosevelt Skerrit
pour sa réélection
20. Nous rejetons les actions d'ingérence contre
le Suriname et les tentatives de déstabilisation
de ce pays. Le gouvernement constitutionnel du
Suriname et son président, Desiré Bouterse,
comptent sur notre solidarité et notre soutien.
21. Nous rejetons fermement l'application de la
Doctrine Monroe. Nous exigeons le respect de
l'autodétermination de nos peuples, de la
souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la
non-ingérence dans les affaires intérieures des
États, le règlement pacifique des différends
internationaux, le rejet du recours ou de la
menace du recours à la force, tout en dénonçant le
recours à des méthodes de guerre non
conventionnelles pour renverser des gouvernements
légitimes et l'imposition de mesures coercitives
unilatérales.
22. Nous déclarons que la montée des
gouvernements néolibéraux au pouvoir politique
dans la région a entraîné un renversement évident
des politiques sociales dans plusieurs pays, une
augmentation des taux de pauvreté et des
inégalités sociales.
23. Nous déclarons que la corruption croissante
des gouvernements néolibéraux, leur exercice du
pouvoir pour maximiser les profits des sociétés
transnationales et des élites privilégiées ;
la violence et la brutalité policière, ont
provoqué l'explosion de manifestations dans Notre
Amérique.
24. Nous dénonçons le mensonge inventé par les
États-Unis voulant attribuer aux membres de cette
Alliance la responsabilité dans l'organisation des
protestations populaires massives dans la région
25. Nous condamnons la distorsion honteuse de la
réalité latino-américaine par les États-Unis et
les élites oligarchiques de la région qui
cherchent à cacher la véritable origine des
manifestations.
26. Nous rejetons les champions autoproclamés des
droits de l'Homme et de la démocratie, qui ont de
plus en plus recours à la militarisation et à la
répression pour soutenir le modèle néolibéral en
crise. Le soutien de plusieurs gouvernements à la
répression brutale dans plusieurs pays et le
silence complice d'autres pays est inacceptable.
27. Nous condamnons les actions systématiques du
gouvernement des États-Unis visant à discréditer
et à saboter la coopération internationale fournie
par Cuba dans le domaine de la santé dans des
dizaines de pays, qui a bénéficié à des millions
de personnes, ainsi que les pressions énormes
exercées contre plusieurs gouvernements pour
interrompre l'accueil de la coopération cubaine.
28. Nous saluons l'adoption par l'Assemblée
générale des Nations Unies de la résolution
intitulée « Nécessité de lever le blocus
économique, commercial et financier imposé à Cuba
par les États-Unis d'Amérique » par 187
voix pour, ce qui démontre une fois de plus
l'isolement massif du gouvernement étasunien. La
décision regrettable du gouvernement brésilien de
voter contre, et du gouvernement colombien de
s'abstenir, confirme la prise en otage de leurs
politiques par des secteurs ouvertement soumis aux
intérêts de la Maison-Blanche.

Programme politique et culturel de célébration
du 15e anniversaire de l'ALBA-TCP le
14 décembre 2019 sur le grand escalier de
l'Université de La Havane
29. Nous exprimons notre solidarité avec les pays
frères des Caraïbes, qui ont subi le génocide de
leurs populations autochtones, les horreurs de
l'esclavage, la traite transatlantique et le
pillage colonial et néocolonial, et qui sont
aujourd'hui confrontés aux défis résultant du
changement climatique, des catastrophes naturelles
et du système financier injuste. Nous réaffirmons
le droit des pays des Caraïbes à un traitement
équitable, spécial et différencié. Les Caraïbes
trouveront toujours en l'ALBA-TCP une plateforme
d'articulation, de coopération et de
complémentarité.
30. Nous exprimons notre désir d'unité et
d'intégration qui confirme l'importance de la
Communauté des États d'Amérique latine et des
Caraïbes (CELAC), véritable mécanisme de promotion
des intérêts communs de nos nations. À cet égard,
nous nous engageons à soutenir le Mexique dans
l'exercice de la présidence tournante de la
Communauté.
31. Nous nous félicitons de l'adhésion
d'Antigua-et-Barbuda en tant que membre à part
entière de la Banque de ALBA.
32. Les défis auxquels nous sommes confrontés
réaffirment la nécessité de resserrer les rangs
face aux menaces, aux interférences et aux
agressions extérieures. Unis, nous affronterons
l'interventionnisme et les coups d'État. Nous
sommes animés par la profonde conviction que la
construction de l'avenir meilleur que nous
désirons et pour lequel nous travaillons est entre
les mains des peuples libres.
33. Garantissons la réalisation des droits à la
vie, à la paix, à l'autodétermination et au
développement de nos peuples. Unissons-nous !
La victoire des justes causes que nous
revendiquons dépend de l'unité.
« Nous recherchons la solidarité non pas comme
une fin en soi, mais comme un moyen de réaliser la
mission universelle de Notre Amérique » - José
Martí, Notre Amérique
La Havane, le 14 décembre 2019

Réunion du chapitre d'Ottawa des Mouvements
sociaux ALBA le 9 novembre 2019 pour discuter
des luttes des peuples d'Amérique latine contre
l'impérialisme et le néolibéralisme
Note
1. Antigua-et-Barbuda,
Cuba, la Dominique, la Grenade, le Nicaragua,
Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie,
Saint-Vincent-et-les Grenadines, le Suriname et le
Venezuela sont actuellement membres de l'ALBA-TCP.

- Ministère des Relations
extérieures de Cuba -

Rassemblement devant le Musée des beaux-arts de
Vancouver le 3 décembre 2019 en appui aux luttes
du peuple chilien et des autres peuples d'Amérique
latine contre le néolibéralisme et la répression
d'État
Les événements les plus récents dans la région
confirment le gouvernement des États-Unis et les
oligarchies réactionnaires comme les principaux
responsables des dangereux bouleversements et de
l'instabilité politique et sociale en Amérique
latine et dans les Caraïbes.
Comme nous en avait prévenu le Premier secrétaire
du Parti communiste de Cuba, le général d'armée
Raul Castro Ruz, dans son discours du 1er
janvier 2019 : « Ceux qui se bercent
d'illusions avec la restauration du pouvoir
impérialiste dans notre région devraient
comprendre que l'Amérique latine et les Caraïbes
ont changé, tout comme le monde. (...) La région
ressemble à une grande prairie en période de
sécheresse. Une étincelle pourrait provoquer un
incendie incontrôlable qui nuirait aux intérêts
nationaux de tous. »
Le Président Donald Trump proclame la validité de
la Doctrine Monroe et fait appel au maccartisme
afin de préserver la domination impérialiste sur
les ressources naturelles de la région ;
entraver l'exercice de la souveraineté nationale
et les aspirations d'intégration et de coopération
régionales ; tenter de rétablir son hégémonie
unipolaire à l'échelle mondiale et
continentale ; en finir avec les modèles
progressistes, révolutionnaires et alternatifs au
capitalisme sauvage ; inverser les conquêtes
politiques et sociales et imposer des modèles
néolibéraux, sans se soucier du Droit
international, des règles du jeu de la démocratie
représentative, de l'environnement ou du bien-être
des peuples.
Le lundi 2 décembre, le secrétaire d'État
Mike Pompeo a proféré des menaces contre Cuba et
le Venezuela, les accusant de tirer profit de
l'agitation dans les pays de la région et de
l'attiser. Il déforme et manipule la réalité et il
occulte le fait que l'intervention permanente des
États-Unis en Amérique latine et dans les Caraïbes
est l'élément central de l'instabilité régionale.
Les manifestations légitimes et les mobilisations
populaires massives qui ont lieu sur le continent,
notamment dans l'État plurinational de Bolivie, au
Chili, en Colombie, en Équateur et au Brésil, sont
causées par la pauvreté et l'inégalité croissante
dans la répartition de la richesse ; la
conviction que les formules néolibérales aggravent
la situation insoutenable d'exclusion et de
vulnérabilité sociales ; l'absence ou la précarité
des services de santé, d'éducation et de sécurité
sociale ; les atteintes à la dignité
humaine ; le chômage et la restriction des
droits du travail ; la privatisation,
l'augmentation des prix et la suppression des
services publics, ainsi que l'augmentation de
l'insécurité des citoyens.


Manifestations à Montréal le 1er décembre 2019
(haut) et à Calgary le 26 octobre 2019, deux parmi
les nombreuses manifestations tenues partout au
Canada en appui à la lutte courageuse du peuple
chilien pour l'affirmation de ses droits face à la
répression brutale de l'État chilien
Ces formules révèlent la crise des systèmes
politiques, l'absence d'une véritable démocratie,
le discrédit des partis conservateurs
traditionnels, la protestation contre la
corruption historique caractéristique des
dictatures militaires et des gouvernements de
droite, le faible soutien populaire aux autorités
officielles et la méfiance à l'égard des
institutions et du système judiciaire.
Les gens protestent également contre la
répression policière brutale, la militarisation de
la police sous prétexte de protéger les
infrastructures critiques, l'exonération de
responsabilité pénale pour les répresseurs,
l'utilisation d'armes de guerre et antiémeutes qui
causent des morts, des blessures graves, y compris
des centaines de jeunes ayant subi des blessures
irréversibles aux yeux par l'utilisation de balles
de caoutchouc, la criminalisation des
manifestations, les viols, les passages à tabac et
la violence contre les détenus, dont des mineurs,
et aussi l'assassinat de dirigeants sociaux, de
guérilleros démobilisés et de journalistes.
Les États-Unis défendent et soutiennent la
répression contre les manifestants sous prétexte
de sauvegarder le soi-disant « ordre
démocratique ». Le silence complice de
plusieurs gouvernements, institutions et
personnalités qui s'avèrent très actifs et
critiques à l'égard de la gauche est une honte. La
complicité des grands médias est une ignominie.
Les peuples se demandent à juste titre : où
est la démocratie et l'État de Droit ? Que
font les institutions censées se consacrer à la
protection des droits humains et où est le système
judiciaire dont on proclame l'indépendance ?
Revenons sur quelques faits. En mars 2015,
le président Barack Obama signe un Décret exécutif
saugrenu déclarant la République bolivarienne du
Venezuela comme « une menace inhabituelle et
extraordinaire pour la sécurité nationale,
l'économie et la politique extérieure » de
cette grande puissance.
En novembre 2015 a lieu la coûteuse défaite
électorale de la gauche en Argentine.
L'offensive néolibérale connaît un moment décisif
en août 2016, avec le coup d'État
parlementaire et judiciaire au Brésil contre la
présidente Dilma Rousseff, la criminalisation et
l'emprisonnement des dirigeants du Parti des
travailleurs, et plus tard de l'ancien président
Luiz Inacio Lula Da Silva, avec la participation
précoce du Département de la Justice des
États-Unis, à travers la Loi sur la corruption
dans les transactions à l'étranger, visant à
installer un gouvernement sous sa dépendance, prêt
à inverser d'importantes conquêtes sociales par le
biais d'ajustements néolibéraux, à effectuer des
changements nuisibles au modèle de développement,
à permettre la destruction de l'entreprise
nationale et la spoliation par la
privatisation ; à vendre à bas prix les
ressources et l'infrastructure du pays aux
sociétés transnationales étasuniennes.
Fin 2017, une manifestation a eu lieu au
Honduras contre le résultat électoral, laquelle
fut violemment réprimée.
En janvier 2018, les États-Unis font échouer
la signature d'un accord entre le gouvernement
vénézuélien et l'opposition manipulée depuis
Washington. Un mois plus tard, le secrétaire
d'État proclame l'actualité de la Doctrine Monroe
et appelle à un coup d'État militaire contre la
Révolution bolivarienne et chaviste.
En mars 2018, l'assassinat atroce de la
conseillère municipale brésilienne Marielle Franco
suscite une vague d'indignation dans son pays et
dans le monde, alors que les sombres implications
des groupes de pouvoir sont encore inconnues. En
avril, Lula est emprisonné sur la base de
manoeuvres juridiques fallacieuses. On ne compte
pas les innombrables preuves de l'intervention des
États-Unis dans les élections brésiliennes par le
biais de sociétés spécialisées qui utilisent des
technologies de « mégadonnées » et de
polymétrie pour manipuler la volonté des électeurs
de façon individuelle, comme celles utilisées par
l'ultraréactionnaire Steve Bannon et autres
Israéliens.

Manifestation à Toronto le 4 février 2019 pour
dénoncer le leadership canadien dans le Groupe de
Lima
et dire : « Ne touchez pas au Venezuela ! »
Au cours de cette période, des procédures
judiciaires sont ouvertes contre les anciens
présidents Cristina Fernandez de Kirchner et
Rafael Correa. En avril 2018, les États-Unis
tentent de déstabiliser le Nicaragua par des
ingérences extérieures et l'application de mesures
coercitives unilatérales.
Le 4 août 2018 se produit la tentative
d'assassinat contre le président Nicolas Maduro
Moros. En janvier 2019, organisée depuis
Washington, a lieu l'autoproclamation de Juan
Guaido, un inconnu corrompu. En mars 2019, le
président Trump renouvelle le Décret exécutif qui
qualifie le Venezuela de menace. Le 30 avril,
la tentative de coup d'État militaire à Caracas
est un échec spectaculaire, si bien que les
États-Unis, de façon vindicative, montent d'un
cran leur guerre non conventionnelle contre la
nation sud-américaine qui résiste avec ténacité et
héroïsme en s'appuyant sur l'union civique et
militaire de son peuple.
Durant toute cette période, le gouvernement des
États-Unis met en oeuvre des politiques
anti-immigrés sauvages et fait preuve d'un
comportement agressif, plein de haine, pour
alimenter la peur et la division des électeurs. Il
tente de construire le mur xénophobe à la
frontière avec le Mexique, menace ce pays et
l'Amérique centrale d'énormes taxes douanières et
de sanctions s'ils n'interceptent pas les gens qui
fuient la pauvreté et l'insécurité, et multiplie
les expulsions. Il sépare cruellement des milliers
d'enfants de leurs parents. 69 000
mineurs sont arrêtés, alors qu'il prétend expulser
les enfants des immigrants nés et élevés sur le
territoire étasunien.
Faisant preuve d'une subordination éhontée aux
États-Unis, le gouvernement d'extrême droite du
Brésil dirigé par Jair Bolsonaro a eu recours au
mensonge, au discours xénophobe, raciste, misogyne
et homophobe, associé à des envolées délirantes
sur des phénomènes sociaux et politiques comme le
changement climatique, les populations indigènes,
les incendies en Amazonie et l'émigration, qui ont
provoqué la condamnation de nombreux dirigeants et
organisations. Depuis le début de son mandat, il a
procédé au démantèlement systématique des
politiques sociales qui avaient permis au Brésil,
sous les gouvernements du Parti des travailleurs,
de réduire considérablement les niveaux de
pauvreté et d'exclusion sociale.
À partir de mai 2019, des dizaines de
milliers de manifestants sont descendus dans les
rues pour protester contre les coupes dans
l'éducation, les réformes du système de retraite,
les politiques discriminatoires et la violence de
genre.
Le gouvernement du Brésil est intervenu dans les
affaires intérieures de pays voisins tels que le
Venezuela, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay,
et a adopté des positions hostiles à l'égard de
Cuba, en violation du Droit international. Comme
l'a rapporté la presse brésilienne en
avril 2019, le ministère des Affaires
étrangères a chargé 15 de ses ambassades de
se concerter avec les ambassades des États-Unis
pour exhorter les gouvernements des pays auprès
desquels ils sont accrédités à condamner Cuba dans
les instances internationales.
Pour la première fois depuis 1992, le Brésil
a voté cette année contre, faisant cavalier seul
avec les États-Unis et Israël, la résolution de
l'Assemblée générale des Nations Unies qui appelle
à la levée du blocus économique, commercial et
financier que les États-Unis durcissent
aujourd'hui contre Cuba, et à la cessation de
l'application extraterritoriale de ses lois à
l'encontre d'États tiers.
Dans le même temps, le gouvernement colombien
s'est abstenu lors du vote de la résolution qu'il
soutenait depuis 1992 et qui exige, à un
moment où il s'intensifie, la levée du blocus
génocidaire des États-Unis contre Cuba et sa
portée extraterritoriale. Pour justifier cette
décision choquante, les autorités de ce pays se
sont livrées à la manipulation, ingrate et
politiquement motivée, sur la contribution
altruiste, engagée, discrète et incontestable de
Cuba à la paix en Colombie, une question dans
laquelle le rôle de notre pays est universellement
reconnu. Le débat large et critique que cette
attitude a généré dans ce pays est bien connu et,
néanmoins, nous continuerons de l'accompagner dans
ses efforts pour parvenir à la paix.
La calomnie des États-Unis visant à attribuer à
Cuba de soi-disant responsabilités dans
l'organisation de mobilisations populaires contre
le néolibéralisme en Amérique du Sud constitue un
incroyable prétexte pour justifier et renforcer le
blocus et la politique hostile à l'égard de notre
peuple. De même, elle constitue une tentative
inutile pour masquer l'échec du système
capitaliste, pour protéger les gouvernements
chancelants et répressifs, pour cacher les coups
d'État parlementaires, judiciaires et policiers et
agiter le spectre du socialisme pour intimider le
peuple. Ces manoeuvres visent également à
justifier la répression et la criminalisation de
la contestation sociale.
La seule responsabilité de Cuba est celle qui
émane de l'exemple donné par son peuple héroïque
dans la défense de sa souveraineté, dans la
résistance aux agressions les plus brutales et
systématiques, dans la pratique invariable de la
solidarité et de la coopération avec les pays
frères d'Amérique latine et des Caraïbes.
L'impérialisme ne supporte pas que Cuba ait
montré qu'un autre monde est possible et qu'un
modèle alternatif au néolibéralisme peut être
construit, fondé sur la solidarité, la
coopération, la dignité, la répartition équitable
des revenus, l'accès équitable à l'épanouissement
professionnel, à la sécurité et à la protection
des citoyens et à la pleine libération des êtres
humains.

Discussion sur la situation actuelle à Cuba
le 4 décembre 2019 avec Son Excellence Josefina
Vidal Fereiro, l'ambassadrice de la République de
Cuba au Canada, au cégep de l'Outaouais
La Révolution cubaine est également la preuve
qu'un peuple étroitement uni, maître de son pays
et de ses institutions, dans une démocratie
permanente et profonde, peut résister
victorieusement et faire progresser son
développement, face à la plus longue agression et
au plus long blocus de l'histoire.
Le coup d'État en Bolivie, orchestré par les
États-Unis en utilisant l'OEA et l'oligarchie
locale comme instruments, est une démonstration de
l'agressivité de l'assaut impérialiste. Cuba
réitère sa condamnation du coup d'État, de la
répression brutale déclenchée dans ce pays, et
exprime sa solidarité avec le compañero
Evo Morales Ayma et le peuple bolivien.
Alors que le gouvernement des États-Unis poursuit
sa guerre non conventionnelle pour tenter de
renverser le gouvernement légitimement constitué
du président Nicolas Maduro Moros, en invoquant le
Traité interaméricain d'assistance réciproque
(TIAR), Cuba ratifie sa volonté inébranlable de
maintenir sa coopération avec le gouvernement et
le peuple vénézuéliens
Nous réaffirmons notre solidarité au gouvernement
et au peuple sandinistes du Nicaragua, dirigés par
le président Daniel Ortega, qui sont en butte aux
tentatives de déstabilisation et aux mesures
coercitives unilatérales des États-Unis.
Le gouvernement légitime du Commonwealth de la
Dominique et son Premier ministre Roosevelt
Skerrit méritent la solidarité internationale et
celle du peuple cubain, à un moment où cette île
est victime de l'ingérence extérieure qui a déjà
provoqué des violences et vise à faire avorter le
processus électoral.
Dans ce scénario complexe, le gouvernement
d'Andrés Manuel Lopez Obrador au Mexique affronte
le néolibéralisme et défend les principes de
non-intervention et de respect de la souveraineté,
tandis que l'élection d'Alberto Fernandez et de
Cristina Fernandez à la présidence et à la
vice-présidence en Argentine exprime le rejet sans
équivoque par ce pays des formules néolibérales
qui l'ont appauvri, endetté et ont gravement
précarisé son peuple. La libération de Lula est
une victoire des peuples, et Cuba réitère son
appel à la mobilisation mondiale pour exiger sa
pleine liberté, la reconnaissance de son innocence
et la restitution de ses droits politiques.
La corruption qui caractérise le comportement de
l'actuelle administration des États-Unis est
désormais indéniable. Son impact sur les peuples
d'Amérique latine et des Caraïbes se traduit par
un coût en vies humaines, en souffrances, en
instabilité et en dommages économiques.
Dans la conjoncture dramatique que vivent la
région et le monde, Cuba réaffirme les principes
de souveraineté, de non-ingérence dans les
affaires intérieures des États et le droit de
chaque peuple de choisir et de construire
librement son système politique, dans un climat de
paix, de stabilité et de justice, sans menaces,
agressions ni mesures coercitives unilatérales, et
appelle au respect des principes de la
Proclamation de l'Amérique latine et des Caraïbes
en tant que Zone de paix.
Cuba continuera d'oeuvrer sur la voie de
l'intégration de Notre Amérique, qui passe par la
mobilisation de tous les efforts pour que la
Communauté des États d'Amérique latine et des
Caraïbes (CELAC), qui sera bientôt présidée par le
Mexique, continue de promouvoir les intérêts
communs de nos nations en renforçant leur unité
dans la diversité.
À l'assaut implacable des forces les plus
réactionnaires du continent, Cuba oppose la
résistance inflexible de son peuple et sa volonté
de défendre l'unité de la nation, ses conquêtes
sociales, sa souveraineté et son indépendance, et
le socialisme quel qu'en soit le prix. Nous le
faisons avec l'optimisme et avec la confiance
inébranlable dans la victoire que nous a léguée le
commandant en chef de la Révolution cubaine, Fidel
Castro Ruz, sous la conduite du Premier secrétaire
de notre Parti, le général d'armée Raul Castro, et
sous la direction du président Miguel Diaz-Canel.
(Minrex, La Havane, 3 décembre
2019)

- Carlos Perez Morales -

Image affichée sur le compte twitter du président
vénézuélien Maduro pour commémorer le 30e
anniversaire de l'invasion de Panama par les
États-Unis en 1989
Le souvenir de Noël 1989 est très présent au
Panama parce qu'il est associé à l'invasion
militaire brutale des États-Unis. Vingt-sept mille
soldats américains plus 12 000 autres
postés dans les 14 bases militaires
américaines de l'ancienne « zone du canal »
ont impitoyablement attaqué cette petite
république d'Amérique centrale.
Selon les États-Unis, dans les mots de son
président George Bush, l'invasion avait pour but
de protéger « des vies américaines » et de
renverser le gouvernement du dictateur Manuel
Antonio Noriega. Nous savons que pour renverser la
dictature de Noriega, une invasion militaire de
cette nature n'était pas justifiée. Seule une
petite force militaire était nécessaire pour
éliminer Noriega du gouvernement panaméen.
D'autres méthodes auraient également pu être
utilisées sans verser une seule goutte de sang.
Aujourd'hui, nous savons également que l'invasion,
qui a fait plus de 6 000 morts parmi les
Panaméens, avait vraiment d'autres objectifs.
Les États-Unis voulaient retrouver leur hégémonie
dans la région. Deuxièmement, l'invasion avait
pour objectif d'éliminer les forces de défense du
Panama, établies par le général Manuel Antonio
Noriega. Troisièmement, c'était une répétition
pour le modèle de guerre totale, sans égard à la
portée de l'expérience. Dans ce cadre, de
nouvelles armes ont été mises à l'essai telles que
les bombardiers furtifs par F-11, des bombes
de 2000 livres, des missiles Hellfire, des
hélicoptères et lanceurs de missiles Blackhawk,
Apache AH-64 et Cobra, des avions d'assaut A-37,
des canons de 30 mm à tir rapide et des
fusils M-16 avec viseurs infrarouges.
Une autre grande raison est qu'en
janvier 1990, il appartenait à Noriega de
nommer l'administrateur pour le canal de Panama,
tel qu'établi dans les traités Torrijos-Carter.
L'attaque contre le Panama a commencé depuis la
colline Ancon vers le quartier pauvre d'El
Chorrillo. Ce quartier a été incendié par l'armée
américaine et plusieurs milliers de personnes sont
mortes, dont des femmes et des enfants. À ce jour,
nous ne savons pas combien de personnes sont
mortes dans cette attaque car les soldats
américains ont traîné de nombreux corps dans
l'ancienne « zone du canal », où ils ont été
enterrés dans des fosses communes.

L'assaut impitoyable s'est poursuivi dans
d'autres quartiers de la ville où plus de 400
bombes ont été larguées. Les États-Unis ont
attaqué d'autres endroits qu'ils jugeaient de la
plus haute importance en République du Panama. «
Le pays a fait faillite et au cours des mois
suivants, il y a eu des licenciements massifs de
fonctionnaires et de travailleurs d'entreprises
privées. » (Ecured, 2009)
Le gouvernement des États-Unis a fait prêter
serment à Guillermo David Endara Galimany en tant
que président du Panama et Ricardo Arias Calderon
en tant que vice-président sur l'une de leurs
bases militaires dans l'ancienne zone du canal. Le
président Endara a été le président «
fantoche » des États-Unis au Panama. Il a
toujours été au service de la puissance impériale
américaine, en suivant ses ordres. Une conséquence
immédiate de l'invasion a été le rétablissement au
pouvoir de l'oligarchie.
En tant que Latino-Américains, nous ne pouvons
oublier cet acte d'agression contre le Panama mené
par l'empire étasunien.
Carlos Perez Morales est un historien
portoricain.

Bolivie
- Cubadebate -
Le 18 décembre, les États-Unis et le
secrétaire de l'Organisation des États américains
(OÉA) Luis Almagro ont subi une défaite
retentissante à l'OÉA lorsque la Communauté
caribéenne (CARICOM) a réussi à faire adopter une
résolution sur la Bolivie au Conseil permanent.
Avant la réunion du Conseil permanent, la
représentation de la Bolivie avait proposé des
amendements à l'ébauche de résolution de la
CARICOM. La Grenade a débuté la réunion en faisant
remarquer que les amendements proposés ne
constituaient pas un amendement à l'ébauche de la
CARICOM mais bien une nouvelle ébauche de
résolution.
Le représentant du gouvernement issu du coup en
Bolivie a répondu qu'il n'était pas d'accord et
qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau document. Il
a dit qu'il pensait que l'ébauche de résolution de
la CARICOM serait plus constructive si elle
contribuait à la paix en Bolivie « plutôt que de
soutenir l'intention de mettre le pays à feu comme
le souhaite Evo Morales ». Il a ajouté que
beaucoup de gens ne sont pas intéressés de savoir
ce qui s'est passé en Bolivie et qu'il ne
s'agissait pas d'une action ciblant les peuples
autochtones mais de gestes de groupes armés qui
ont appuyé Evo Morales et son appel à encercler
les villes.
Le Bélize a présenté une motion d'ordre proposant
que l'ébauche d'amendement de la Bolivie soit mise
au vote.
Le résultat du vote a été comme suit :
Huit en faveur : Bolivie, Brésil,
Colombie, États-Unis, Équateur, Panama, Paraguay
et Venezuela (le représentant du président
autoproclamé Guaido)
Dix-sept contre : Antigue-et-Barbuda
, Argentine, la Barbade, Bélize, Dominique,
Guyane, Grenade, Jamaïque, Mexique,
Trinidad-et-Tobago, Nicaragua, Sainte-Lucie,
Saint-Vincent-et-les Grenadines, Surinam, Uruguay,
les Bahamas, Saint-Christophe-et-Nevis
Huit abstentions : Canada, Costa
Rica, Chili, Guatemala, Salvador, République
dominicaine, Pérou et Honduras
Un absent : Haïti
Le projet bolivien a donc été rejeté.
L'ambassadeur des États-Unis a alors proposé que
le vote se tienne sur l'ébauche de résolution de
la CARICOM, qui a donné le résultat suivant :
Dix-huit en faveur :
Antigua-et-Barbuda , Argentine, les Bahamas, la
Barbade, Bélize, Dominique, Grenade, Guyane, La
Jamaïque, Mexique, Trinidad-et-Tobago, Nicaragua,
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Saint-Christophe-et-Nevis, Surinam, Uruguay et
Panama
Quatre contre : Bolivie, Colombie,
États-Unis, Venezuela (le représentant de
l'autoproclamé Guaido)
Onze abstentions : Canada, Costa
Rica, Guatemala, Salvador, République dominicaine,
Équateur, Pérou, Honduras, Brésil, Chili et
Paraguay
Un absent : Haïti
Conséquemment, la résolution « Rejet de la
violence et appel au plein respect des droits des
peuples autochtones dans l'État plurinational de
Bolivie » a été adoptée.
Dans une note en bas de page, plusieurs
délégations ont expliqué les motifs de leur vote.
La note de l'ambassadeur colombien a attiré
l'attention par son langage agressif et même
offensant envers les auteurs de la résolution et
ceux qui l'ont appuyée. Les représentants de la
Colombie et des États-Unis ont attaqué le
Venezuela tandis que le représentant de Guaido
s'en est pris au Nicaragua.
Résolution du Conseil permanent
« Rejet de la violence et appel au plein respect
des droits des peuples autochtones dans l'État
plurinational de la Bolivie » tel que proposé
par les États membres de la communauté caribéenne
(CARICOM)
Le Conseil permanent de l'Organisation des États
américains affirme,
TENANT COMPTE des objectifs et des principes de
la Charte des Nations unies et de ceux de la
Charte de l'Organisation des États américains
(OÉA) ;
GARDANT À L'ESPRIT que les conventions
internationales et hémisphériques sur les droits
de l'homme comprennent les valeurs et les
principes de la liberté, de l'égalité et de la
justice sociale qui sont intrinsèques à la
démocratie ;
RAPPELANT la Déclaration des Nations unies sur
les peuples autochtones, dont l'article 1
stipule que « les peuples autochtones ont le
droit, à titre collectif ou individuel, de jouir
pleinement de l'ensemble des droits de l'homme et
des libertés fondamentales reconnus par la Charte
des Nations unies, la Déclaration universelle des
droits de l'homme et le droit international
relatif aux droits de l'homme » ; la
Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale des
Nations unies et la Déclaration américaine sur les
droits des peuples autochtones (AG /
RES. 2888 (XLVI-O / 16), dont l'article
XII se lit : « Les peuples autochtones ont le
droit de ne pas faire l'objet de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et d'autres
formes connexes d'intolérance. Les États adoptent
les mesures préventives et correctives nécessaires
pour garantir pleinement et efficacement la
protection de ce droit. »
CONSTATANT les sérieuses préoccupations sur la
situation des droits de l'homme, y compris la
violence raciste et discriminatoire, exprimée par
la Commission interaméricaine des droits de
l'homme (CIDH) dans ses observations préliminaires
du 10 décembre 2019, à la suite de sa
visite en Bolivie ;
CONSTATANT AUSSI les conclusions de la
CIDH sur l'existence d'une vague de violence ayant
suivi le processus électoral et les graves
allégations au sujet de violations des droits de
l'homme, dont des détentions et des arrestations
arbitraires, des tueries et des meurtres, des
blessures infligées à la population civile, la
criminalisation et la persécution d'opposants
politiques et des violations de la liberté
d'expression ;
RAPPELANT la « Déclaration sur les droits des
peuples autochtones dans les Amériques » (AG
/ DEC. 79 (XLIV-O / 14) qui réaffirme
que le progrès dans la promotion et la protection
effective des droits des peuples autochtones des
Amériques est une priorité pour l'OÉA ;
RAPPELANT AUSSI l'article 9 de la Charte
démocratique interaméricaine qui déclare que «
l'élimination de toutes les formes de
discrimination, notamment la discrimination basée
sur le sexe, l'ethnie et la race, et des diverses
formes d'intolérance, ainsi que la promotion et la
protection des droits de la personne et de ceux
des peuples autochtones et des migrants, le
respect de la diversité ethnique culturelle et
religieuse dans les Amériques, contribuent au
renforcement de la démocratie et à la
participation des citoyens » ;
RECONNAISSANT QU'en dépit des améliorations qui
ont été apportées dans la dernière décennie, les
peuples autochtones de la Bolivie ont souffert des
injustices historiques causées par la colonisation
et la dépossession de leurs terres, de leurs
territoires et de leurs ressources, entre autres
dépossessions, laquelle les a empêchés d'exercer
pleinement, en particulier, leur droit au
développement conformément à leurs propres besoins
et intérêts ;
SOULIGNANT QUE les droits inhérents des peuples
autochtones de la Bolivie, qui découlent de leurs
structures politiques, économiques et sociales, de
même que de leurs cultures, de leurs traditions
spirituelles, de leurs récits et de leur
philosophie, en particulier leur droit à leurs
terres, leurs territoires et leurs ressources,
doivent être respectés et promus ;
RÉAFFIRMANT que les peuples autochtones, dans
l'exercice de leurs droits, doivent vivre libres
de toute forme de discrimination ;
CONSIDÉRANT l'importance d'éliminer toutes les
formes de discrimination ou de violence raciales
découlant de ces formes qui affectent les citoyens
des Amériques, en particulier les peuples
autochtones, tenant compte de la responsabilité
qui incombe à ces États de les combattre ;
AFFIRMANT QUE toute doctrine, politique et
pratique qui repose sur la promotion de la
supériorité de peuples ou de personnes sur la base
de différences nationales, raciales, religieuses,
ethniques ou culturelles en Bolivie, est raciste,
fausse du point de vue scientifique, invalide
juridiquement, moralement condamnable et injuste
socialement ; et
ACCUEILLANT l'accord signé entre les autorités
boliviennes et la CIDH visant à l'établissement
d'un groupe indépendant d'experts internationaux
pour faire enquête sur les actes de violence qui
se sont produits entre septembre et
décembre 2019 ;
DÉCIDE DE
1. CONDAMNER les violations des droits de l'homme
et le recours à la violence contre tout citoyen de
la Bolivie, en particulier toute forme de violence
et d'intimidation à l'égard des Boliviens
d'origine autochtone.
2. CONDAMNER également l'intolérance envers les
symboles, vestiges traditionnels et pratiques
religieuses, de même qu'envers tout aspect de la
civilisation autochtone qui puisse être sujette à
un traitement inégale ou à une mention inégale.
3. SOULIGNER la nécessité que les autorités de
l'État plurinational de Bolivie s'acquittent de
leur responsabilité inhérente, en tant que membre
de la communauté des nations, de protéger les
droits humains de tous en Bolivie.
4. APPELER les autorités de l'État plurinational
de la Bolivie à respecter, garantir et mettre en
oeuvre en pratique toutes leurs obligations en
vertu du droit international relatif aux peuples
autochtones, en particulier celui relié aux droits
de l'homme.
5. RÉITÉRER l'appel émis par le Conseil permanent
de l'OÉA le 20 novembre 2019, dans sa
résolution CP / RES. 1140 (2259/19)
rev. 1, à tous les acteurs politiques et
civiques de la Bolivie, incluant toutes les
autorités, la société civile, les forces
militaires et de sécurité et le public en général,
à mettre fin immédiatement à la violence, à
préserver la paix et à rechercher un dialogue
franc qui promeut la réconciliation démocratique
nationale.
6. APPELER les autorités boliviennes à garantir,
d'une manière entière et sans restriction, à
respecter et protéger les droits de l'homme et à
assumer sa responsabilité face à toute violation
de ses droits, conformément au droit international
en matière de droits de l'homme, tel que reflété
dans la résolution CP / RES. 1140 (2259/19)
rev. 1 du Conseil permanent de l'OÉA.

Venezuela
- Communiqué du gouvernement
bolivarien du Venezuela -
La République bolivarienne du Venezuela rejette
catégoriquement la nouvelle agression
interventionniste entreprise par l'élite dominante
des États-Unis d'Amérique, cette fois en tentant
d'adopter une loi ironiquement baptisée Loi
sur l'aide d'urgence, l'aide à la démocratie et
le développement pour le Venezuela, conçue
pour approfondir les attaques contre le peuple
vénézuélien et violer sa souveraineté et son ordre
constitutionnel interne.
Derrière cette chaîne d'euphémismes se cache un
instrument qui vise à accentuer la mise en oeuvre
de mesures coercitives unilatérales, illégales,
tout en violant la Charte des Nations unies, dans
la mesure où elles portent atteinte aux droits
humains de plus de 30 millions de
Vénézuéliennes et Vénézuéliens. De plus, dans un
délire d'arrogance impériale, le Congrès américain
entend, par cet acte législatif, s'arroger le
droit de punir les pays qui entretiennent des
relations commerciales avec le Venezuela.
En bref, cette loi ne vise que la restauration du
Venezuela néolibéral et le pillage de ses
ressources, pour lequel elle propose ouvertement
un prétendu régime de tutelle légale sur le
Venezuela, dans lequel même ses alliés politiques
locaux fantoches de l'opposition vénézuélienne
seraient liés aux opinions et «
recommandations » du gouvernement américain.
Au lieu de résoudre le problème que plus
de 50 millions d'Étatsuniens vivent dans la
pauvreté ou de faire cesser la grave violation des
droits humains de plus de 5 000 familles
de migrants qui ont été séparées cette année dans
leur pays jusqu'à présent, le Congrès américain
entend gaspiller l'argent des contribuables pour
financer la déstabilisation du Venezuela et
fournir des ressources aux gouvernements
satellites et aux complices de sa stratégie.
Face à cette nouvelle agression, le peuple et le
gouvernement de la République bolivarienne du
Venezuela restent fermement sur la voie de la
légalité, de la paix et des efforts héroïques pour
construire la justice sociale, toujours prêts à
défendre, quelles que soient les éventualités, sa
Constitution et sa démocratie participative contre
les mesures coercitives illégales et les actes de
guerre et de déstabilisation.
La dignité du peuple de Bolivar restera intacte
face à toute attaque suprémaciste, tout comme sa
volonté de rester libre et souverain et de vivre
en paix.

- Misión Verdad -
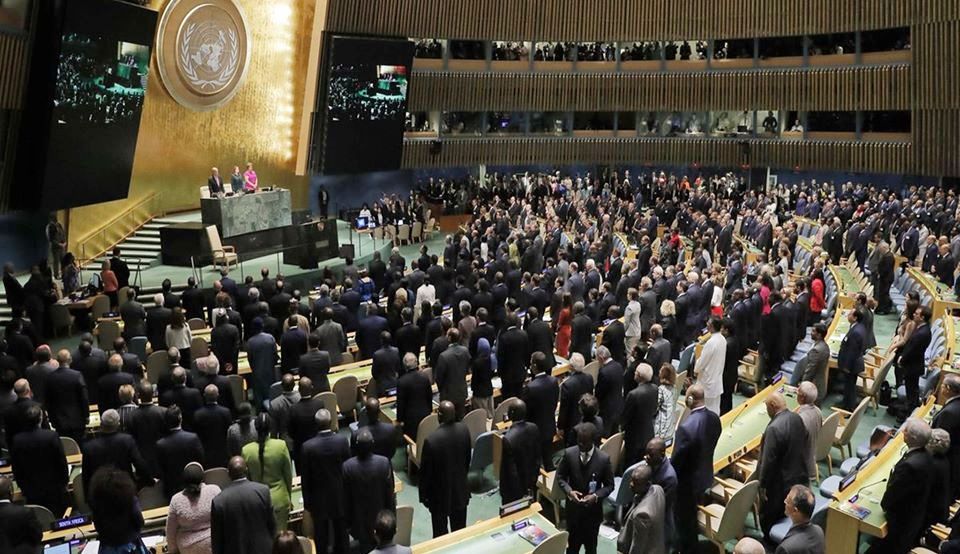
Tandis que les États-Unis multiplient les mesures
coercitives contre le Venezuela, les Nations unies
acceptent l'accréditation du président de la
République bolivarienne du Venezuela, Nicolas
Maduro, le 18 décembre 2019, le confirmant comme
unique représentant du Venezuela à l'ONU.
La Loi du secours d'urgence, de l'aide
démocratique et du développement du Venezuela,
ou Loi VERDAD selon son acronyme, a été approuvée
le 16 décembre par la Commission sénatoriale
sur les affaires étrangères et par le Sénat tout
entier le 19 décembre.
Les sénateurs américains Marco Rubio (républicain
) et BobMenendez (démocrate), les architectes
principaux du siège du Venezuela par le Congrès
des États-Unis, sont les visages publics de cette
initiative dans laquelle on trouve également des
représentants démocrates de la Floride comme Donna
Shalala, Debbie Wasserman Schultz et Debbie
Mucarsel-Powell.
La loi est une initiative partisane et bicamérale
qui représente une manoeuvre de l'État profond des
États-Unis pour protéger juridiquement et
perpétuer le siège et la stratégie d'asphyxie de
la République bolivarienne du Venezuela.
La loi VERDAD (vérité en français – Note de
LML) vise à escalader et à renforcer les
mesures coercitives unilatérales contre le pays.
Bien que l'étendue de son application semble se
limiter au niveau dirigeant du gouvernement
bolivarien, il vise plutôt à renforcer les mesures
d'asphyxie économique et le blocus total de
l'économie vénézuélienne.
Elle prévoit aussi l'expansion des ressources
allouées à la tristement célèbre « restauration de
la démocratie vénézuélienne » tant vantée.
Autrement dit, c'est un effort pour renforcer
l'allocation des ressources pour la
déstabilisation du pays par le Congrès.
Argent et arrière-plan
En juin 2018, le Sénat a approuvé 20
millions de dollars et la Chambre des
représentants un montant additionnel de 15
millions pour réaliser ces objectifs.
À ces ressources s'ajoutent maintenant
les 400 millions de dollars qui seront
destinés, en vertu de la Loi VERDAD, aux
dirigeants du coup au Venezuela dirigés par
Voluntad Popular, sous la couverture
traditionnelle de la fourniture d'une « aide
humanitaire » qui est la catégorie dans
laquelle cette aide va se retrouver dans le budget
de l'année fiscale 2020.
Et il se trouve encore des journalistes, des
analystes et des personnalités des médias sociaux
qui se demandent où Juan Guaido et compagnie
prennent toutes les ressources pour leurs voyages
à l'étranger et les produits de luxe auxquels ils
sont habitués, sans parler de leurs magouilles qui
font les manchettes.
À cause de ces similitudes, étant une initiative
bipartisane, appuyée dans les deux chambres,
allouant des ressources pour la déstabilisation,
créant un faux cadre juridique pour mettre en
oeuvre un blocus économique, la Loi VERDAD est
semblable à la Loi Helms-Burton appliquée
contre Cuba depuis 1995.
La Loi VERDAD présente aussi des
similitudes avec la loi qui a été approuvée en
2015 par le Congrès des États-Unis autorisant la
guerre contre l'État islamique en Syrie. Dans
cette loi, ce sont les violations alléguées contre
les droits humains par le gouvernement de Bachar
el-Assad qui ont été utilisées pour mener
une guerre sur deux fronts et allouer des
ressources pour la « restauration de la
démocratie » dans le pays arabe.
La similitude entre les deux décrets consiste
aussi dans l'allocation de ressources à une
opposition qui est déjà prête à prendre le chemin
de la voie armée et à recourir à l'insurrection
comme méthode de lutte politique.
À l'égard du Venezuela, cette nouvelle loi oblige
le département d'État à travailler en coordination
avec les organisations non gouvernementales (ONG),
les médias « indépendants » et l'Assemblée
nationale (en majorité anti-chaviste), avec comme
objectif de saper le chavisme et le gouvernement
bolivarien.
Ces ressources seront allouées aux bras et aux
instruments « civils » de l'interventionnisme
des États-Unis afin de renforcer l'affirmation
selon laquelle le gouvernement de Nicolas Maduro
est un gouvernement qui commet des « violations
des droits de l'homme » et des « crimes
contre l'humanité ».
La stratégie des États-Unis consiste à financer
la construction d'un discours tout préparé
d'avance visant à diaboliser la direction chaviste
afin de la poursuivre à moyen terme devant les
instances internationales, telle la Cour pénale
internationale de La Haye (dans les Pays-Bas).
Limitation institutionnelle des dommages
La Loi VERDAD sera la première loi du
Congrès américain à émettre des sanctions contre
une cryptomonnaie, le Petro dans ce cas-ci, lancée
par l'État vénézuélien en 2018 pour soutenir la
reprise économique du pays face à son étranglement
par les sanctions financières de Washington.
Il s'agit d'une « nouveauté » en termes
juridiques et politiques dans la politique
étrangère des États-Unis, du fait qu'elle
transforme le Petro vénézuélien en moyen d'imposer
des restrictions à un nouvel ordre financier
international en plein développement, reposant sur
les cryptomonnaies et le défi au contrôle punitif
du service bancaire américain aux grandes
entreprises.
La loi autorise aussi des investigations
financières spéciales dont l'objectif est de
restreindre, contrôler et accaparer les « avoirs
vénézuéliens » qui ont été prétendument
cooptés par la « corruption du régime
Maduro ». De cette façon, le pillage des
avoirs nationaux vénézuéliens est protégé
juridiquement, ce qui offre un incitatif à la
fracture des institutions vénézuéliennes.
La Loi VERDAD oblige aussi le
département d'État à travailler étroitement avec
les gouvernements alliés des États-Unis (Union
européenne et pays latino-américains rassemblés
dans le fantasmagorique Groupe de Lima) pour
étendre les sanctions contre le Venezuela.
Dans la même veine, on peut aussi la considérer
comme un moyen de faire pression sur la Chine et
la Russie pour les amener à retirer à moyen terme
leur appui au gouvernement Maduro.
Avec la Loi VERDAD, l'appétit pour une
intervention militaire conventionnelle au
Venezuela à court et moyen terme se trouve réduit,
car elle remplace le pouvoir dur par le pouvoir
souple, utilisant les ONG, les sanctions, les
médias et l'Assemblée nationale comme des moyens
politiques, économiques et institutionnels de
combat politique adaptés à une guerre non
conventionnelle.
Tout ceci confirme que les faucons de la
Maison-Blanche et l'establishment de sécurité de
nationale de Washington n'ont pas pu mener à bien
leur plan contre le Venezuela.
Vue de cette façon, la Loi VERDAD apparaît
comme une opération de limitation des dommages que
le Parti de guerre (la somme des fauteurs de
guerre parmi les démocrates et les républicains)
essaie de faire dans la sphère institutionnelle
afin de sauver la crédibilité de l'empire
américain face à la résistance vénézuélienne.
Le Venezuela à la croisée des chemins avec les
États-Unis
La chute du chavisme a été offerte par ces
acteurs (Rubio, Menendez) comme un « trophée de
guerre » qui va assurer la réélection de
Donald Trump dans l'État stratégique de la
Floride, où réside la diaspora
cubaine-vénézuélienne qui demande une guerre
fratricide avec le Venezuela.
Profitant de la situation où l'attention de Trump
est accaparée par le processus de destitution, le
Parti démocrate cherche à prendre le contrôle de
la politique étrangère envers le Venezuela au
Congrès en utilisant les sanctions et la pression
économique comme des mécanismes de pouvoir souple
permettant de réaliser le coup d'État avec un
discours de « négociation pacifique et
diplomatique ».
En ce qui a trait à la politique intérieure, les
démocrates de la Floride cherchent à miner le
monopole que les républicains ont exercé sur la
politique étrangère envers le Venezuela depuis la
montée de Trump, offrant avec la VERDAD une
voie « plus effective » que celle du
président républicain, afin de traduire cette
manoeuvre en votes assurés contre le chef actuel
de la Maison-Blanche à l'approche de l'élection
de 2020.
Conséquemment, le Venezuela pourrait bien
reconfirmer son rôle de centre politique de la
diatribe continentale par une escalade et des
pressions qui seront façonnées par la lutte pour
la présidence des États-Unis.
Cela veut dire que l'année 2020 en sera une
de pression accrue, pendant laquelle le Congrès et
la guerre institutionnelle du Parti démocrate
contre Trump seront des traits déterminants.
Pour des fins de politique intérieure
vénézuélienne, le Congrès américain essaie de
recalibrer l'échec de l'opposition vénézuélienne.
Alors que cette opposition est divisée, engagée
dans d'innombrables affaires de corruption, privée
de légitimité et incapable de réaliser le coup
d'État, le Congrès des États-Unis tente maintenant
de « venir à sa rescousse » en mettant de
l'avant ces mécanismes pour redonner vie aux
pressions et accroître les ressources pour la
déstabilisation, appuyant le personnage de Juan
Guaido.
Bien que la Loi VERDAD se donne les
traits du triomphe d'une approche bipartisane et
de ceux qui sont engagés dans la manigance d'un
coup contre le Venezuela, les problèmes internes
qui existent entre les factions aux États-Unis
suggèrent autre chose.
Pendant cette même année, l'ébauche de la Loi
du statut de protection temporaire ( HR 549),
la Loi de restriction des armes pour le
Venezuela (HR 920), la Loi sur
l'aide humanitaire au peuple du Venezuela (HR 854)
et la Loi sur la mitigation de la menace
russo-vénézuélienne (HR1477) n'ont pas
avancé à cause du contrôle que les républicains
exercent au Sénat.
La Loi VERDAD est le dernier projet qui
peut être réalisé dans le contexte où les quatre
autres ont échoué.
Le problème à long terme de la soi-disant Loi
VERDAD sera qu'elle rend impossibles des
accords politiques ou des actions discrétionnaires
de l'exécutif américain, que ce soit de la part de
l'administration Trump ou d'une autre, qui
auraient pu décroître ou abroger le blocus contre
le Venezuela.
Les inconvénients auxquels a dû faire face
l'administration de Barack Obama dans sa gestion
de la détente avec Cuba face à la Loi
Helms-Burton en sont le plus bel exemple
Cela illustre comment le Congrès américain
utilise son pouvoir pour réglementer, bloquer et
réorienter les actions de la présidence Trump et
des autres à venir, donnant un air de légalité à
la croisade anti-chaviste.
Il s'agit d'un gros problème politique pour le
Venezuela, compte tenu de la prolongation et de la
pérennité des facteurs de l'État profond aux
États-Unis en tant qu'éléments essentiels qui
contrôlent les leviers et le discours de
l'establishment américain et protègent les plans
de guerre géopolitiques contre tout changement de
direction à la Maison-Blanche.


L'Assemblée nationale accusée d'outrage a amendé
des règlements pour permettre à des législateurs
fugitifs vivant à l'étranger de voter dans des
sessions parlementaires via l'Internet.
Le juge de la Cour suprême de justice du
Venezuela (CSJ), Juan Jose Mendoza, qui est aussi
président de la Chambre constitutionnelle, a
annoncé le 19 décembre que les législateurs de
l'Assemblée nationale accusés d'outrage ne peuvent
voter lors des débats parlementaires s'ils ne sont
pas physiquement au pays.
« Nous déclarons nulle toute modification
apportée par l'Assemblée nationale accusée
d'outrage aux normes régissant les débats
parlementaires », a dit le juge Mendoza.
Le 18 décembre, les législateurs
bolivariens, membres du « Bloc de la Patrie »
ayant réintégré l'Assemblée nationale en
septembre, ont demandé à la CSJ d'abroger une
modification à la loi sur les débats qui
permettait aux législateurs exilés ou fugitifs
vivant à l'étranger de voter comme s'ils étaient
physiquement présents au Venezuela.
Dans sa réponse à cette demande, la Cour suprême
a dit que non seulement une telle modification
est-elle anticonstitutionnelle, elle était une
absurdité sans précédent dans le domaine du droit
comparé.
« Il n'existe aucun parlement virtuel nulle part
dans le monde. Ils ont tous un quartier général
physique. »
Le Bloc de la Patrie a aussi prévenu que cette
modification faisait partie d'une stratégie des
politiciens de l'opposition qui cherchent à
boycotter les élections parlementaires
de 2020 afin de rester au pouvoir.
Actuellement, en vertu des normes juridiques du
pays, lorsqu'il y a absence d'un législateur, son
substitut doit siéger afin de participer aux
travaux législatifs.
Dans ce contexte, la proposition du « vote à
distance » appuyée par l'opposition est une
tentative flagrante de faire en sorte que les
législateurs ne seront pas tenus d'être remplacés
par des substituts.
« Les politiciens de droite tentent de renverser
un gouvernement légitime et constitutionnel, a dit
le législateur Julio Chavez. Nous rejetons les
tentatives de violer la Constitution approuvée par
le peuple vénézuélien. »
L'amendement aux règlements internes de
l'Assemblée nationale accusée d'outrage a été
approuvé par le législateur Juan Guaido appuyé par
les États-Unis.

Colombie
Les crimes commis par l'armée colombienne pendant
plus d'un demi-siècle de conflit armé ont été
révélés par les charniers découverts dans
lesquelles des corps non identifiés ont été jetés.
Les plus récents se sont produits le 14
décembre dans la municipalité de Dabeiba, dans le
cimetière catholique de Las Mercedes de Dabeiba,
dans le département d'Antioquia. Le journal El
Pais écrit : « Là, la Juridiction spéciale
pour la paix (JEP), le tribunal né des accords
entre l'État et les FARC pour enquêter sur
les crimes les plus graves de la guerre, recherche
les corps d'au moins 50 personnes victimes
d'exécutions extrajudiciaires perpétrées par
l'armée entre 2005 et 2007. L'Institut de
médecine légale a reçu des informations
sur 17 cas. Mais la dimension du drame des
disparitions va plus loin. Le pays fait face,
selon les calculs de cet organisme public, à
l'exhumation d'environ 200 000 corps non
identifiés. »
Ce sont les
données impressionnantes mises en évidence mardi
par Claudia García, directrice de l'institut
médico-légal. « Ces dernières années, nous avons
fait une enquête dans tous les cimetières
légaux, disons-le en quelque sorte, et sur les
enterrements qui ne sont pas légaux dans ces
tombes clandestines
où nous devons rechercher les disparus du
pays, et nous pensons que le défi auquel nous
sommes confrontés est plus ou moins de 200 000
corps », a-t-elle déclaré à Caracol
Radio. « Le défi est très grand et nous aurons
du travail pendant de nombreuses années du point
de vue scientifique », a poursuivi García, qui a
souligné l'importance de l'implication du
gouvernement dans l'accomplissement de cette
tâche.
À l'heure actuelle, l'institut médico-légal se
concentre sur la fosse trouvée à Dabeiba. D'abord
avec les autopsies des corps exhumés. Et puis la
vérification croisée des données commencera par
l'information des proches des personnes disparues
pour comparer les profils génétiques. « Nous
allons travailler sans interruption et nous aurons
les premières avancées, sans terminer le travail
car c'est complexe, vers la troisième semaine de
janvier », a dit García.
« Les disparitions systématiques incarnent
toujours le souvenir le plus vif du conflit et
touchent des milliers de familles. C'est pourquoi
le travail d'institutions telles que la
juridiction de paix ou l'Unité de recherche est
essentiel pour tenter de refermer les plaies. Les
exécutions extrajudiciaires, qualifiées à tort de
fausse piste, ne représentent qu'un pourcentage de
ces cas. Comme l'a souligné la chef de la médecine
légale, ce seront les enquêtes du système
judiciaire qui établiront si des civils ont été
tués par des soldats, puis présentés comme des
guérilleros tués au combat en échange de
récompenses et d'indemnisations. Au milieu d'une
fusion d'estimations sur les milliers de victimes
de cette procédure, les données officielles
fournies par le parquet indiquent
qu'entre 1998 et 2014 il y a eu plus
de 2 200 exécutions de ce type. La
grande majorité durant les deux mandats de
l'ancien président Alvaro Uribe. »
Plus loin dans le même article, il est écrit:
« Le fantôme des crimes commis par le passé par
les forces armées est revenu cette année pour
scandaliser la Colombie et a ressurgi, pour la
première fois depuis la signature de la paix et le
début de la démobilisation des FARC, un axe
central du débat politique. La succession de
plaintes -- d'une directive, déjà retirée, qui a
ouvert la porte à un système d'incitations pour
améliorer les statistiques au sein de l'armée, les
accusations contre le commandant des forces
terrestres jusqu'à la dissimulation de la mort de
mineurs dans un bombardement contre des dissidents
de l'ancienne guérilla -- a coûté son poste au
ministre de la Défense Guillermo Botero il y a un
mois et demi. Son successeur, l'ancien ministre
des Affaires étrangères Carlos Holmes Trujillo, a
demandé de garantir la protection des anciens
officiers militaires qui ont collaboré avec la JEP
et dont le témoignage a été décisif pour localiser
ce charnier. »
Le journal cite la JEP qui a déclaré que « des
indications préliminaires indiqueraient qu'il
s'agit d'hommes de 15 à 56 ans résidant
à Medellin et parmi lesquels se trouveraient des
personnes handicapées. » Il conclut en disant
« Depuis le début des procédures en juin dernier,
le juge a entendu 160 versions d'hommes en
uniforme qui sont venus volontairement pour aider
à clarifier ce qui s'est passé. Grâce à leurs
histoires, près de 400 victimes d'exécutions
extrajudiciaires ont été identifiées. »

(Pour voir les articles
individuellement, cliquer sur le titre de
l'article.)
PDF
Lisez Le
Marxiste-Léniniste
Site web: www.pccml.ca Courriel:
redaction@cpcml.ca
|



 Avec la
militarisation de l'appareil de maintien de
l'ordre depuis l'adoption des lois de sécurité
intérieure et à cause d'autres facteurs, les
forces policières sont devenues d'importantes
consommatrices de matériel de guerre. Un aspect
important de l'économie de guerre est la
propagande générée dans la culture générale pour
faire la promotion de l'armée impérialiste et sa
contribution à la vie et faire la promotion de la
violence organisée par l'État pour défendre les
biens et les intérêts des oligarques financiers et
leur lutte pour l'hégémonie mondiale aux dépens
des peuples du monde.
Avec la
militarisation de l'appareil de maintien de
l'ordre depuis l'adoption des lois de sécurité
intérieure et à cause d'autres facteurs, les
forces policières sont devenues d'importantes
consommatrices de matériel de guerre. Un aspect
important de l'économie de guerre est la
propagande générée dans la culture générale pour
faire la promotion de l'armée impérialiste et sa
contribution à la vie et faire la promotion de la
violence organisée par l'État pour défendre les
biens et les intérêts des oligarques financiers et
leur lutte pour l'hégémonie mondiale aux dépens
des peuples du monde.
 Bon nombre des plus
grandes entreprises impliquées dans l'économie de
guerre utilisent les contrats militaires garantis
par l'État comme base pour accroître leurs ventes
de biens et services non militaires. Boeing, le
deuxième plus grand producteur d'armes au monde,
en est un exemple. Il a enregistré 29,2
milliards de dollars de ventes d'armes au pays et
à l'étranger en 2018, ce qui a servi de point
d'ancrage ou de plateforme au point de
représenter 29 % du revenu brut total
réalisé de 101,1 milliards de dollars de
ventes.
Bon nombre des plus
grandes entreprises impliquées dans l'économie de
guerre utilisent les contrats militaires garantis
par l'État comme base pour accroître leurs ventes
de biens et services non militaires. Boeing, le
deuxième plus grand producteur d'armes au monde,
en est un exemple. Il a enregistré 29,2
milliards de dollars de ventes d'armes au pays et
à l'étranger en 2018, ce qui a servi de point
d'ancrage ou de plateforme au point de
représenter 29 % du revenu brut total
réalisé de 101,1 milliards de dollars de
ventes. Toutefois, après
avoir voté la mise en accusation du président, les
démocrates à la Chambre ont pris la décision de
retarder la transmission des chefs d'accusation au
Sénat. La présidente de la Chambre des
représentants, Nancy Pelosi, a parlé de la crainte
que les républicains qui dominent le Sénat ne
tiennent pas un « procès équitable ». En
clair, les démocrates ne sont ni d'accord avec les
règles que les républicains cherchent à établir
pour le procès au Sénat, ni avec les témoins
proposés, s'il y en a. C'est la première fois
qu'une procédure de destitution d'un président est
entamée alors que les deux chambres du Congrès ne
sont pas dominées par le même parti. Il n'est pas
clair si les tractations qui ont lieu donneront
satisfaction à l'un ou l'autre des partis dans
cette affaire. Étant donné la façon dont les
factions rivales parmi les dirigeants et leurs
représentants s'alignent actuellement, peu de gens
pensent que la destitution du président réussira.
Entre temps les deux chambres devraient prendre un
congé de deux semaines pour la période des fêtes.
Toutefois, après
avoir voté la mise en accusation du président, les
démocrates à la Chambre ont pris la décision de
retarder la transmission des chefs d'accusation au
Sénat. La présidente de la Chambre des
représentants, Nancy Pelosi, a parlé de la crainte
que les républicains qui dominent le Sénat ne
tiennent pas un « procès équitable ». En
clair, les démocrates ne sont ni d'accord avec les
règles que les républicains cherchent à établir
pour le procès au Sénat, ni avec les témoins
proposés, s'il y en a. C'est la première fois
qu'une procédure de destitution d'un président est
entamée alors que les deux chambres du Congrès ne
sont pas dominées par le même parti. Il n'est pas
clair si les tractations qui ont lieu donneront
satisfaction à l'un ou l'autre des partis dans
cette affaire. Étant donné la façon dont les
factions rivales parmi les dirigeants et leurs
représentants s'alignent actuellement, peu de gens
pensent que la destitution du président réussira.
Entre temps les deux chambres devraient prendre un
congé de deux semaines pour la période des fêtes. « Ces batailles
pour la démocratie contribuent aux efforts
déployés partout au pays pour faire entendre la
voix des revendications du peuple et pour
l'affirmation de ses droits. Elles mettent en
évidence également la question centrale de la
bataille de la démocratie d'aujourd'hui, de qui
décide, la minorité ou la majorité ? La
bataille de la démocratie est la bataille pour
faire avancer le contenu et la forme de la
démocratie et mettre en place les institutions qui
la servent pour qu'elle corresponde à l'époque
moderne. Il faut donner au peuple, à la majorité,
le pouvoir de gouverner et de décider. C'est cette
démocratie qui mettrait en place les moyens pour
que soit respectée la volonté antiguerre et
prosociale du peuple qu'expriment les nombreuses
actions, réunions, pétitions, grèves. C'est
précisément ce que les dirigeants s'efforcent
d'empêcher. La procédure de destitution fait
partie de cet effort visant à entraîner tout le
monde à prendre parti pour et contre pour un camp
ou l'autre, tout en tentant de détourner la lutte
du peuple pour devenir lui-même le décideur.
« Ces batailles
pour la démocratie contribuent aux efforts
déployés partout au pays pour faire entendre la
voix des revendications du peuple et pour
l'affirmation de ses droits. Elles mettent en
évidence également la question centrale de la
bataille de la démocratie d'aujourd'hui, de qui
décide, la minorité ou la majorité ? La
bataille de la démocratie est la bataille pour
faire avancer le contenu et la forme de la
démocratie et mettre en place les institutions qui
la servent pour qu'elle corresponde à l'époque
moderne. Il faut donner au peuple, à la majorité,
le pouvoir de gouverner et de décider. C'est cette
démocratie qui mettrait en place les moyens pour
que soit respectée la volonté antiguerre et
prosociale du peuple qu'expriment les nombreuses
actions, réunions, pétitions, grèves. C'est
précisément ce que les dirigeants s'efforcent
d'empêcher. La procédure de destitution fait
partie de cet effort visant à entraîner tout le
monde à prendre parti pour et contre pour un camp
ou l'autre, tout en tentant de détourner la lutte
du peuple pour devenir lui-même le décideur.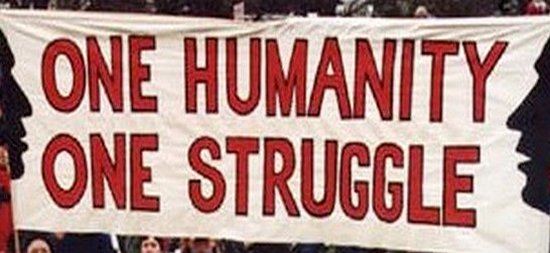 Par une variété de
moyens, des organisations de défense des droits de
l'immigration se font entendre et dénoncent les
détentions, les expulsions et la militarisation de
la frontière dans laquelle sont encore mobilisés
des milliers de soldats. Elles tiennent des
manifestations, font des propositions pour «
repenser » l'approche à l'immigration et
adopter des lois qui reconnaissent les droits,
fournissent de l'aide juridique et humanitaire sur
le terrain, de l'eau et de la nourriture par
exemple à ceux qui doivent traverser le désert,
font des poursuites judiciaires, etc.
Par une variété de
moyens, des organisations de défense des droits de
l'immigration se font entendre et dénoncent les
détentions, les expulsions et la militarisation de
la frontière dans laquelle sont encore mobilisés
des milliers de soldats. Elles tiennent des
manifestations, font des propositions pour «
repenser » l'approche à l'immigration et
adopter des lois qui reconnaissent les droits,
fournissent de l'aide juridique et humanitaire sur
le terrain, de l'eau et de la nourriture par
exemple à ceux qui doivent traverser le désert,
font des poursuites judiciaires, etc.
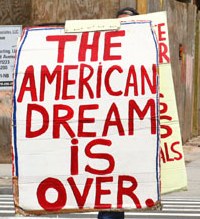 D'autres articles
réfutent cette approche et affirment que le « rêve
américain » de devenir riche et de faire «
chacun pour soi » a permis à la nation de
dominer les affaires mondiales et que la
répartition de la richesse est contraire au « mode
de vie américain ». Le conflit est souvent
présenté comme une différence dans les visions du
monde et les énoncés de politique des deux partis
cartellisés établis et au sein du Parti démocrate.
D'autres articles
réfutent cette approche et affirment que le « rêve
américain » de devenir riche et de faire «
chacun pour soi » a permis à la nation de
dominer les affaires mondiales et que la
répartition de la richesse est contraire au « mode
de vie américain ». Le conflit est souvent
présenté comme une différence dans les visions du
monde et les énoncés de politique des deux partis
cartellisés établis et au sein du Parti démocrate. Saez et Zucman
invoquent une période de l'histoire des
États-Unis, du début de la Deuxième Guerre
mondiale aux années 1970, où les riches
payaient beaucoup plus d'impôts et où leur part de
la richesse était le tiers de celle qu'ils
contrôlent aujourd'hui. Or, cela n'a pas mené à la
réalisation du droit de tous à la santé, à
l'éducation, au logement, à des installations
sanitaires et à la sécurité durant la retraite et
lorsqu'ils sont blessés, malades ou handicapés.
L'augmentation des fonds entre les mains du
gouvernement par rapport à la richesse sociale
totale pendant et après la Deuxième Guerre
mondiale a mené à la militarisation de l'économie
américaine. L'élite dirigeante des États-Unis n'a
pas utilisé l'augmentation des fonds pour garantir
les droits des Américains avec des programmes
sociaux étendus et des services publics gratuits,
mais pour établir des milliers de bases militaires
aux États-Unis et dans le monde entier, mener des
guerres incessantes sous le drapeau impérialiste
de « l'endiguement du communisme » et
construire son arsenal d'armes modernes, notamment
des flottes militaires, des avions de guerre, des
chars, de l'artillerie, des fusils d'assaut et un
grand nombre de bombes et de missiles nucléaires.
Saez et Zucman
invoquent une période de l'histoire des
États-Unis, du début de la Deuxième Guerre
mondiale aux années 1970, où les riches
payaient beaucoup plus d'impôts et où leur part de
la richesse était le tiers de celle qu'ils
contrôlent aujourd'hui. Or, cela n'a pas mené à la
réalisation du droit de tous à la santé, à
l'éducation, au logement, à des installations
sanitaires et à la sécurité durant la retraite et
lorsqu'ils sont blessés, malades ou handicapés.
L'augmentation des fonds entre les mains du
gouvernement par rapport à la richesse sociale
totale pendant et après la Deuxième Guerre
mondiale a mené à la militarisation de l'économie
américaine. L'élite dirigeante des États-Unis n'a
pas utilisé l'augmentation des fonds pour garantir
les droits des Américains avec des programmes
sociaux étendus et des services publics gratuits,
mais pour établir des milliers de bases militaires
aux États-Unis et dans le monde entier, mener des
guerres incessantes sous le drapeau impérialiste
de « l'endiguement du communisme » et
construire son arsenal d'armes modernes, notamment
des flottes militaires, des avions de guerre, des
chars, de l'artillerie, des fusils d'assaut et un
grand nombre de bombes et de missiles nucléaires.
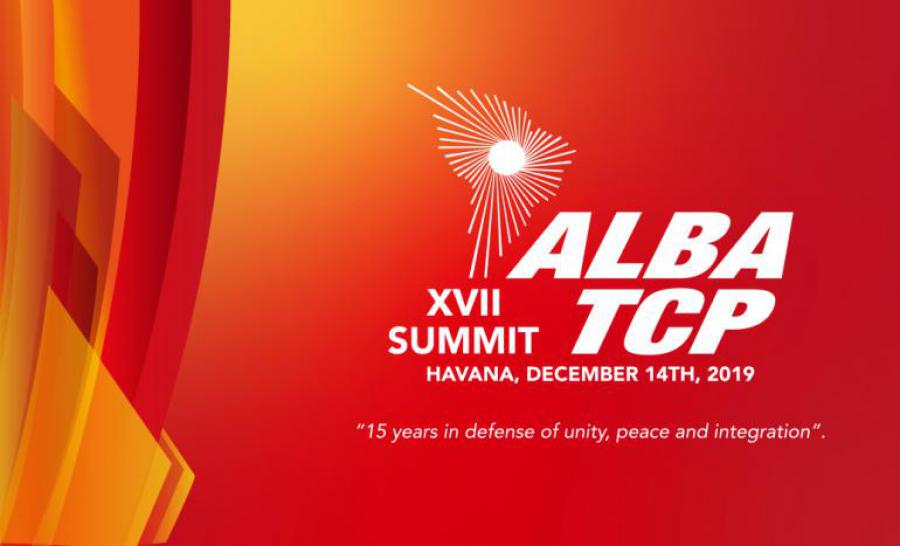 2. Nous
revendiquons les idées de Bolivar, Marti, San
Martin, Sucre, O'Higgins, Petion, Morazan,
Sandino, Maurice Bishop, Garvey, Tupac Katari,
Bartolina Sisa, Chatoyer et d'autres héros de
l'indépendance.
2. Nous
revendiquons les idées de Bolivar, Marti, San
Martin, Sucre, O'Higgins, Petion, Morazan,
Sandino, Maurice Bishop, Garvey, Tupac Katari,
Bartolina Sisa, Chatoyer et d'autres héros de
l'indépendance.