|
Numéro 35 - 14 décembre 2019
L'Accord
Canada-États-Unis-Mexique
L'oligarchie
financière resserre son
emprise sur l'Amérique du Nord
• Les
principales caractéristiques et la discussion de l'accord proposé
entre le Canada, les États-Unis et le Mexique
Contestation de l'ordre du jour antisocial du
gouvernement de l'Ontario
• La cour
juge que le gouvernement a enfreint l'autonomie
des institutions postsecondaires
- Mira Katz -
• Rejetons
les attaques organisées par l'État contre le droit de
conscience, la liberté de parole et la liberté d'association!
- Enver Villamizar -
L'affaire de la diffamation de Dougal MacDonald, chargé
de cours à l'Université de l'Alberta
• Menace à la
liberté académique
• Déclarations de soutien de collègues
universitaires et canadiens
Journée nationale de commémoration et d'action
contre la violence faite aux femmes
• Le 30e
anniversaire de la tuerie de Polytechnique
- Christine Dandenault -
• L'origine
de la campagne internationale pour mettre fin
aux violences contre les femmes et les filles
La Dominique
• Le peuple
fait échec à l'ingérence flagrante des États-Unis
dans les élections générales par le biais de
l'Organisation des États américains
L'Accord Canada-États-Unis-Mexique
Le 10 décembre, à Mexico, des représentants des
gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique ont signé le
nouvel Accord de libre-échange nord-américain maintenant appelé Accord
Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Une faction de l'oligarchie
financière, représentée politiquement par le Parti démocrate aux
États-Unis, avait refusé de ratifier le premier ACEUM signé en
novembre 2018 parce que le président Trump l'avait fait paraître
comme une sorte de victoire personnelle. L'actuel ACEUM comprend des
modifications mineures par rapport à la première version, alors au
Congrès le 10 décembre les démocrates ont annoncé haut et fort
leur soutien à l'accord comme une victoire sur Trump, par coïncidence
le même jour qu'ils ont présenté à la Chambre des représentants des
articles de mise en accusation du président pour « crimes et délits
majeurs ».

|
L'utilisation de l'ACEUM comme arme dans la guerre
civile qui fait rage entre les différentes factions de l'oligarchie
financière montre à quel point le Canada et le Mexique sont entraînés
dans les luttes politiques internes des États-Unis en raison de leur
intégration à la Forteresse Amérique du Nord. L'ancien président Obama
l'a clairement montré lui aussi lorsqu'il est intervenu directement
dans l'élection fédérale au Canada en faveur de Trudeau. Le président
Trump a réagi avec un mépris évident en reprochant au Canada d'être «
légèrement délinquant » sur les dépenses militaires et en traitant
Trudeau d'hypocrite.
L'ACEUM confirme politiquement la domination économique
d'une oligarchie financière et de ses entreprises privées sur
l'économie des trois pays d'Amérique du Nord et la négation de la
souveraineté nationale. Il officialise le contrôle de l'oligarchie
financière sur la Forteresse Amérique du Nord comme base pour la
conquête de l'hégémonie mondiale.
Les Canadiens doivent se demander quels problèmes sont
résolus par l'ACEUM. L'accord les empêche de prendre des mesures pour
résoudre les problèmes tels qu'ils se posent dans tous les secteurs,
toutes les régions et tous les pays souverains. En fait, l'ACEUM leur
interdit de soulever tout problème économique, social ou politique si
cela porte atteinte au droit de l'oligarchie financière de poursuivre
la recherche du profit privé maximum.
Le président américain utilise la « sécurité
nationale » pour imposer des tarifs au Canada et au Mexique
contrairement aux accords existants, lorsque cela convient à
l'oligarchie financière. Les États-Unis croient que leur droit de
s'attaquer au bois d'oeuvre, à l'acier et à l'aluminium du Canada va de
soi. Le droit de l'oligarchie financière de fermer des usines telles
que GM à Oshawa et des magasins tels que RONA et Sears et de détruire
des secteurs entiers est sacro-saint parce que les droits de propriété
privée des riches oligarques sont sacrés, enchâssés dans l'ancien et le
nouvel ALÉNA et affirmés en pratique. Cette réalité et la conclusion de
l'ACEUM révèlent l'existence d'une situation où dominent l'anarchie, la
violence et la « raison du plus fort », où ceux qui possèdent le
plus de richesse sociale contrôlent tous les aspects de la vie et le
peuple doit leur obéir.
L'ACEUM marque une autre étape dans l'intégration du
Canada et du Mexique à la Forteresse Amérique du Nord sous la
domination de l'oligarchie financière et de l'immense appareil
militaire, de renseignement et de sécurité intérieure des États-Unis.
 Le battage des médias de masse en faveur
de l'ACEUM et la promotion de certaines personnalités politiques qui
lui sont associées montrent que l'ordre du jour, les préoccupations et
le pouvoir de l'oligarchie financière sont contraires à l'ordre du
jour, aux préoccupations et au pouvoir des peuples d'Amérique du Nord
et à leur désir de renouveler la démocratie et de s'investir de
pouvoir. Le pouvoir, la conception du monde et le but de l'oligarchie
financière sont imposés à force de répétition et d'exclusion de toute
alternative. Face au battage médiatique en faveur de l'ordre du jour
antisocial étouffant de l'oligarchie financière et de ses représentants
politiques dans les partis cartels, le peuple doit renforcer sa
politique indépendante, ses organisations, sa pensée, son ordre du jour
et ses médias. Le battage des médias de masse en faveur
de l'ACEUM et la promotion de certaines personnalités politiques qui
lui sont associées montrent que l'ordre du jour, les préoccupations et
le pouvoir de l'oligarchie financière sont contraires à l'ordre du
jour, aux préoccupations et au pouvoir des peuples d'Amérique du Nord
et à leur désir de renouveler la démocratie et de s'investir de
pouvoir. Le pouvoir, la conception du monde et le but de l'oligarchie
financière sont imposés à force de répétition et d'exclusion de toute
alternative. Face au battage médiatique en faveur de l'ordre du jour
antisocial étouffant de l'oligarchie financière et de ses représentants
politiques dans les partis cartels, le peuple doit renforcer sa
politique indépendante, ses organisations, sa pensée, son ordre du jour
et ses médias.
Les peuples n'ont pas décidé de créer l'ACEUM et la
Forteresse Amérique du Nord et c'est là tout le problème. L'oligarchie
financière prive le peuple de son droit de décider et de contrôler les
affaires qui le concernent. Sans contrôle, le peuple est privé du droit
de décider et d'agir pour résoudre les problèmes tels qu'ils se posent.
Sans contrôle, les nations sont privées de leur souveraineté et sont
entraînées dans des luttes intestines de l'oligarchie financière et
dans sa quête de domination mondiale.
L'ACEUM représente la négation du droit du peuple de
décider et doit être fermement dénoncé et combattu.
Organisons-nous pour renouveler
la démocratie et investir le peuple
du pouvoir d'affirmer son droit de décider !
Tout en oeuvre pour bâtir le Nouveau !


L'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) qui doit
remplacer l'actuel Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) a été
signé par les représentants gouvernementaux du Canada, des États-Unis
et du Mexique le 30 novembre 2018 et a été signé à nouveau
le 10 décembre 2019 après l'inclusion de plusieurs
modifications. Les gouvernements des trois pays doivent adopter
officiellement l'ACEUM pour qu'il entre en vigueur. Entre-temps,
l'ALÉNA demeure en vigueur. L'ALÉNA a été signé en 1992 par les
dirigeants des États-Unis, du Mexique et du Canada et est entré en
vigueur le 1er janvier 1994.
L'objectif officiel déclaré de l'ALÉNA, qui a été
utilisé à des fins de propagande pour intensifier l'offensive
antisociale, était d'accorder à chaque pays les meilleurs tarifs
possibles sur certaines marchandises, un arrangement appelé la clause
de la nation la plus favorisée, d'éliminer les barrières commerciales
et de faciliter le commerce des biens et des services, promouvoir une
concurrence loyale, accroître les opportunités d'investissement et,
ultimement, établir un cadre de coopération future en matière de
commerce entre les trois pays.
Le résultat a été l'accélération de la tendance déjà
évidente : l'intégration de l'économie des trois pays de
l'Amérique du Nord dans une forteresse dominée et dirigée par les
factions les plus puissantes de l'oligarchie financière et leurs
conglomérats et cartels. Le contrôle des oligarques au pouvoir est si
étendu qu'ils ont politisé leurs intérêts privés et les ont intégrés au
gouvernement et à l'État. La plupart des règlements et des restrictions
sur les opérations et les investissements des grandes entreprises ont
été supprimés, dilués, ignorés ou voués à l'élimination.
Cela signifie que le pouvoir du gouvernement consiste
principalement à canaliser la richesse sociale recueillie publiquement
vers différentes factions de l'oligarchie financière, à restreindre les
actions de la classe ouvrière pour défendre ses intérêts et à utiliser
l'armée, les ressources humaines et naturelles et la richesse sociale
produite de la Forteresse Amérique du Nord pour la guerre et d'autres
actions pour établir leur hégémonie sur le monde entier.
Le pouvoir direct de l'oligarchie financière aligné avec
les impérialistes américains, sur les affaires économiques, politiques,
militaires et sociales de l'Amérique du Nord et leur lutte pour
l'hégémonie mondiale sont à l'origine des changements à l'ALENA pour
créer la CUSMA. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) et son
mécanisme de règlement des différends, par exemple, sont remplacés
parce qu'ils entravent la capacité des impérialistes américains à faire
ce qu'ils veulent. De même, les principes des relations internationales
pour maintenir la paix que l'ONU est censée incarner et défendre ont
été systématiquement sapés.
Une grande partie des mécanismes et des règles de
l'ALÉNA, de l'Organisation mondiale du commerce et des Nations unies
ont perdu leur pertinence et ont été remplacés par le pouvoir direct de
l'oligarchie financière sur l'économie, les affaires politiques,
militaires et sociales de l'Amérique du Nord et sa lutte pour
l'hégémonie mondiale.
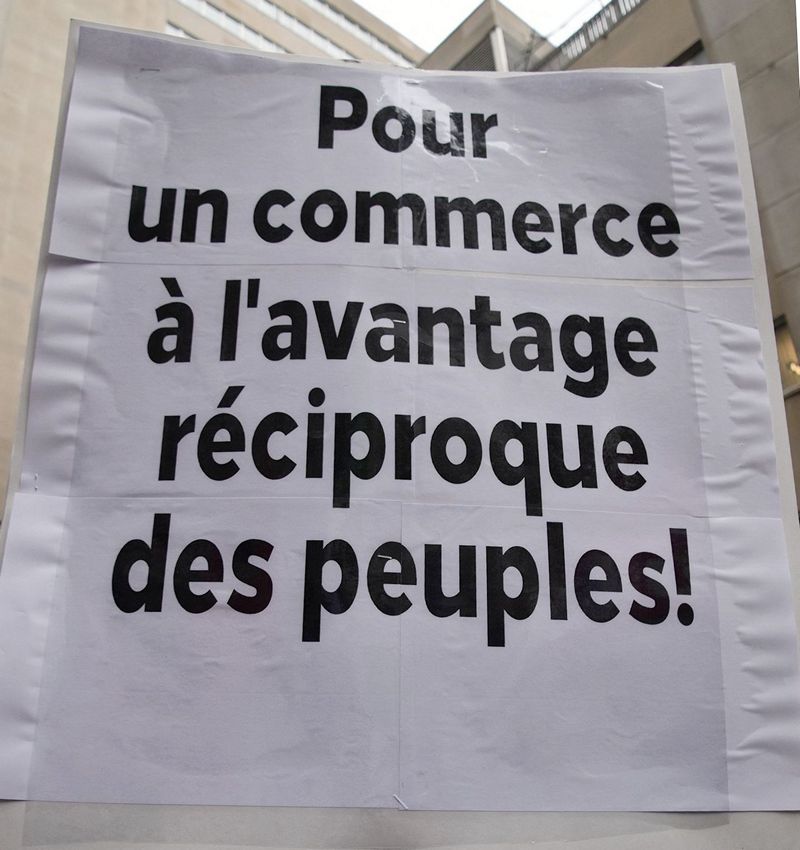 La politisation des intérêts privés de
l'oligarchie
financière se traduit par l'anarchie et la violence à l'échelle
mondiale sans droit commercial international pour empêcher les
concurrents de se détruire ou de s'entre-tuer. D'une certaine manière,
les intérêts privés politisés reflètent l'anarchie du Far West à
l'échelle mondiale. L'arbitraire des intérêts privés politisés se voit
dans la façon dont le président Trump brandit les tarifs comme arme
pour gagner des avantages sur la Chine et d'autres pays identifiés
comme des concurrents hostiles, et imposer des sanctions et des
boycottages à tout pays qui ne se soumet pas à la domination des
États-Unis. La politisation des intérêts privés de
l'oligarchie
financière se traduit par l'anarchie et la violence à l'échelle
mondiale sans droit commercial international pour empêcher les
concurrents de se détruire ou de s'entre-tuer. D'une certaine manière,
les intérêts privés politisés reflètent l'anarchie du Far West à
l'échelle mondiale. L'arbitraire des intérêts privés politisés se voit
dans la façon dont le président Trump brandit les tarifs comme arme
pour gagner des avantages sur la Chine et d'autres pays identifiés
comme des concurrents hostiles, et imposer des sanctions et des
boycottages à tout pays qui ne se soumet pas à la domination des
États-Unis.
Les droits imposés sur le bois d'oeuvre qui attaquent la
production et les ventes canadiennes aux États-Unis ne sont qu'un
exemple. Les tarifs sont considérés comme un avantage pour les intérêts
privés des grands producteurs de bois d'oeuvre, car les prix de détail
ont augmenté de façon exponentielle. Les cinq plus gros producteurs de
bois d'oeuvre résineux canadiens ont profité de la hausse des prix,
fermé des scieries au Canada et investi massivement aux États-Unis et
en Europe.
Cependant, les conditions pour que des accords tels que
l'ACEUM et des organes tels que l'OMC puissent ordonner ou résoudre les
contradictions n'existent plus. L'anarchie et la violence dans les
relations internationales et le diktat des pouvoirs supranationaux
dominent. Dans ces conditions d'anarchie et de violence, l'adhésion aux
règles pour faire respecter les accords et arrangements n'existe plus,
sauf dans les cas où une puissante faction de l'oligarchie financière
veut les utiliser de manière opportuniste. Inutile de dire que le temps
est venu pour une nouvelle direction de l'économie qui favorise la
classe ouvrière des trois pays d'Amérique du Nord, qui restreint les
activités de l'oligarchie financière et prend des mesures nécessaires
pour éliminer l'anarchie et la violence qui règnent désormais dans les
relations internationales.
Les révisions de décembre 2019 et les
modifications proposées
à l'ALÉNA pour l'ACEUM
Les secteurs spécifiques qui seront touchés par
la modification des arrangements actuels avec l'adoption de l'ACEUM
sont, entre autres, le secteur agricole, l'industrie automobile et
l'industrie pharmaceutique, et les règlements qui touchent les
relations économiques des trois pays avec les autres pays du monde.
L'attaque contre les agriculteurs canadiens
 L'oligarchie financière tient
particulièrement à éliminer le système traditionnel de gestion de
l'offre du Canada et du Québec dans le secteur laitier. Les
agriculteurs ont mené une lutte acharnée pour défendre leurs droits au
sein d'un Canada souverain et de son économie. En accordant l'accès en
franchise de droits au marché laitier canadien pour les deux autres
pays et inversement, l'ACEUM cherche à détruire le droit souverain des
agriculteurs d'organiser leur secteur. Le secteur agricole américain
est reconnu pour sa domination en raison de la taille de ses
exploitations et de son intégration avec l'oligarchie financière. Les
conglomérats du secteur pourront vendre à des prix inférieurs aux prix
de production pour éliminer les concurrents dans le secteur laitier,
comme ils l'ont fait aux États-Unis.[1] L'oligarchie financière tient
particulièrement à éliminer le système traditionnel de gestion de
l'offre du Canada et du Québec dans le secteur laitier. Les
agriculteurs ont mené une lutte acharnée pour défendre leurs droits au
sein d'un Canada souverain et de son économie. En accordant l'accès en
franchise de droits au marché laitier canadien pour les deux autres
pays et inversement, l'ACEUM cherche à détruire le droit souverain des
agriculteurs d'organiser leur secteur. Le secteur agricole américain
est reconnu pour sa domination en raison de la taille de ses
exploitations et de son intégration avec l'oligarchie financière. Les
conglomérats du secteur pourront vendre à des prix inférieurs aux prix
de production pour éliminer les concurrents dans le secteur laitier,
comme ils l'ont fait aux États-Unis.[1]
L'industrie automobile
En 1965, les trois grands constructeurs automobiles
de l'époque (Ford, GM et Chrysler) ont établi un cartel organisé par
l'État avec l'Accord canado-américain sur les produits de l'industrie
automobile. Le Pacte de l'automobile a intégré efficacement l'industrie
automobile des États-Unis et du Canada sous le contrôle des trois
grands monopoles américains et de divers fabricants de pièces
automobiles. Pour le cartel de l'automobile, le commerce entre le
Canada et les États-Unis est devenu principalement une libre
circulation interne sans droit tarifaire des produits dans le cadre
d'un processus de production connu sous le nom de «
juste-à-temps ».
Dans la plupart des secteurs, y compris celui de
l'énergie, les échanges internes entre les divisions des entreprises
privées géantes, principalement contrôlées par les États-Unis, dont les
marchandises circulent entre le Canada et les États-Unis, sont devenus
un trait dominant de l'intégration du Canada à l'économie américaine au
cours des dernières décennies du XXe siècle. Le Canada ne fait pas de
commerce avec les États-Unis comme pays souverain qui contrôle ses
affaires économiques, mais comme une économie capturée et intégrée au
sein de la Forteresse Amérique du Nord dominée par une oligarchie
financière.
Grâce au Pacte de l'automobile, le cartel de
l'automobile a pu accéder à une force productive humaine canadienne
instruite, en santé et disciplinée. Deux importants programmes sociaux
ont fait en sorte que la capacité de travailler des Canadiens était
moins chère que celle des travailleurs aux États-Unis : le
programme national d'assurance-maladie du Canada et
l'assurance-chômage, qui deviendra plus tard l'assurance-emploi.
Les monopoles de l'automobile des États-Unis n'avaient
pas à payer d'assurance-maladie privée pour leurs travailleurs au
Canada, comme ils le faisaient aux États-Unis. Ils pouvaient organiser
de grandes mises à pied irrégulières, car les travailleurs recevaient
des prestations d'assurance-chômage presque équivalentes à leur salaire
normal. Ainsi les travailleurs demeuraient en contact comme
travailleurs de l'automobile expérimentés, qui pouvaient être rappelés
même pendant les mises à pied prolongées.[2]
Avec l'extension progressive du secteur automobile dans
le monde entier au cours des dernières décennies du XXe siècle,
notamment les importants investissements mondiaux dans la production
automobile en Asie de l'Est, le Pacte de l'automobile a perdu sa
pertinence pour l'oligarchie financière et est en fait devenu un
irritant pour les producteurs japonais et sud-coréens en plein essor
qui avaient des liens étroits avec les grands investisseurs des
États-Unis. En 1994, l'Accord de libre-échange entre les
États-Unis et le Canada et l'ALÉNA ont remplacé le Pacte de
l'automobile et ont intégré l'ensemble de la production automobile en
Amérique du Nord, limité auparavant aux trois grands d'origine, en un
marché libre.
Le développement inégal de l'impérialisme, l'évolution
des techniques de production et l'augmentation rapide du transport
maritime international de marchandises ont permis à la production de
véhicules de prendre de l'importance en Asie et au Mexique et entraîné
son déclin aux États-Unis et au Canada. L'ALÉNA a alors perdu sa
pertinence pour ce secteur.
L'oligarchie financière cherche toujours à renforcer son
contrôle aux dépens de ses concurrents et de la classe ouvrière. Sous
son contrôle et pour favoriser les intérêts privés des oligarques, le
secteur automobile américain et canadien subit de profonds changements
et ce sont les travailleurs de l'automobile qui portent le fardeau des
licenciements permanents sans perspectives de trouver un emploi
similaire.
Leurs villes, comme Oshawa, Oakville, Windsor et de
nombreuses autres aux États-Unis, subissent les graves conséquences de
la contraction de leur économie. Les changements proposés pour le
secteur automobile avec l'ACEUM visent à favoriser l'oligarchie
financière alors que la classe ouvrière est attaquée, n'a pas son mot à
dire et n'a aucun contrôle sur ce qui touche sa vie et l'économie, et
n'a certainement pas donné son consentement.
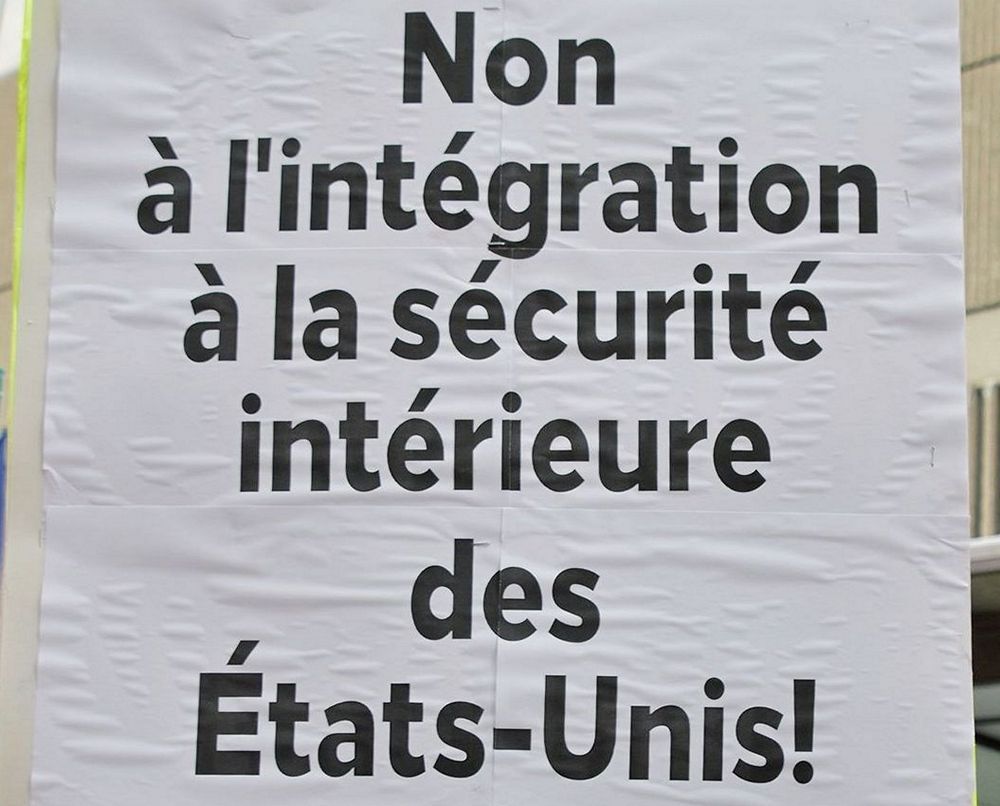 Dans le cadre de l'ACEUM, pour
être exempt de droits de
douane sur le marché nord-américain, un minimum de 75 % du
prix de production d'un véhicule doit avoir été produit à l'intérieur
de la Forteresse Amérique du Nord. Cela n'apporte aucune garantie que
la production se poursuivra dans des usines déjà établies, car ceux qui
en ont le contrôle introduisent rapidement de nouvelles techniques de
production et déplacent la production selon leurs intérêts privés
étroits, perspectives et critères qui vont à l'encontre du bien-être du
facteur humain, du développement d'une économie durable diversifiée qui
diminue le fardeau de l'introduction de nouvelles techniques et
détourne de la culture automobile, de sa pollution de l'environnement
et d'autres facteurs négatifs. Dans le cadre de l'ACEUM, pour
être exempt de droits de
douane sur le marché nord-américain, un minimum de 75 % du
prix de production d'un véhicule doit avoir été produit à l'intérieur
de la Forteresse Amérique du Nord. Cela n'apporte aucune garantie que
la production se poursuivra dans des usines déjà établies, car ceux qui
en ont le contrôle introduisent rapidement de nouvelles techniques de
production et déplacent la production selon leurs intérêts privés
étroits, perspectives et critères qui vont à l'encontre du bien-être du
facteur humain, du développement d'une économie durable diversifiée qui
diminue le fardeau de l'introduction de nouvelles techniques et
détourne de la culture automobile, de sa pollution de l'environnement
et d'autres facteurs négatifs.
L'ACEUM cherche à normaliser le prix payé pour la
capacité de travail des travailleurs de l'automobile nord-américains
à 16 $ l'heure, ce qui est bien inférieur au prix actuel aux
États-Unis et au Canada. Avec cette manoeuvre, l'ACEUM cherche à
éliminer les syndicats de l'automobile en tant qu'organisations
indépendantes de la classe ouvrière, qui négocient collectivement avec
l'oligarchie financière des conditions d'emploi acceptables pour les
travailleurs de l'automobile dans les trois pays.
Le Mexique a accepté d'établir de nouveaux mécanismes
bilatéraux avec les États-Unis et le Canada afin de permettre une
ingérence directe dans ses rapports de production dans le secteur
automobile et d'intégrer davantage son économie à la Forteresse
Amérique du Nord sous le contrôle de l'oligarchie financière. Un
communiqué de presse du gouvernement du Canada détaillant les
changements finalisés en décembre se lit : « Le Canada a établi un
nouveau mécanisme bilatéral avec le Mexique en application du chapitre
sur le règlement des différends dans le domaine du travail. [...] Ce
mécanisme d'intervention rapide propre aux installations fournira au
Canada un processus amélioré pour veiller à la mise en oeuvre efficace
de certaines obligations en matière de main-d'oeuvre dans les
installations visées. Si une partie a des préoccupations ... elle peut
demander la tenue d'une enquête par un groupe indépendant d'experts du
travail et, sous réserve d'une confirmation, elle peut prendre des
mesures pour imposer des sanctions visant les exportations de ces
installations. »
Des règles sur l'acier et aucune pour l'aluminium
Les règles d'origine de l'ACEUM exigent
que 70 % de l'acier acheté par les assembleurs de véhicules
soit considéré comme originaire de la région de l'ACEUM. Le nouvel
ALÉNA révisé prévoit la mise en oeuvre de règles sur l'acier sur une
période de sept ans.
Aucune règle de ce genre n'a été incluse pour
l'aluminium. La délégation canadienne aurait réclamé qu'un certain
pourcentage d'aluminium utilisé dans les automobiles soit fondu en
Amérique du Nord, mais les États-Unis et le Mexique ont refusé de
l'accepter. Le Canada est de loin le plus grand producteur d'aluminium
de la Forteresse Amérique du Nord. Les oligopoles qui contrôlent la
production d'aluminium ont des installations partout dans le monde et
utilisent leur production mondiale pour attaquer les travailleurs du
Québec et de la Colombie-Britannique et pour exiger des gouvernements
des concessions sur le prix de l'électricité, qui est un facteur
important de la production.
L'absence d'un accord sur les règles d'origine de
l'aluminium pourrait être un des points qui posent problème lorsque
l'ACEUM arrivera au parlement canadien pour être ratifié. Le Bloc
québécois a déjà fait part de sa déception face à cette faille dans
l'accord.
La « propriété intellectuelle »
Dans le chapitre sur la « propriété
intellectuelle », la durée du droit d'auteur d'un contenu comme
les enregistrements sonores passera de 70 ans à 75 ans. Avec
les modifications de décembre, les produits biologiques tels que les
vaccins recevront des brevets conformément aux accords existants dans
chaque pays. Au Canada, leur durée est de huit ans. Cela permet aux
grandes pharmaceutiques de vendre des médicaments à des coûts élevés
pendant au moins huit ans, y compris aux agences gouvernementales dans
le cadre des programmes d'assurance-médicaments. Les produits
pharmaceutiques hors marque ou génériques, une alternative moins
coûteuse à de nombreux médicaments couramment utilisés, ne seront pas
disponibles pendant la période de protection par le brevet.[3]
Le gouvernement abdique ses responsabilités sociales
L'ACEUM comprend des dispositions de coopération
réglementaire qui limitent la capacité de chaque gouvernement de
réglementer la production et la vente de biens dans des domaines comme
les produits chimiques, la sécurité alimentaire et l'environnement.
Cela profite directement aux conglomérats de l'oligarchie financière,
car les gouvernements n'ont que peu de pouvoir pour contrôler ce qui
est produit et vendu en Amérique du Nord.
 L'ACEUM donne à l'oligarchie
financière des pouvoirs
extraordinaires pour contrôler les règlements couvrant toutes sortes
d'affaires économiques qui empêchent le gouvernement de s'acquitter de
ses responsabilités sociales. Dans le cadre de l'ACEUM, les
gouvernements doivent permettre aux grandes entreprises d'examiner tout
projet de règlement régissant leur secteur ou leur industrie avant
d'adopter une loi. De fait, cela politise les intérêts privés et les
activités des conglomérats de l'oligarchie financière de manière très
précise. L'ACEUM donne à l'oligarchie
financière des pouvoirs
extraordinaires pour contrôler les règlements couvrant toutes sortes
d'affaires économiques qui empêchent le gouvernement de s'acquitter de
ses responsabilités sociales. Dans le cadre de l'ACEUM, les
gouvernements doivent permettre aux grandes entreprises d'examiner tout
projet de règlement régissant leur secteur ou leur industrie avant
d'adopter une loi. De fait, cela politise les intérêts privés et les
activités des conglomérats de l'oligarchie financière de manière très
précise.
De plus, aucune participation ou surveillance du public
n'est permise dans l'élaboration des règlements. L'ACEUM donne aux
entreprises un préavis des nouveaux règlements. Les personnes dites «
intéressées » sont avisées à l'avance du projet de règlement du
gouvernement et ont droit de participer à un processus de consultation
avant qu'un règlement ne soit adopté par une assemblée législative.
Tous les règlements doivent être « fondés sur la
science ». La politique d'édification de la nation n'est pas
considérée comme « fondée sur la science » selon la définition
impérialiste, pas plus que les considérations sociales ou autres
considérations pour faire face à des problèmes et des défis comme la
pauvreté, le changement climatique, le développement régional ou la
tendance impérialiste à une économie de guerre et la nécessité de faire
du Canada une zone de paix. Les conglomérats peuvent rejeter les
règlements qu'ils considèrent comme non « fondés sur la science ».
Le gouvernement doit prouver qu'un projet de règlement
s'appuie sur la science tandis que les intérêts privés des conglomérats
n'ont pas à prouver que leur production ou leurs autres activités ne
sont pas nuisibles à la vie collective de la nation, au bien-être du
peuple ou à la santé de la Terre Mère. L'ACEUM renverse le « principe
de précaution » de la société civile selon lequel les intérêts
privés sont censés prouver que leurs activités ne nuisent pas au bien
commun. En excluant le principe de précaution, l'ACEUM impose à ceux
qui élaborent des règlements le fardeau de défendre leurs règles
lorsqu'elles sont contestées par de puissants intérêts privés.
Le Conseil des Canadiens souligne que dans le cadre de
l'ACEUM « les organismes de réglementation doivent défendre
vigoureusement les règlements proposés et sont même tenus de proposer
des solutions de rechange qui ne comportent pas de réglementation. Ils
doivent fournir une analyse approfondie, y compris les coûts-avantages
pour l'industrie. »
Dans la pratique, dans la société civile, le principe de
précaution s'est souvent avéré être une escroquerie lorsqu'il était
confronté aux intérêts privés de l'oligarchie financière, où la
responsabilité sociale des conséquences est ignorée et les preuves
supprimées. Les exemples sont nombreux, comme dans le cas du tabac et
des risques pour la santé liés au tabagisme, la culture de l'automobile
et l'hécatombe sur les routes, la congestion et la pollution
atmosphérique, le secteur de l'énergie et la pollution menant au
changement climatique, les grandes sociétés pharmaceutiques et la
promotion des opiacés entraînant la dépendance et une mortalité
grandissante et le recours à la violence pour régler les différends
dans les relations internationales, ce qui élargit l'économie de
guerre, ce qui favorise la vente et l'utilisation de sa production
d'armements
La normalisation des règlements
L'ACEUM insiste pour que les trois pays harmonisent
leurs règlements ou aient au moins des règlements similaires. De
nombreux commentateurs soulignent que cette normalisation abaissera les
normes au plus bas dénominateur commun et niera toute indépendance
d'action selon les conditions concrètes dans les trois pays.
Les entreprises peuvent contester la réglementation d'un
pays si elle n'est pas standard ou similaire à celle des deux autres ou
d'un autre pays. Cette coopération en matière de règlement est
assujettie au règlement des différends, ce qui signifie que les grandes
sociétés peuvent contester directement les mesures prises par le
gouvernement devant un organisme non gouvernemental.
L'ACEUM permet et encourage à certains égards les
conglomérats de l'oligarchie financière à défendre leurs intérêts
privés et à faire pression pour que des modifications soient apportées
à la réglementation qui porte sur des questions comme les organismes
génétiquement modifiés, les glyphosates comme l'herbicide Roundup de
Monsanto/Bayer, l'étiquetage des produits de santé et des cigarettes,
les règles sur l'inspection des aliments et celles qui portent
généralement sur la sécurité du public. Une grande partie de cette
activité se déroulerait en privé, derrière des portes closes.
Le règlement des différends
Le chapitre 20 de l'ALÉNA, qui énonce le mécanisme
de règlement des différends de pays à pays, et le chapitre 19, qui
énonce le mécanisme de règlement des différends en matière de droits
antidumping et compensateurs, sont maintenus. Beaucoup considèrent que
ces deux mécanismes portent atteinte au droit souverain des nations de
réglementer les importations, car ils confient le règlement des
différends à un groupe non gouvernemental. Comme la plupart des accords
de libre-échange, ces mécanismes créent un organe supranational pour
traiter les plaintes. Les États-Unis s'opposent depuis longtemps à leur
utilisation et ont en fait réduit la portée du chapitre 19 par un
accord parallèle avec le Mexique. La seule utilisation importante du
chapitre 19 a été la contestation par le Canada en matière de
droits sur le bois d'oeuvre. Le Canada a remporté sa cause, mais les
autorités américaines sont tout simplement revenues à la charge avec de
nouveaux tarifs et de nouveaux arguments.
L'oligarchie financière américaine s'oppose à ces
arbitrages, car ils empiètent sur son pouvoir privé. Elle essaie
présentement d'éliminer le processus de règlement des différends de
l'OMC en bloquant les nominations et le renouvellement de mandat des
juges d'arbitrage. Étant donné que trois juges sont nécessaires pour
chaque appel, le système devrait s'effondrer à l'expiration du mandat
de deux juges en décembre 2019.
De même, les autorités américaines bloquent
l'utilisation du chapitre 20 depuis 2000, date à laquelle
elles ont refusé de nommer des représentants à un groupe spécial chargé
d'examiner une plainte du Mexique sur les tarifs américains sur le
sucre. Aucun groupe spécial du chapitre 20 de l'ALÉNA n'a pu être
établi depuis.
L'ACEUM élimine le chapitre 11 de l'ALÉNA, le
mécanisme de règlement des différends entre le Canada et les États-Unis
en matière d'investissements d'État, ce qui semble contredire la
volonté de maintenir les chapitres 19 et 20, mais il le
maintient dans certains cas entre les États-Unis et le Mexique.
L'élimination du chapitre 11 a été saluée par certains comme une
victoire populaire, mais un examen plus approfondi permet de croire
qu'il a perdu toute importance avec l'élargissement des pouvoirs
supranationaux de l'oligarchie financière au sein de la Forteresse
Amérique du Nord.
Le chapitre 11 était un mécanisme qui permettait
aux sociétés privées d'intenter une action en justice contre un
gouvernement étranger si elles croyaient que les politiques d'un
gouvernement étranger portaient atteinte à leur droit de faire du
commerce dans ce pays suivant les conditions fixées par l'ALÉNA. Avec
la normalisation des réglementations et autres pouvoirs, l'oligarchie
financière peut imposer sa volonté dans la plupart des cas, à moins
d'une résistance populaire résolue. Les oligarques pensent sans doute
que le chapitre 11 est devenu un paratonnerre pour l'opposition et
est trop de tracas. Sans compter que les néolibéraux peuvent maintenant
dire que c'est une victoire pour le peuple et la souveraineté et une
pièce maîtresse du nouvel ALÉNA.
Restrictions sur les négociations avec les pays «
n'ayant pas
une économie de marché »
L'ACEUM stipule : « À la demande d'une autre
Partie, une Partie qui a l'intention d'amorcer des négociations en vue
de conclure un accord de libre-échange avec un pays n'ayant pas une
économie de marché fournit, sur demande d'une autre Partie, autant de
renseignements que possible sur les objectifs des négociations
précitées. Pour l'application du présent article, un pays n'ayant pas
une économie de marché est un pays qui, à la fois, a) à la date de
signature du présent accord, est considéré par une Partie comme n'ayant
pas une économie de marché aux fins de la législation sur les recours
commerciaux de la Partie en question et b) n'a conclu d'accord de
libre-échange avec aucune des Parties. [...]
« Si une Partie conclut un accord de libre-échange avec
un pays n'ayant pas une économie de marché, les autres Parties pourront
mettre fin au présent accord moyennant un préavis de six mois, et
remplacer le présent accord par un accord bilatéral entre elles. »
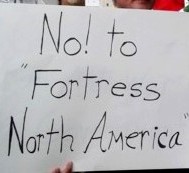 Au moment de la publication du contenu de
l'ACEUM, la Presse canadienne rapportait que le député conservateur
Michael Chong a accusé le gouvernement libéral de renoncer à une mesure
importante de souveraineté dans l'entente. « Nous devons maintenant
demander l'autorisation de Washington pour entamer des négociations
commerciales avec certains pays que les États-Unis désigneront comme
pays n'ayant pas une économie de marché, a déclaré Chong. Cela fait
littéralement de nous un État vassal des Américains. » Au moment de la publication du contenu de
l'ACEUM, la Presse canadienne rapportait que le député conservateur
Michael Chong a accusé le gouvernement libéral de renoncer à une mesure
importante de souveraineté dans l'entente. « Nous devons maintenant
demander l'autorisation de Washington pour entamer des négociations
commerciales avec certains pays que les États-Unis désigneront comme
pays n'ayant pas une économie de marché, a déclaré Chong. Cela fait
littéralement de nous un État vassal des Américains. »
Dans une entrevue avec Reuters, le secrétaire américain
au Commerce, Wilbur Ross, a défendu la clause en question en la
qualifiant de « pilule empoisonnée pour dissuader les accords avec la
Chine ». Ross a déclaré que la clause vise à « colmater les
brèches dans les accords commerciaux qui ont servi à légitimer le
commerce, la propriété intellectuelle et les pratiques de subventions
industrielles de la Chine ». [4]
La clause crépusculaire
Les termes de l'ACEUM resteront en vigueur pendant une
période de 16 ans, date à laquelle les parties peuvent choisir de
revoir et/ou renégocier ces conditions, ou de se retirer complètement
de l'accord. Après six ans, la clause crépusculaire de 16 ans peut
être réexaminée et possiblement prolongée.
Article 232 sur les droits américains
En mars 2018, les États-Unis ont imposé des droits
de douane de 25 % sur l'acier importé et de 10 %
sur l'aluminium importé en vertu de l'article 232 de la Trade
Expansion Act de 1962, qui permet au président américain
d'imposer des droits de douane pour des raisons de sécurité nationale.
Le président Trump aurait utilisé les tarifs pour extorquer certaines
concessions demandées par la faction qu'il représente. Les tarifs de
l'article 232 sur l'acier et l'aluminium produits au Canada et au
Mexique ont finalement été retirés.
Les États-Unis songent également à invoquer
l'article 232 pour imposer des droits de 25 % sur toutes
les importations d'automobiles. L'ACEUM comprend des lettres
d'accompagnement dans lesquelles il est stipulé que si les États-Unis
imposent des tarifs sur les importations d'automobiles, le Canada et le
Mexique disposeraient d'une période de franchise de deux mois pour
prendre d'autres dispositions.
Les tarifs de l'article 232 et les tarifs du bois
d'oeuvre résineux montrent à quel point les relations au sein de la
Forteresse Amérique du Nord et au-delà sont précaires et incertaines,
on pourrait même dire sans loi, et sujettes aux exigences pragmatiques
des factions rivales de l'oligarchie financière dans leur lutte pour le
contrôle de la présidence américaine.
Les achats en ligne et la circulation des données
L'ACEUM augmente la limite de franchise de droits pour
les Canadiens qui achètent des produits américains en ligne
de 20 $ à 150 $. Il permet aux entreprises de
transférer des données à travers les frontières sans rencontrer
d'obstacles.
Jason Oxman, président du groupe de commerce
technologique ITI, dit que les dispositions numériques du pacte
établissent « un nouveau précédent important pour les règles
commerciales modernes ». (Associated Press) Les détails du pacte
ne clarifient pas l'importance de ces « règles commerciales
modernes » pour les données ni ce que cela signifie pour les
Canadiens, par exemple dans le domaine de la vie privée ou des affaires
politiques.
Le contexte de la renégociation de l'ALÉNA
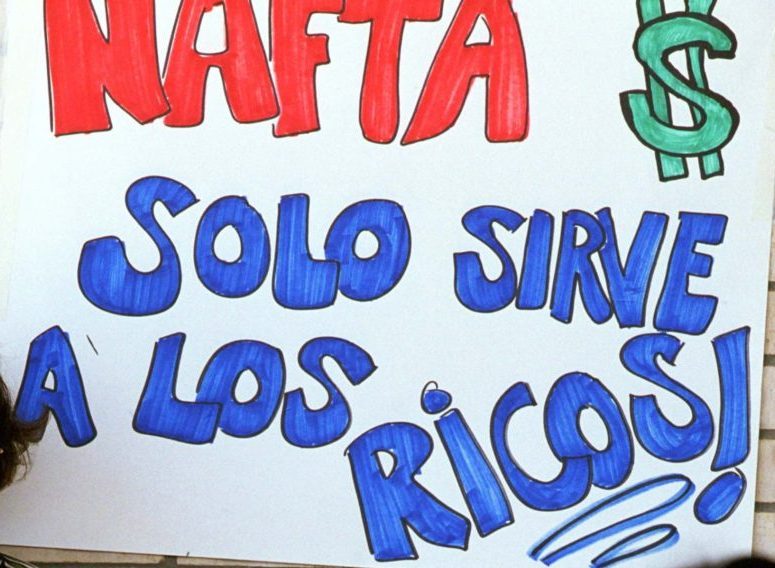 L'Accord de libre-échange nord-américain
(ALÉNA) est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Depuis
lors, le commerce entre les trois pays a connu une croissance
exponentielle, en partie grâce à l'établissement de chaînes
d'approvisionnement continentales des plus grands conglomérats. Chaque
jour, les États-Unis font plus de 3,6 milliards de dollars
d'échanges commerciaux avec le Canada et le Mexique. Le PIB annuel
combiné de la Forteresse Amérique du Nord est supérieur à 22
billions de dollars américains. L'Accord de libre-échange nord-américain
(ALÉNA) est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Depuis
lors, le commerce entre les trois pays a connu une croissance
exponentielle, en partie grâce à l'établissement de chaînes
d'approvisionnement continentales des plus grands conglomérats. Chaque
jour, les États-Unis font plus de 3,6 milliards de dollars
d'échanges commerciaux avec le Canada et le Mexique. Le PIB annuel
combiné de la Forteresse Amérique du Nord est supérieur à 22
billions de dollars américains.
L'ALÉNA a permis à l'oligarchie financière de déplacer
ses entreprises là où cela convient à ses intérêts privés étroits et là
où les fonds et les infrastructures publics sont le plus généreusement
offerts dans des stratagèmes pour payer les riches. Des progrès dans la
technologie de production et de transport ont été faits au profit de
l'oligarchie financière sans tenir compte du bien-être de la classe
ouvrière, de la stabilité et de la sécurité de l'économie nationale et
régionale ou des impacts sur l'environnement social et naturel.
Les entreprises de l'oligarchie financière ont établi
des réseaux de fabricants, vendeurs, fournisseurs et distributeurs qui
dépendent fortement de la libre circulation des marchandises par les
frontières de l'Amérique du Nord. Des couloirs de transport à cet effet
sont envisagés pour maximiser les avantages et les bénéfices des
oligarques.
L'ACEUM se concentre sur ce que l'administration
américaine appelle la modernisation dans les domaines des droits de
propriété intellectuelle, des pratiques réglementaires, des droits des
travailleurs, de l'environnement, des marchés publics et d'un certain
nombre d'autres domaines clés.
Notes
1. La gestion de l'offre est un
système selon lequel le gouvernement canadien émet des permis qui
permettent aux agriculteurs certains quotas de production de produits
laitiers, de volaille et d'oeufs. Il contrôle également le prix des
importations au Canada de ces produits. Ce processus garantit aux
agriculteurs de tirer des revenus durables et garantit que les petites
exploitations locales ne sont pas inondées par les produits agricoles
provenant des mégafermes aux États-Unis et en Europe.
Les changements apportés au nouvel ALÉNA entraîneront un
afflux de produits agricoles en provenance des États-Unis, y compris
des produits laitiers américains qui peuvent provenir de vaches qui ont
reçu des hormones de croissance bovine génétiquement modifiées (SBTR)
pour augmenter leur production de lait. Il n'existe actuellement aucune
exigence d'étiquetage pour le lait provenant des vaches traitées au
SBTR, de sorte que les consommateurs ne sauront pas ce qu'ils boivent.
L'industrie agroalimentaire des États-Unis est fortement
subventionnée par des fonds publics et intégrée à l'oligarchie
financière. Permettre un plus grand accès au marché aux exploitations
agricoles d'entreprises américaines signifierait que les petits
agriculteurs canadiens seraient en concurrence avec des producteurs
beaucoup plus grands capables de manipuler les prix à leur avantage.
« Le Conseil des Canadiens s'oppose à la ratification
d'un nouvel ALÉNA qui érode notre système de gestion de l'offre et met
en péril notre souveraineté alimentaire. »
Les citations directes en anglais se retrouvent ici.
(Traduit de l'anglais par LML)
2. « En 1964, 7 %
des véhicules fabriqués au Canada étaient vendus aux États-Unis, alors
qu'à partir de 1968, c'était 60 %. À la même
date, 40 % des automobiles achetées au Canada étaient
fabriquées aux États-Unis. La production d'automobiles et de pièces
automobiles dépassa, en valeur marchande, la production de l'industrie
papetière, au point de devenir la plus importante industrie du Canada.
Le déficit commercial se résorba et devint un surplus commercial annuel
valant des milliards de dollars canadiens. De 1965 à 1982, le
déficit commercial total du Canada avec les États-Unis était
de 12,1 milliards de dollars ; c'était le résultat d'un
surplus commercial d'environ 28 milliards de dollars de véhicules
assemblés et un déficit commercial d'environ 40,5 milliards de
dollars en pièces automobiles. [...]
« Le pacte a bénéficié aux travailleurs canadiens, car
il s'agit d'un milieu de travail dont le salaire moyen est nettement
supérieur à la moyenne nationale. Il a par contre amené des
inconvénients majeurs. Il a créé une situation de dépendance envers
l'industrie automobile américaine, ce qui a défavorisé la création
d'une industrie nationale. Par ailleurs, les usines sont surtout des
unités de fabrication, l'administration et la recherche et
développement sont demeuréss concentréss aux États-Unis. Le traité a
aussi interdit au Canada d'établir des relations semblables avec
d'autres fabricants automobiles.
« Le Canada devait aussi adhérer aux NHTSA, normes
américaines régissant la sécurité et l'émission de polluants
automobiles, il ne pouvait donc s'aligner sur les ECE Vehicle
Regulations, normes internationales établies par l'UNECE, ce qui
prévint la production canadienne de trouver des débouchés en dehors de
l'Amérique du Nord. [...]
« Il a été aboli en 2001 après que l'OMC l'ait
déclaré illégal. À ce moment, l'ALÉNA l'avait déjà largement
remplacé. » (Wikipédia)
« En 1966, les exportations canadiennes de
véhicules et de pièces aux États-Unis s'élèvent à 886 millions de
dollars. En 1977, elles atteignent 9,9 milliards. De même,
les importations canadiennes des États-Unis passent de 1,5
milliard en 1966 à 10,9 milliards en 1977.
« Dans l'ensemble, le Pacte de l'automobile a atteint
son objectif d'établir un réseau de production intégré au Canada et aux
États-Unis. En 1965, le Canada n'exportait que 48 000
véhicules aux États-Unis, représentant seulement 6 % de la
production canadienne, tandis que les États-Unis n'exportaient
que 64 000 véhicules au Canada, soit 0,6 % de la
production de véhicules de type nord-américain des États-Unis. Une
dizaine d'années plus tard, en 1975, le Canada
exportait 849 000 véhicules aux États-Unis,
représentant 59 % de la production canadienne, tandis que les
États-Unis exportaient 698 000 véhicules au Canada,
soit 8 % de la production américaine. » (Extrait de l'Encyclopédie
canadienne)
Il est à noter que la croissance dans son ensemble de la
production de véhicules doit être évaluée à la lumière de l'énorme
promotion de la culture automobile dans les films et à la télévision,
en particulier auprès des jeunes. Cette pression sur les individus
d'utiliser et acheter des voitures a inclus l'aménagement urbain dans
les plus grandes villes qui obligeait de nombreux travailleurs à
acheter des voitures pour se rendre au travail et pour leurs loisirs.
3. Le nouvel ALÉNA confirme aux
grandes sociétés pharmaceutiques américaines la durée actuelle de leurs
brevets, qui au Canada est de huit ans d'exclusivité. L'accord comprend
des produits biologiques, une nouvelle classe de médicaments fabriqués
à partir de tissus humains ou animaux. Les produits biologiques
comprennent des médicaments tels que l'insuline et des médicaments qui
traitent le cancer, l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et la
colite ulcéreuse.
En 2016, les Canadiens ont dépensé 30
milliards de dollars pour faire remplir plus de 600 millions
d'ordonnances. Les Canadiens paient déjà le deuxième prix le plus élevé
des pays de l'OCDE pour les médicaments sur ordonnance. Des études ont
révélé que de nombreuses personnes ne peuvent pas se permettre les
médicaments qui leur sont prescrits.
(Source : Le Conseil des Canadiens)
4. Ce que dit l'ACEUM sur les pays
« n'ayant pas une économie de marché » :
« Article 32.10 : Accords de libre-échange
avec des pays n'ayant pas une économie de marché
« 1. Pour l'application du présent article :
un pays n'ayant pas une économie de marché est un pays qui, à la
fois : a) à la date de signature du présent accord, est considéré
par une Partie comme n'ayant pas une économie de marché aux fins de la
législation sur les recours commerciaux de la Partie en question, b)
n'a conclu d'accord de libre-échange avec aucune des Parties.
« 2. Sur demande, une Partie fournira autant de
renseignements que possible sur les objectifs des négociations.
« 3. Dès que possible, et au plus tard 30 jours
avant la date de signature, la Partie qui a l'intention de signer un
accord de libre-échange avec un pays n'ayant pas une économie de marché
donne aux autres Parties la possibilité d'examiner le texte intégral de
l'accord, y compris toute annexe et tout instrument accompagnant
celui-ci, afin que ces Parties puissent examiner l'accord et en évaluer
les incidences possibles sur le présent accord. Si la Partie concernée
demande que le texte soit traité comme confidentiel, les autres Parties
en préservent la confidentialité.
« 4. Si une Partie conclut un accord de libre-échange
avec un pays n'ayant pas une économie de marché, les autres Parties
pourront mettre fin au présent accord moyennant un préavis de six mois,
et remplacer le présent accord par un accord bilatéral entre elles.
« 5. L'accord bilatéral est constitué de toutes les
dispositions du présent accord à l'exception de celles dont les Parties
concernées conviennent qu'elles ne s'appliquent pas entre elles.
« 6. Les Parties concernées utilisent la période de
préavis de six mois pour examiner le présent accord et décider si des
amendements devaient y être apportés pour assurer le bon fonctionnement
de l'accord bilatéral.
« 7. L'accord bilatéral entre en vigueur 60 jours
après la date à laquelle la dernière partie à l'accord bilatéral ayant
accompli ses procédures juridiques applicables en a notifié l'autre
partie. »

Contestation de l'ordre du jour
antisocial du gouvernement de l'Ontario
- Mira Katz -
 Manifestation à Toronto le 18 janvier 2019
contre les coupures au Régime d'aide financière aux étudiants ontariens
et contre l'« Initiative de liberté de choix des étudiants » Manifestation à Toronto le 18 janvier 2019
contre les coupures au Régime d'aide financière aux étudiants ontariens
et contre l'« Initiative de liberté de choix des étudiants »
Le 21 novembre, les juges Sachs, Corbett et Favreau
de la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice de l'Ontario
se sont prononcés contre le « Student Choice Initiative (SCI) »
(Initiative de liberté de choix des étudiants) du gouvernement de
l'Ontario. Le SCI exige que les institutions d'enseignement
postsecondaire rendent optionnels certains frais d'adhésion aux
associations étudiantes et certains frais afférents pour les services
que fournissent les associations (i.e. les étudiants peuvent décider de
ne pas les payer), sous peine de se voir priver d'une partie des fonds
publics qui reviennent aux institutions. En même temps, le SCI définit
arbitrairement d'autres frais afférents étudiants comme obligatoires.[1] Les juges ont décidé que l'initiative
du gouvernement enfreint à la fois l'autonomie des universités et la Loi
sur
les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario et
va au-delà des pouvoirs de prérogative du gouvernement. Les poursuites
en justice contre le gouvernement ont été initiées par la Fédération
canadienne des étudiantes et étudiants et la Fédération des étudiants
de l'Université York. L'Association des étudiants des cycles supérieurs
de l'Université de Toronto est intervenue en faveur des associations
étudiantes, tandis que B'nai Brith Canada, un groupe de défense des
intérêts et « ardent défenseur de l'État d'Israël », est intervenu
en faveur des directives du gouvernement.
 Le gouvernement avait affirmé que le but
de son initiative, qui s'accompagnait d'une fausse réduction
de 10 % des frais de scolarité et de réductions des prêts aux
étudiants, était d'améliorer l'accessibilité financière et l'accès aux
universités et collèges publics. Il avait aussi dit que ses directives
étaient fondées sur des « décisions de politique majeure » prises
par le Cabinet et qu'elles « dépassent donc la portée de la compétence
du tribunal en matière d'examen ». Il avait également soutenu que
les directives avaient été prises en vertu du pouvoir de dépenser de la
Couronne et que le tribunal n'avait pas la compétence pour s'ingérer
dans les décisions de dépenser du gouvernement. Le gouvernement avait affirmé que le but
de son initiative, qui s'accompagnait d'une fausse réduction
de 10 % des frais de scolarité et de réductions des prêts aux
étudiants, était d'améliorer l'accessibilité financière et l'accès aux
universités et collèges publics. Il avait aussi dit que ses directives
étaient fondées sur des « décisions de politique majeure » prises
par le Cabinet et qu'elles « dépassent donc la portée de la compétence
du tribunal en matière d'examen ». Il avait également soutenu que
les directives avaient été prises en vertu du pouvoir de dépenser de la
Couronne et que le tribunal n'avait pas la compétence pour s'ingérer
dans les décisions de dépenser du gouvernement.
En ce qui concerne l'objectif du gouvernement, la cour a
noté la preuve soumise par les requérants sous forme d'une lettre de
collecte de fonds envoyée par le premier ministre à ses partisans, qui
déclarait :« Je pense que nous savons tous à quels genres
d'absurdités marxistes s'adonnent ces associations étudiantes. Alors,
nous avons corrigé cela. Les cotisations des associations étudiantes
sont désormais volontaires. » Cependant, dans sa décision, le
tribunal n'a pas traité du but visé par ces directives et s'est plutôt
demandé si elles faisaient partie des pouvoirs de prérogative du
gouvernement. Le tribunal « doit veiller à ce que le ministre ait le
pouvoir légal d'exiger des universités et des collèges qu'ils se
conforment aux directives », lit-on dans la décision.
Le tribunal a noté que la question dont il a été saisi «
est de savoir si le SCI et les directives respectent les limites du
pouvoir de dépenser de la Couronne ». La cour a souligné que «
l'un des défauts évidents [de l'argument du gouvernement selon lequel
la directive relève de son pouvoir de prérogative de pouvoir dépenser]
est que les montants [des frais afférents] en cause pour chaque
étudiant sont très faibles par rapport à l'ensemble des frais de
scolarité. De plus, la distinction entre les frais essentiels et non
essentiels semble arbitraire si l'objectif réel derrière le SCI et les
directives est de réduire la charge financière des étudiants : les
frais d'adhésion au centre d'éducation physique, qui sont environ dix
fois plus élevés que les frais d'adhésion à l'association étudiante,
sont jugés ‘essentiels', mais les frais d'adhésion à l'association
étudiante ne le sont pas : aucun fondement de principe pour faire
cette distinction n'a été offert dans le dossier dont nous sommes
saisis ou dans les plaidoiries. »
Le tribunal a également soulevé de sérieuses questions
sur ce que le gouvernement tentait de faire avec sa directive et les
causes futures dans lesquelles il pourrait faire face à des
contestations. « Cette affaire pourrait soulever une question légitime
concernant l'étendue du pouvoir de dépenser de la Couronne : les
conditions qui y sont rattachées peuvent-elles être sans pertinence ou
sans rapport avec l'objectif pour lequel le financement est
accordé ? Les conditions peuvent-elles aller jusqu'à nuire au
financement et aux activités de tierces parties, comme les associations
étudiantes dans cette cause, qui ne reçoivent aucun financement de
l'Ontario ? Cependant, cette question n'a pas été soulevée de
façon catégorique par les requérants ou traitée par l'Ontario, et il
semble qu'il y ait peu de jurisprudence sur l'étendue de la prérogative
de la Couronne de pouvoir dépenser. Nous notons qu'il n'y a aucun cas
comme celui-ci où un tribunal a examiné la question de savoir si la
Couronne a l'autorité d'utiliser son pouvoir de dépenser d'une manière
qui affecte l'autofinancement et les activités d'une tierce
partie. »
 Le tribunal souligne que la Loi sur
les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario
déclare spécifiquement que « la présente loi n'a pas pour effet
d'empêcher un conseil des étudiants d'un collège élu par les étudiants
du collège de mener ses activités normales et nul collège ne doit
empêcher le conseil de les mener. » La cour a souligné qu'en
obligeant les collèges à rendre les cotisations des associations
étudiantes volontaires, « le ministre ordonne aux collèges de prendre
des mesures qui empêcheront les conseils des étudiants de mener leurs
activités normales, ce que l'article 7 interdit
expressément ». Le tribunal souligne que la Loi sur
les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario
déclare spécifiquement que « la présente loi n'a pas pour effet
d'empêcher un conseil des étudiants d'un collège élu par les étudiants
du collège de mener ses activités normales et nul collège ne doit
empêcher le conseil de les mener. » La cour a souligné qu'en
obligeant les collèges à rendre les cotisations des associations
étudiantes volontaires, « le ministre ordonne aux collèges de prendre
des mesures qui empêcheront les conseils des étudiants de mener leurs
activités normales, ce que l'article 7 interdit
expressément ».
En ce qui concerne les universités, alors que chaque
université est régie par sa propre loi qui ne définit pas explicitement
le rôle des associations étudiantes, le tribunal a cité les décisions
des cours suprêmes confirmant l'autonomie des universités et des
témoignages d'experts sur l'histoire de l'autonomie des universités
canadiennes, et a statué que « les lois régissant les universités ‘ont
préséance' en matière de gouvernance universitaire, y compris les
activités étudiantes. Exiger que les universités permettent aux
étudiants de ne pas payer les frais d'adhésion aux associations
étudiantes et pour d'autres services « non essentiels » est
incompatible avec la gouvernance autonome des universités ».
Mis à part les arguments du gouvernement, le tribunal a
également pris note des arguments avancés par le seul intervenant dans
l'affaire du côté du gouvernement, B'nai Brith Canada. B'nai Brith a
plaidé en faveur de l'initiative du gouvernement, affirmant qu'elle
améliore « l'autonomie et le choix des étudiants individuels qui
peuvent ne pas être d'accord avec ou souhaitent appuyer leurs
associations étudiantes », ou ce que la cour a appelé « l'argument
de la liberté ». Le tribunal n'a pas entamé de débat sur la
validité des arguments de B'nai Brith, mais les a au contraire rejetés
sur la base qu'ils ne présentaient aucun élément de preuve au dossier à
l'appui de leurs allégations et que le groupe a présenté des éléments
de preuve qui n'ont pas été versés au dossier pour le tribunal, quelque
chose qu'aucun intervenant n'est autorisé à faire. La Cour a noté que
ledit argument de liberté était en conflit avec « le droit de mener une
action collective (qui peut être incluse dans la liberté
d'association) ».
En plus de statuer contre les directives du
gouvernement, le tribunal a ordonné au gouvernement de payer les
dépenses des requérants, pour un montant de 15 000 $.
Le gouvernement a l'intention d'en appeler de la
décision
Des reportages ont indiqué que le gouvernement Ford fera
appel de la décision en faisant valoir que sa directive n'est pas une
ingérence dans l'autonomie des universités ou des collèges, car les
établissements sont libres de décider d'appliquer ou non la directive
et, conséquemment, de décider si oui ou non leur financement public
sera réduit en n'appliquant pas la directive. Un mémoire du
gouvernement déposé auprès de la Cour d'appel se lisait comme
suit : « Les universités restent libres d'exercer leur
indépendance et leur autonomie en choisissant d'accepter un financement
public, sous réserve des conditions qui y sont rattachées. Rattacher
des conditions aux subventions gouvernementales n'interfère d'aucune
façon dans l'autonomie et l'indépendance des universités. »[2]
Notes
1. Canadian
Federation
of
Students v. Ontario, 2019
ONSC
6658
2. Voir l'article du Charlatan ici.

- Enver Villamizar -
 La lettre de levée de fonds du premier
ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui cible les activités politiques
des associations étudiantes, montre que l'objectif que le gouvernement
de l'Ontario s'est donné est de menacer et d'essayer de réduire au
silence toute dissidence collective des jeunes des collèges et des
universités et de violer leur droit de conscience. Cela se produit au
moment où le gouvernement mène une attaque tous azimuts contre les
services publics comme l'éducation et les programmes sociaux, dont les
jeunes ont besoin. L'intervention de B'nai Brith en appui à l'«
Initiative de la liberté de choix des étudiants » (SCI) du gouvernement
Ford, dans la poursuite intentée contre le SCI par la Fédération
canadienne des étudiantes et étudiants et la Fédération des étudiants
de l'Université York devant la Cour de justice de l'Ontario, montre que
l'ordre du jour du gouvernement ontarien est lié directement aux
tentatives de faire taire les jeunes Canadiens qui veulent que le
Canada s'oppose à l'occupation israélienne de la Palestine. Ces
développements cadrent bien avec les attaques similaires inacceptables
qui ont lieu en Alberta, où le premier ministre Jason Kenney a fait des
allégations à caractère diffamatoire au sujet des opinions politiques
d'un chargé de cours et syndicaliste bien connu de l'Université de
l'Alberta, Dougal MacDonald, un enseignant à la faculté d'éducation de
l'université. La lettre de levée de fonds du premier
ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui cible les activités politiques
des associations étudiantes, montre que l'objectif que le gouvernement
de l'Ontario s'est donné est de menacer et d'essayer de réduire au
silence toute dissidence collective des jeunes des collèges et des
universités et de violer leur droit de conscience. Cela se produit au
moment où le gouvernement mène une attaque tous azimuts contre les
services publics comme l'éducation et les programmes sociaux, dont les
jeunes ont besoin. L'intervention de B'nai Brith en appui à l'«
Initiative de la liberté de choix des étudiants » (SCI) du gouvernement
Ford, dans la poursuite intentée contre le SCI par la Fédération
canadienne des étudiantes et étudiants et la Fédération des étudiants
de l'Université York devant la Cour de justice de l'Ontario, montre que
l'ordre du jour du gouvernement ontarien est lié directement aux
tentatives de faire taire les jeunes Canadiens qui veulent que le
Canada s'oppose à l'occupation israélienne de la Palestine. Ces
développements cadrent bien avec les attaques similaires inacceptables
qui ont lieu en Alberta, où le premier ministre Jason Kenney a fait des
allégations à caractère diffamatoire au sujet des opinions politiques
d'un chargé de cours et syndicaliste bien connu de l'Université de
l'Alberta, Dougal MacDonald, un enseignant à la faculté d'éducation de
l'université.
Les universités sont des lieux où les jeunes et les professeurs
s'organisent pour enquêter et exprimer leurs points de vue sur toutes
les questions importantes, y compris celles liées au rôle du Canada
dans le monde et les questions sérieuses de la guerre et de la paix. Ce
n'est pas une coïncidence si le gouvernement Harper puis le
gouvernement Trudeau au niveau fédéral ont par exemple soutenu que les
jeunes et les étudiants ne devraient pas être autorisés à défendre
ouvertement les droits humains des Palestiniens en utilisant leur
parole pour plaider en faveur d'une campagne de boycott, de
désinvestissement et de sanctions pour faire pression sur Israël afin
qu'il mette fin à son occupation de la Palestine. Un référendum adopté
par une majorité d'étudiants qui ont voté en 2014 à l'Université de
Windsor pour que leur association étudiante se désinvestisse « des
entreprises qui soutiennent ou profitent des crimes de guerre, de
l'occupation et de l'oppression israéliens » a été dénoncé au Parlement
par le gouvernement Harper. Suite à cela et aux menaces d'un riche
donateur de retirer son financement à l'université, l'Université de
Windsor a coupé les fonds à l'association étudiante. Lors de son
élection en 2015, le gouvernement Trudeau a également condamné
officiellement le mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions
comme une forme d'antisémitisme et a clairement indiqué qu'il ne
voulait pas que les jeunes expriment leur point de vue à ce sujet sur
les campus universitaires et collégiaux.
 Les arguments maintenant avancés par
B'nai Brith qui affirme que l'adhésion obligatoire à des associations
étudiantes viole les droits individuels des étudiants qui ne sont pas
d'accord avec leurs actions montrent que, comme le gouvernement Ford,
il veut briser les organisations de défense collective des étudiants au
nom des droits individuels. En tant que « fidèle allié » autoproclamé «
d'Israël », le B'nai Brith soutient-il l'initiative du
gouvernement Ford pour essayer de faire taire les étudiants ou du moins
interférer avec la capacité des étudiants à s'organiser collectivement
contre l'occupation israélienne de la Palestine ? Si c'est le cas, cela
ne révèle-t-il pas le caractère antidémocratique de l'initiative ? Ce
n'est pas un hasard si les arguments de B'nai Brith sont en fait les
mêmes que ceux avancés par le gouvernement Ford, que le paiement des
cotisations aux associations étudiantes devrait être une question de «
choix ». Les arguments maintenant avancés par
B'nai Brith qui affirme que l'adhésion obligatoire à des associations
étudiantes viole les droits individuels des étudiants qui ne sont pas
d'accord avec leurs actions montrent que, comme le gouvernement Ford,
il veut briser les organisations de défense collective des étudiants au
nom des droits individuels. En tant que « fidèle allié » autoproclamé «
d'Israël », le B'nai Brith soutient-il l'initiative du
gouvernement Ford pour essayer de faire taire les étudiants ou du moins
interférer avec la capacité des étudiants à s'organiser collectivement
contre l'occupation israélienne de la Palestine ? Si c'est le cas, cela
ne révèle-t-il pas le caractère antidémocratique de l'initiative ? Ce
n'est pas un hasard si les arguments de B'nai Brith sont en fait les
mêmes que ceux avancés par le gouvernement Ford, que le paiement des
cotisations aux associations étudiantes devrait être une question de «
choix ».
De même, au nom de la liberté individuelle, du choix et même de la
liberté, le gouvernement Ford et ceux qui appuient ses actions tentent
de réprimer l'organisation des jeunes et de tous ceux qui résistent à
ses attaques contre les services publics et les programmes sociaux, et
qui défendent le principe selon lequel la société a une responsabilité
envers ses membres que les gouvernements ont le devoir de remplir. Ils
ciblent pour diffamation ceux qui résistent - comme les syndicats
ouvriers et les associations étudiantes et les champions des opprimés -
insinuant qu'ils sont des chefs mafieux, des criminels ou des «
antisémites » selon les circonstances, pour tenter de nier la justesse
de leur cause. Le but est de dissimuler le véritable objectif du
gouvernement qui est de faire taire ceux qui refusent d'accepter les
violations organisées par l'État du droit à la conscience, à la liberté
de parole et à la liberté d'association. Il est important de s'opposer
aux objectifs de l'Initiative de la liberté de choix des étudiants du
gouvernement, et pas seulement en fonction de sa légalité ou non. Elle
doit être déclarée illégale car elle est injuste et viole les droits !

L'affaire de la diffamation de Dougal
MacDonald,
chargé de cours à l'Université de l'Alberta
L'article « Menace à la liberté académique » a été
écrit en 1953 par Charles Herbert Huestis, arrière-grand-père du Dr
Dougal MacDonald, et est reproduit avec la permission de la famille.
Divers adptes de l'affirmation que la famine en Ukraine
en 1932-1933 a été provoquée artificiellement par le dirigeant
soviétique Joseph Staline exigent le licenciement du Dr MacDonald qui
enseigne à l'Université de l'Alberta. Ils affirment que même si son
point de vue sur le soi-disant Holodomor n'a pas été présenté durant
ses cours, il est à l'origine d'un traumatisme transgénérationnel et sa
présence à l'université constitue une menace. Non seulement cette prise
de position contrevient-elle de manière flagrante à la nécessité de
garantir la liberté de parole dans la société et en particulier dans un
milieu universitaire où l'investigation scientifique et la parole sont
essentielles à l'apprentissage, mais elle fait aussi la promotion d'une
idéologie officielle à laquelle tout le monde est censé se conformer
sous prétexte qu'il n'y a pas de faits alternatifs. Cela ne correspond
à aucune notion de démocratie.
La vraie question est de s'élever au-dessus de
l'avilissement du discours politique qui prétend défendre les droits
mais qui interdit ce que les forces de l'offensive antisociale
appellent le discours haineux. La bataille n'est pas seulement pour la
démocratie à un moment où même les libertés démocratiques les plus
élémentaires sont retirées au nom d'idéaux élevés. La lutte pour
utiliser sa parole comme expression de sa conscience fait également
partie intégrante de la bataille de la démocratie - la bataille par
laquelle le peuple prend en main ses affaires en affirmant ses droits
d'une manière qui oblige ceux qui agissent en toute impunité à rendre
des comptes. Le droit d'utiliser sa parole est un droit humain. Sans
lui, personne ne peut délibérer sur la direction de l'économie et les
autres affaires importantes qui touchent la vie des gens et la société,
comme celles relatives au crime et au châtiment, à la guerre et à la
paix, au rôle des idéologies et ainsi de suite.
L'article « Threat to Academic Freedom » (Menace à
la liberté académique) a été originellement publié dans l'édition
du 3 septembre 1953 du Toronto Star.
***
La vague d'anticommunisme qui a déferlé sur les
États-Unis est l'un des phénomènes sociaux les plus étonnants des temps
modernes. Le président [Dwight D. Eisenhower] a déclaré il y a peu de
temps qu'elle reculait mais elle a pris de l'ampleur.
L'autre jour, le New Republic publiait une
caricature d'un personnage recouvert d'une capuche et drapé de noir
intitulée « Peur », qui brandissait un fouet devant lequel l'oncle
Sam terrorisé se terrait. Pendant quelques années, les singeries du
Comité de la Chambre sur les activités antiaméricaines ont été vues
avec un certain amusement, mais ce n'est plus le cas. D'éminents
scientifiques ont été amenés devant lui et forcés de répondre à des
questions qui indiquent l'ignorance des inquisiteurs. Le comité de
l'énergie atomique a lui aussi fait preuve d'un manque d'intelligence.
Leonard Engel, qui écrit occasionnellement dans The Nation sur
les progrès de la science, a dit : « Dans un cas que je connais,
un ingénieur respecté affilié à une grande université a été jugé
inadmissible à l'accès à des documents secrets sur la seule accusation
qu'il avait appuyé Henry Wallace [du Parti progressiste] lors des
dernières élections. »
Maintenant, l'inquisition pénètre les écoles publiques
et les universités. Le Comité de la Chambre sur les activités
antiaméricaines a exigé que tous les manuels scolaires leur soient
soumis pour la recherche de matériel subversif. Selon le rapport du
comité des scientifiques sur les problèmes liés à l'allégeance, la
sécurité affecte désormais la moitié de tous les scientifiques
américains dans des domaines comme la physique et une proportion
croissante dans d'autres domaines des sciences. Elle s'est maintenant
étendue aux campus : plusieurs départements de l'Université de la
Californie, explique Engel, qui exige également un serment
d'allégeance, font des autorisations de sécurité une exigence pour tout
le monde, quel que soit la nature ou le parrainage de son travail.
Le conseil scolaire de Cleveland, en Ohio, a récemment
exigé un serment d'allégeance à tous ses enseignants des écoles
publiques et le journal Plain Dealer a publié une photo de
l'assermentation. CW Lawrence, commentateur du matin au Plain
Dealer, a écrit à son éditeur : « Il me semble que cette image
symbolise ce qui s'est passé dans notre pays au cours des derniers mois
- un affaiblissement de notre caractère national, une détérioration de
notre confiance en soi nationale, une perte de notre sens de l'humour,
le tout étant le résultat d'une grande crainte irraisonnée d'une nation
bien plus faible, à la fois physiquement et idéologiquement, que la
nôtre. » En effet, les Américains singent la conduite même qu'ils
condamnent en Russie. Lorsque la bombe atomique a explosé à Los Alamos,
un éminent américain a déclaré : « C'est la fin de la
démocratie. » Il voulait dire bien sûr que la militarisation, le
secret et le contrôle de la pensée seraient étendus jusqu'à ce que les
peuples qui se gouvernent perdent le pouvoir de façonner leur propre
existence.
Un incident d'intolérance très médiatisé dans les
universités s'est produit il n'y a pas longtemps à l'Université de
Washington. Le professeur Henry Steele Commager du département
d'histoire de l'Université de Columbia a écrit à ce sujet dans le New
Republic du 25 juillet sous le titre « Red Baiting in the
Colleges » (la chasse aux communistes dans les collèges).
L'assemblée législative de l'État de Washington avait décrété qu'aucun
salaire ne devait être versé à un employé de l'État qui était membre
d'une organisation qui « prône le renversement du gouvernement des
États-Unis par la force ou la violence », formule utilisée pour
désigner les communistes, car le Parti communiste est aussi légal aux
États-Unis que le républicain ou le démocrate.
Un ratissage de la faculté a exposé six membres qui
pourraient être inclus dans cette formule, trois d'entre eux présumés
membres actuels et trois anciens membres du parti. Le comité de faculté
était enclin à l'indulgence, mais pas le président, R.B. Allen. Il
soutenait que l'appartenance au PC constitue en soi une preuve
d'inaptitude et d'incompétence, et que la dissimulation de cette
appartenance rend l'infraction doublement odieuse. Le professeur
Commager écrit : « Aucun exemple n'a encore été produit où un
communiste d'une faculté universitaire a effectivement fait du tort à
des étudiants ou à la recherche scientifique. L'hypothèse qu'un
communiste trompera fatalement les étudiants est basée sur l'hypothèse
tout à fait inexplorée que les collégiens seraient des imbéciles. »
Et cela m'amène à mon propos. Récemment, le professeur
George Hunter, chef du département de biochimie de l'université de
l'Alberta, a été sommairement congédié par le conseil des gouverneurs
après 20 ans de brillants services. Le Dr Hunter n'est pas, je
crois, membre du Parti ouvrier progressiste, mais il est profondément
sympathique à la philosophie communiste et a dirigé un conseil de paix
à Edmonton cette année. Le président de l'université a fait une
déclaration à la presse dans laquelle il affirme que les opinions
politiques du Dr Hunter ont été prises en considération par le conseil
d'administration. « Ses opinions politiques, a déclaré le président,
n'étaient pas la cause directe de son limogeage. Celui-ci est la
culmination de plusieurs années d'insatisfaction. Le conseil
d'administration a dû prendre note des plaintes répétées des étudiants
qui disaient que le Dr Hunter utilisait sa classe pour propager ses
opinions politiques. Au lieu d'un préavis, le Dr Hunter a reçu
plusieurs mois de salaire du conseil d'administration. »
Toutes les tentatives d'obtenir davantage d'information
du chancelier et du président sur la question ont été vaines. Le
docteur Hunter, dans une déclaration aux médias, a dit qu'aucune raison
n'avait été donnée par le conseil d'administration pour expliquer son
congédiement. Quant à l'affirmation du président à l'effet qu'il se
servait de sa salle de cours pour propager ses opinions politiques, il
le nie catégoriquement. Il a dit aux médias qu'à la fin de ses cours de
la session d'hiver le 7 avril, ayant terminé ses cours à 11
h 30, pendant le quart d'heure qui a suivi, il a partagé ses
opinions sur les évènements mondiaux contemporains, après quoi 17
étudiants sur une classe de 257 étudiants ont signé une pétition
qui a été remise au conseil d'administration. De tels étudiants n'ont
pas la capacité émotionnelle de raffermir des jugements sur des
questions controversées et il est peu probable qu'ils aient la
formation intellectuelle requise pour compléter des études
universitaires supérieures.
Il y a quelques années, un groupe d'étudiants de
l'Université de Toronto avaient invité Tim Buck [secrétaire général du
Parti communiste] et certains avaient contesté la décision auprès du
président, le docteur Coy. Celui-ci avait répondu que les étudiants de
niveau universitaire sont censés avoir l'intelligence d'un adulte et
doivent par conséquent être en mesure de forger leur propre opinion
puisqu'on ne les empêcherait pas d'entendre les deux côtés.
Jusqu'à maintenant, mis à part certaines sections des
médias et, visiblement, la province de Québec et le chef du Parti
progressiste-conservateur, le Canada est relativement libre d'hystérie
anticommuniste. C'est déplorable qu'elle se manifeste dans une
université ayant une fière tradition universitaire telle qu'établie par
H. M. Tory et R.C. Wallace, ses premiers présidents.
L'éditeur de Saturday Night, commentant
l'incident, a écrit : « Lorsque le conseil d'administration d'une
université pose un geste aussi grave que de congédier un professeur
d'université de 53 ans ayant 30 ans de service méritoire dans
sa science, il lui doit, à lui, au public et aux principes de liberté
académique, d'expliquer clairement et avec la plus grande franchise le
fondement de ses actions. C'est, comme je l'ai dit plus haut, ce que
les gouverneurs refusent de faire. »
(Traduit de l'anglais par LML)

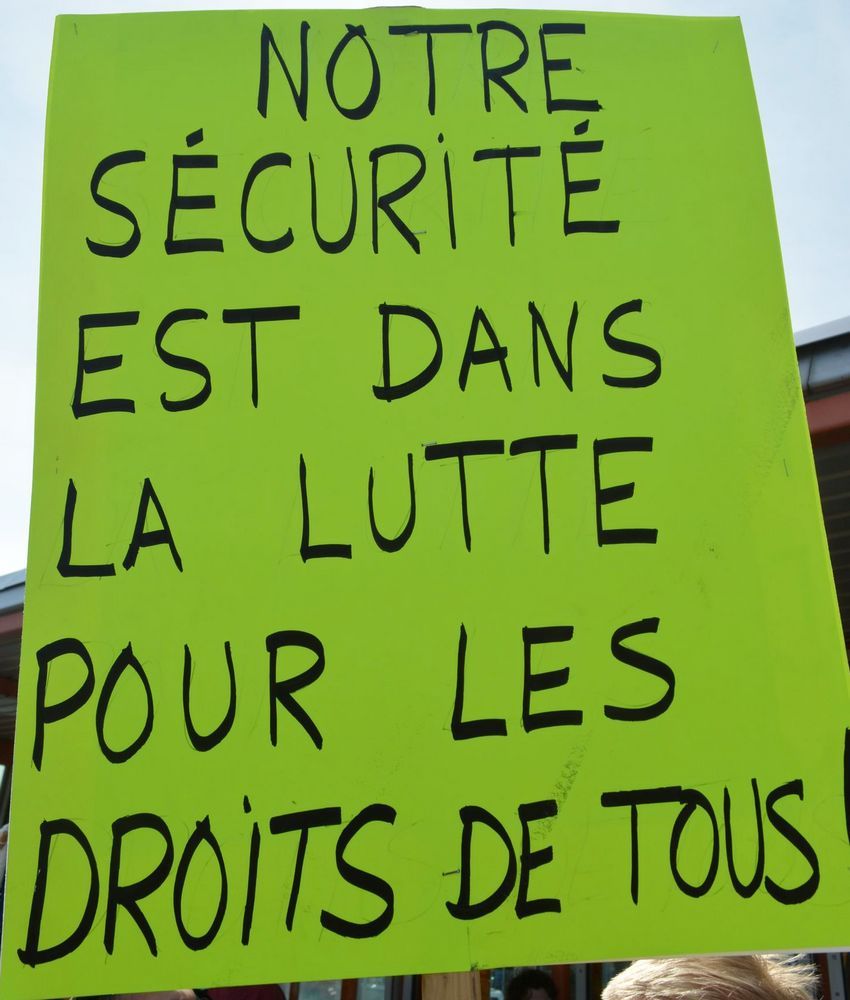 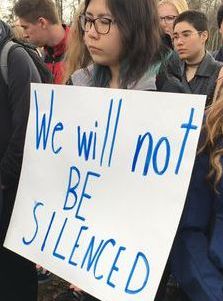 
Déclaration du président de l'Association du personnel
universitaire
de l'Université de l'Alberta
Chers membres,
Il a été annoncé dans les nouvelles récemment que Dougal
MacDonald, un chargé de cours à l'Université de l'Alberta, aurait
publié des commentaires sur sa page privée de Facebook, commentaires
qui ont été regardés à la loupe. Les commentaires de Dougal MacDonald
lui appartiennent et ne sont aucunement liés à ses activités
professionnelles à l'Université de l'Alberta. La vice-rectrice
principale de l'université, Wendy Rodgers, a dit dans un message
courriel :
« En tant que simple citoyen, M. MacDonald a le droit
d'exprimer son opinion, et d'autres ont le droit de le critiquer ou de
débattre de cette opinion », a-t-elle dit. « Nous croyons comprendre
qu'il n'a pas exprimé ces opinions dans le cadre de sa relation
d'employé avec l'université. »
En effet, en tant que simple citoyen, Dougal MacDonald
jouit de la liberté d'expression, qui est protégée dans la Charte des
droits et des libertés. La liberté d'expression assure aussi une
protection au droit, tel que mentionné plus haut, à la critique ou au
débat des opinions émises par un simple citoyen tel que Dougal
MacDonald, ce que l'Association étudiante de l'université a fait.
Cependant, l'Association étudiante a aussi exigé que Dougal MacDonald
retire ses commentaires ou qu'il démissionne. L'exigence imposée par
l'association pourrait être interprétée comme étant une pression visant
à une autocensure rétroactive, ce qui contrevient aux principes de la
liberté d'expression. L'autre volet de la proposition de l'association,
c'est-à-dire, faute de rétraction, la démission, n'est pas plus
approprié, puisque cette exigence est en lien avec les commentaires
émis par Dougal MacDonald à titre de simple citoyen.
Kevin Kane
(1er décembre 2019)
Pétition du corps professoral de l'Université de
l'Alberta
Akanksha Bhatnagar
Présidente, Association des étudiants de l'Université de l'Alberta
[...]
Chère Akanksha,
Nous sommes très préoccupés par la déclaration de
l'Association étudiante de l'Université de l'Alberta concernant le
docteur Dougal MacDonald, qui enseigne à la faculté de l'Éducation.
Votre condamnation des commentaires du docteur MacDonald
sur l'Holomodor et l'exigence qu'il les retire ou qu'il démissionne
sont non conformes aux politiques et aux principes de l'Université sur
la liberté d'expression. Cette semaine, le conseil général du corps
enseignant a approuvé la nouvelle déclaration de l'université sur la
liberté d'expression qui se lit comme suit :
« L'université est un endroit de recherche libre et
ouverte sur toutes les questions, et tous les membres de la communauté
universitaire ont la plus grande latitude possible lorsqu'il s'agit de
parler, écrire, écouter, regarder, contester, promouvoir et apprendre.
Les membres de la communauté universitaire ont le droit de critiquer et
de remettre en cause d'autres opinions défendues sur nos campus, mais
n'ont pas le droit d'entraver ou de faire obstacle d'aucune façon à la
liberté d'expression des autres. Le débat et la délibération ne doivent
pas être supprimés parce que les idées défendues sont perçues par
certains, ou par plusieurs, comme étant injurieux, malavisés, immoraux
ou erronés. Il relève des individus, et non des institutions, de
formuler ces jugements de façon personnelle et d'agir non pas en
tentant de supprimer l'expression, mais en contestant ouvertement et
résolument les idées qu'ils contestent. L'université ne cherche pas à
protéger la communauté universitaire contre des idées ou des opinions
avec lesquelles elle n'est pas d'accord ou qu'elle considère
offensantes. »
Les commentaires du docteur MacDonald sont protégés par
notre Charte des droits et libertés et par la liberté
d'expression académique extramuros, un droit nécessaire pour tout le
personnel professoral de l'université. Comme l'indique la déclaration,
à l'université, la réaction que l'on doit avoir face aux idées avec
lesquelles nous ne sommes pas d'accord est d'en débattre farouchement
et non de les supprimer.
L'environnement propice à l'apprentissage n'est pas,
comme il est sous-entendu dans votre déclaration, « sécuritaire »
lorsqu'un individu ou un groupe tente d'empêcher un autre individu ou
groupe d'exercer sa liberté d'expression. Au contraire, il est par le
fait même profondément discrédité, puisque la capacité d'examiner,
d'analyser et de critiquer toutes les idées est la pierre angulaire de
l'université.
Voir la liste
de
signataires
(2 décembre 2019. Traduction:
LML)
Lettre ouverte de la Société pour la liberté académique
et universitaire au président de l'université
Cher président Turpin,
Je vous écris en tant que président de la Société de
liberté académique et universitaire (SLAU), une organisation de membres
du personnel universitaire et d'autres qui se consacrent à la défense
de la liberté académique et du principe du mérite de l'enseignement
supérieur. (Pour de plus amples informations, prière de visiter notre
site web à www.safs.ca.)
Le chargé de cours en Éducation Dougal MacDonald a été
sévèrement critiqué par des membres de la communauté de l'Université de
l'Alberta (et d'autres) pour des commentaires qu'il aurait émis en
novembre au sujet de l'Holodomor. Certains ont proposé que l'Université
de l'Alberta réprimande ou congédie M. MacDonald. La Société de liberté
académique et universitaire félicite l'Université de l'Alberta pour la
teneur de ses réponses aux plaintes reçues. D'abord, l'Université de
l'Alberta a rejeté les requêtes que M. MacDonald soit sanctionné.
Aussi, l'Université de l'Alberta compte réunir des chercheurs dans un
avenir proche pour discuter de l'Holodomor publiquement.
Néanmoins, deux éléments de la réponse de l'Université
de l'Alberta aux plaintes ne semblent pas conformes à l'engagement
déclaré de l'université à la défense de la liberté académique et la
liberté d'expression sur le campus.
Le premier est le fait que l'université persiste à dire
que M. MacDonald a parlé de l'Holodomor en tant que simple citoyen et
non en tant qu'universitaire. Wendy Rogers, vice-rectrice de
l'Université de l'Alberta, par exemple, au nom de l'université, aurait
dit : « À notre avis, il n'a pas exprimé son opinion dans le cadre
de sa relation d'emploi avec l'université. »
Parce qu'il est un universitaire, M. MacDonald jouit de
la liberté d'expression extramuros. L'Université de l'Alberta ne fait
pas que respecter sa liberté d'expression en vertu de la Charte
canadienne des droits et libertés. L'université a l'obligation, mis
à part la Charte et simplement en tant qu'institution académique, de
protéger et d'entretenir les propos extramuros.
Aussi, dans ses commentaires, la docteure Rodgers semble
dire que si M. MacDonald avait émis ses propos au sujet de l'Holodomor
en tant que professeur de l'Université de l'Alberta, en tant
qu'enseignant, chercheur ou dans une fonction de service, l'Université
de l'Alberta aurait été dans son droit de le réprimander ou de le
sanctionner. M. MacDonald jouit de la liberté académique, et un aspect
important de la liberté académique est la liberté de discussion peu
importe le contexte académique. On ne pouvait discipliner M. MacDonald
en raison de ses opinions exprimées dans un contexte académique pas
plus que sur Facebook ou ailleurs.
Le deuxième est le désir de l'université de participer à
la discussion sur l'Holodomor et de défendre une position officielle de
l'université sur un événement historique. Ceci est évident dans la
déclaration commune des doyens en Arts et Éducation. Les doyens
écrivent qu'ils « affirment catégoriquement que ceci [que l'Holodomor
est un ‘mythe' inventé par les nazis hitlériens pour discréditer
l'Union soviétique] n'est pas vrai. » Ce désir est aussi présent
dans votre propre déclaration, écrite avec trois autres, sous le
titre : « Alerter l'opinion publique au sujet de
l'Holodomor » : « Ses opinions ne représentent pas
l'Université de l'Alberta et ne sont pas appuyées par elle. ».
Ce désir est contraire à la déclaration sur la Liberté d'expression qui
a été approuvée récemment par le conseil général du personnel
enseignant de l'Université de l'Alberta :
« Ce sont les individus et non les institutions qui
doivent porter ces jugements sur une base personnelle et agir non pas
en tentant de supprimer l'expression mais en contestant ouvertement et
rigoureusement les idées avec lesquelles ils ne sont pas
d'accord. »
Le principe que les universités elles-mêmes ne prennent
pas position sur des questions de fond est un principe important et
sage. Il fait en sorte que les universitaires ne souffrent pas des
pressions exercées pour qu'elles se conforment à une ligne de parti. Ce
faisant, il préserve la confiance du public dans la recherche qui a
lieu à l'université.
Nous demandons respectueusement que vous répondiez à
notre lettre. Avec votre permission, nous publierons votre réponse
ainsi que cette lettre sur notre site web.
Sincèrement,
Mark Mercer, PhD
Président, Société pour la liberté académique et universitaire (SLAU)
(10 décembre 2019. Traduction et
photos : LML)

Journée nationale de commémoration et
d'action contre la violence faite aux femmes
- Christine Dandenault -

Le 6 décembre marquait le 30e anniversaire de
la tuerie de l'École polytechnique, un des événements les plus
tragiques qui ait frappé la société québécoise et canadienne. Le 6
décembre 1989, un individu ouvrait le feu sur vingt-huit
personnes, tuant quatorze femmes et blessant dix femmes et quatre
hommes, avant de se suicider. Au moins quatre personnes se sont
suicidées à la suite de ce drame.
Des milliers de femmes et leurs organisations réitèrent
en cette occasion leur ordre du jour pour l'élimination de la violence
contre les femmes et pour une autorité publique qui prend
responsabilité sociale et garantit les droits de toutes et tous.
Les 12 jours d'action contre la violence ont été lancés au Québec
le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes, de même que les 16 jours d'action à
l'échelle internationale du 25 novembre au 10 décembre.
La gouvernance néolibérale au Canada fait beaucoup
d'efforts pour s'assurer que ce mouvement demeure dans les limites
d'une opposition « raisonnable », « comportementale », qui ne
s'adresse pas à la direction violente et antisociale de l'économie. Le
premier ministre Justin Trudeau l'a exprimé encore clairement
le 25 novembre en disant : « Aujourd'hui, au premier
des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe,
j'invite les Canadiens à réfléchir à ce que nous pouvons tous faire,
que ce soit par des gestes ou des paroles, pour mettre fin à la
violence fondée sur le sexe et créer un avenir meilleur pour tout le
monde. » C'est l'hypocrisie libérale dans sa plus pure expression
et une insulte à l'endroit des femmes.
 La litanie des bons ou mauvais
comportements du gouvernement illustre l'hypocrisie de ceux qui, à tous
les jours, s'attaquent à la dignité des femmes, à leurs conditions de
travail et de vie. La politique antisociale des gouvernements n'est pas
un problème de comportement, tout comme la politique étrangère
d'ingérence et d'agression, la politique raciste et coloniale à
l'endroit des femmes des Premières Nations et de leur communauté. La
violence contre les femmes et les enfants est intimement liée la
direction antisociale et guerrière de la société et à la destruction
aujourd'hui des arrangements et institutions qui ne fonctionnent plus. La litanie des bons ou mauvais
comportements du gouvernement illustre l'hypocrisie de ceux qui, à tous
les jours, s'attaquent à la dignité des femmes, à leurs conditions de
travail et de vie. La politique antisociale des gouvernements n'est pas
un problème de comportement, tout comme la politique étrangère
d'ingérence et d'agression, la politique raciste et coloniale à
l'endroit des femmes des Premières Nations et de leur communauté. La
violence contre les femmes et les enfants est intimement liée la
direction antisociale et guerrière de la société et à la destruction
aujourd'hui des arrangements et institutions qui ne fonctionnent plus.
Le mouvement des femmes et sa conscience sont beaucoup
plus avancés que ce qu'exprime le gouvernement Trudeau. Elles veulent
décider, humaniser la société. Les demandes des femmes s'adressent à
ces arrangements lorsqu'elles revendiquent des investissements massifs
en santé, en éducation et dans les programmes sociaux, dans les
organismes de défense des droits des femmes, les maisons d'hébergement.
Les femmes autochtones pour mettre fin à la violence permanente subie
par les femmes et les membres des Premières Nations, dont plus
de 1300 femmes disparues et assassinées. Depuis le début de
l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues
et assassinées, le 1er septembre 2016, il y a eu plus
de 130 cas de femmes et de filles autochtones soit assassinées,
soit mortes dans des circonstances considérées comme suspectes. Elles
luttent depuis près de 200 ans pour leurs droits ancestraux, leur
droit d'être, niés à un point tel que le Canada est interpellé par
l'ONU pour mettre fin à son héritage colonial et pour s'attaquer aux
sources du problème. Il faut parler également des femmes musulmanes qui
sont ciblées tout particulièrement par la Loi 21 du gouvernement
Legault. Les femmes ne veulent pas simplement diminuer la violence,
elles veulent l'éliminer et elles refusent que la chose soit réduite à
une histoire de comportement.
  
Une commémoration a eu lieu à Montréal le 6 décembre à l'occasion du
30e anniversaire de la tragédie de l'École Polytechnique, à la
Place-du-6-décembre-1989, à l'intersection du Chemin de la Reine-Marie
et de la rue Bégin, pour rendre hommage aux 14 jeunes femmes tuées:
Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara
Daigneault, Anne-Marie Edward, Maude Haviernick, Barbara
Klucznik-Widajewicz, Maryse Laganière, Maryse Leclair, Anne-Marie
Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault et Annie
Turcotte.
La politique étrangère canadienne est empreinte
d'agressions commises au nom de nobles idéaux. L'appui du Canada au
gouvernement répressif et corrompu d'Haïti, son ingérence dans les
affaires internes du Venezuela, son appui à la déstabilisation
politique en Bolivie et son refus de condamner la répression à grande
échelle au Chili sont tous des « gestes ou des paroles » qui
permettent les pires violences contre des femmes.
La lutte menée par les femmes et filles pour affirmer
leurs droits et contre toutes formes de violence contre elles est
courageuse, héroïque, inspirante. Elle est héroïque et courageuse car
menée dans le contexte d'une dégénérescence politique, sociale,
culturelle et économique de la société. Cette dégénérescence atteint un
niveau tel que la violence, loin de diminuer, prend des proportions
sans précédent dans toutes les sphères de la société et l'empêche
d'avancer.
Dans ces conditions, c'est tout à l'honneur des femmes,
en ce 30e anniversaire de la tuerie de Polytechnique, de réitérer
leur demande pour l'élimination de toute violence faite aux femmes et
aux enfants. C'est tout à leur honneur d'exiger la fin de la violence
sous toutes ces formes. L'humanisation de l'environnement naturel et
social de la société est à l'ordre du jour plus que jamais.
 
À l'Université de la Colombie-Britannique le 6 décembre 2019


La Marche des papillons pour l'élimination de la violence contre les
femmes à Santo Domingo, République dominicaine, le 24 novembre 2019
Le 17 décembre 1999, l'ONU a proclamé
le 25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes. Cette année marque donc le 20e
anniversaire de cette journée qui est le point de départ d'une campagne
de 16 jours d'actions à l'échelle internationale pour mettre fin
aux violences contre les femmes.

Des marcheuses portent la photo des soeurs
Mirabal à la Marche des papillons 2019.
|
Cette date a été choisie pour honorer la mémoire de
Minerva, Patria et Maria Teresa Mirabal, trois jeunes femmes de la
République dominicaine assassinées le 25 novembre 1960. Les
trois soeurs étaient d'actives militantes et organisatrices contre la
dictature sanglante de Rafael Trujillo. Ce dernier, installé au pouvoir
grâce aux États-Unis en 1930, est reconnu pour la persécution et
l'assassinat des personnes ou collectifs qui s'opposaient à sa
gouvernance. Il est aussi connu pour avoir commandé l'exécution de
dizaines de milliers d'Haïtiens qui travaillaient en République
dominicaine en 1937. Les soeurs Mirabal et leurs époux mobilisaient et
organisaient pour tenter de renverser la dictature. Le 25
novembre 1960, alors qu'elles-mêmes venaient d'être libérées de
prison et qu'elles revenaient de visiter leurs époux eux aussi
incarcérés, leur voiture fut interceptée et les occupantes et leur
chauffeur furent battus à mort. Les corps furent remis ensuite dans la
voiture qu'on poussa dans un ravin pour faire croire à un accident de
la route.

Photo des soeurs Mirabal en 1960
Le 25 novembre est une journée qui illustre la
violence de l'État envers les femmes qui luttent pour leurs droits.
En 1993, l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa
Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes,
définissait ainsi la violence envers les femmes :
« Aux fins de la présente Déclaration, les termes
‘violence à l'égard des femmes' désignent tous actes de violence
dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes
un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques,
y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation
arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie
privée. »
L'article 2 de la déclaration précise que ces
violences contre les femmes peuvent être exercées par la famille, par
la collectivité (milieu de travail, lieu d'enseignement, etc.) et par
l'État.
Depuis 10 ans, la Journée internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard des femmes est suivie d'une
campagne d'actions de 16 jours qui se clôt le 10 décembre,
Journée internationale des droits de la personne. Au Québec, la
campagne dure 12 jours pour se clore le 6 décembre, pour
commémorer la mémoire de 14 jeunes étudiantes de l'École
polytechnique de Montréal, assassinées en 1989 parce qu'elles
étaient des femmes. Depuis 1991, partout au Canada, la journée
du 6 décembre est la Journée nationale de commémoration et
d'action contre la violence faite aux femmes. Cette année marque
le 30e anniversaire de cette tragédie et les femmes et leurs
organisations font le bilan des avances qu'elles ont faites.
Au Québec, les 12 jours sont marqués par plus d'une
cinquantaine d'actions qui sont organisées de Gatineau à Mont-Joli. Par
des films, des discussions, des pièces de théâtre, des séances à micro
ouvert, des marches et des vigiles, les femmes s'adressent aux formes
d'abus dont elles sont victimes : migrantes emprisonnées, violence
envers les femmes en situation de handicap, violence en milieu de
travail, à la maison, racisme et pauvreté, la violence colonialiste de
l'État canadien envers les autochtones, etc. Elles prennent leur
responsabilité sociale en dénonçant les indignations subies et
expriment qu'un gouvernement apte à gouverner doit prendre des mesures
concrètes pour y mettre fin définitivement.

La Dominique
Dans une déclaration pour le moins impudente, le
département d'État des États-Unis a félicité l'île de la Dominique dans
les Caraïbes pour les résultats de l'élection générale du 6
décembre lors de laquelle Roosevelt Skerrit s'est vu confier un nouveau
mandat en tant que premier ministre du gouvernement du Parti du travail
de la Dominique.
Selon un communiqué de presse en date du 9
décembre, le gouvernement des États-Unis aurait l'intention de «
continuer de travailler avec l'administration Skerrit afin de
promouvoir la sécurité régionale, la prospérité économique, une réforme
électorale qui garantit des élections libres, équitables et
transparentes ainsi que le droit des citoyens d'exercer pacifiquement
leur devoir civil ». On y remercie aussi les missions
d'observation électorale (MOÉ) de l'Organisation des États américains
(OÉA), du Commonwealth et de la CARICOM et leur travail pour assurer la
transparence du processus démocratique.

Le premier ministre Roosevelt Skerrit après
l'élection
|
Suite à des démarches juridiques visant sans succès à
retarder les élections tout en présentant des candidats dans chaque
circonscription, le Parti des travailleurs unis (PTU), de l'opposition,
a remporté trois des 21 sièges à l'Assemblée législative et au
Sénat, tandis que le Parti du travail de la Dominique a remporté
les 18 autres sièges. Les trois MOÉ ont reconnu la validité des
élections et n'ont noté aucun problème majeur dans le processus.
Au cours des dernières semaines, l'île
de 75 000 habitants a vécu des moments de violence et de
tension alors que le PTU dirigé par Lennox Linton, avec la complicité
de groupes de la société civile que plusieurs croient inspirés,
conseillés et organisés par l'OÉA, a mis en doute la validité du
processus électoral en annonçant à l'avance son intention de rejeter
les résultats des élections générales et en allant jusqu'à dire que le
premier ministre pourrait connaître le même sort qu'Evo Morales en
Bolivie. Le porte-parole a aussi ajouté que le PTU n'hésiterait pas à
solliciter l'aide de l'OÉA pour atteindre ses objectifs. La tension a
dégénéré en violence et en perturbations avant la tenue des élections
du 6 décembre, attribuées aux propos incendiaires de Linton et au
fait de pousser ses partisans à se défouler lors des manifestations.
Dans un appel à la CARICOM, aux gouvernements caribéens
individuels, aux partis politiques, organisations religieuses et
sociales ainsi qu'aux individus, avant la tenue des élections, le
Réseau anti-impérialiste caribéen (RAC) a soulevé que les déclarations
attribuées à l'opposition constituent un danger pour la paix en
Dominique et à la sécurité et la sûreté des Dominicains, et que si l'on
permettait aux forces qui défendent de tels objectifs de poursuivre
leurs efforts, il y aurait un grave danger d'effusion de sang et de
pertes de vie en Dominique.
Faisant allusion aux activités de l'OÉA en Dominique et
mettant en lumière ses antécédents à miner la gouvernance démocratique
dans la région — en organisant des coups d'État, en appuyant des forces
racistes et en servant d'instrument pour les manoeuvres de changement
de régime organisées par les États-Unis —, la déclaration condamne
l'ingérence destructrice de cette organisation, qui fait des demandes
éhontées à la Dominique concernant cette élection.
Suite à l'élection, le premier ministre Skerrit a
dit : « Les élections sont donc terminées. Le PTU n'a pas réussi à
les retarder ni à inciter le chaos dans notre société et il a connu
l'échec électoral ». Au sujet de l'opposition, il a dit : «
J'appelle le PTU et ses partisans à cesser leurs activités et leurs
comportements des récentes semaines. Qu'ils reconnaissent leur défaite
électorale et qu'ils oeuvrent pour la paix ». Il a réitéré son
appel à « donner à ce pays la pleine assurance que le Parti du travail
de la Dominique est totalement engagé envers la paix et l'unité ».
Le premier ministre a aussi dit que le gouvernement
allait continuer de bâtir le pays avec détermination et respect pour
son peuple, en favorisant des politiques qui consolident surtout les
projets de logement, d'éducation et de santé.
En revanche, le chef de l'opposition a réitéré le rejet
par son parti des résultats électoraux, disant qu'ils sont le résultat
d'une fraude électorale, exigeant de nouvelles élections, rejetant les
conclusions des MOÉ et appelant le peuple à s'insurger. À cette fin,
Linton a lancé l'appel à ses partisans à se rassembler dans Roseau, la
capitale, pour une soi-disant réunion de remerciement le 12
décembre.
Maintenant que la poussière est retombée, la Dominique
peut continuer de se reconstruire à la suite de la destruction de
l'ouragan qui a frappé en 2017, gérer la situation volatile créée
par l'OÉA et d'autres forces et tenter de résoudre ses problèmes
quotidiens dans un climat de calme. Mais il faut savoir que la caravane
de déstabilisation de l'OÉA est toujours là et va sans doute poursuivre
sa tournée dans la région.
À la lumière de cette tension continue, la vigilance est
de mise. Il faut aussi faire le bilan des récentes expériences de Cuba,
de la Jamaïque, de la Grenade, du Nicaragua et du Venezuela. La
souveraineté des Caraïbes est des plus importantes. Il faut surtout lui
donner corps en investissant nos peuples du pouvoir. Ce sera le premier
pas de la défense.

Le vote à l'élection du 6 décembre

(Pour voir les articles
individuellement, cliquer sur le titre de l'article.)
PDF
Lisez Le Marxiste-Léniniste
Site web: www.pccml.ca Courriel: redaction@cpcml.ca
|

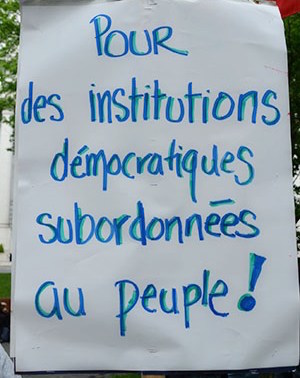



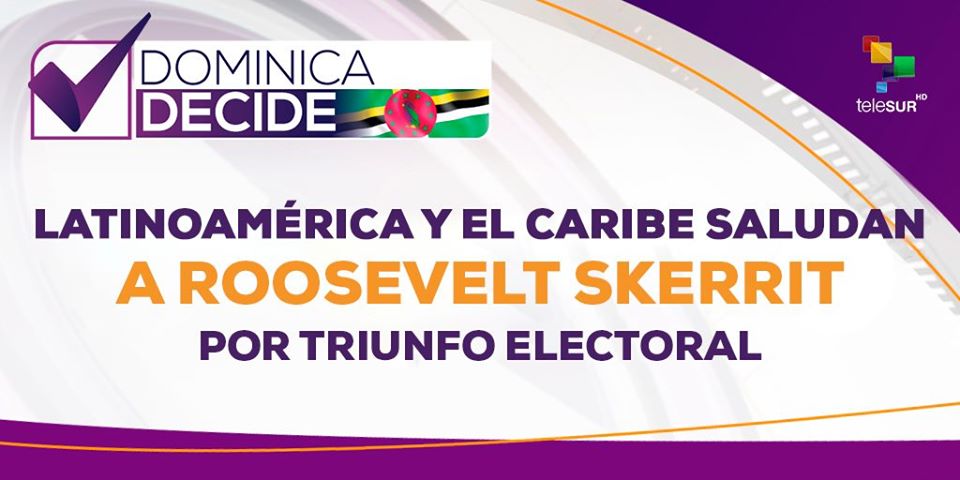

 Le battage des médias de masse en faveur
de l'ACEUM et la promotion de certaines personnalités politiques qui
lui sont associées montrent que l'ordre du jour, les préoccupations et
le pouvoir de l'oligarchie financière sont contraires à l'ordre du
jour, aux préoccupations et au pouvoir des peuples d'Amérique du Nord
et à leur désir de renouveler la démocratie et de s'investir de
pouvoir. Le pouvoir, la conception du monde et le but de l'oligarchie
financière sont imposés à force de répétition et d'exclusion de toute
alternative. Face au battage médiatique en faveur de l'ordre du jour
antisocial étouffant de l'oligarchie financière et de ses représentants
politiques dans les partis cartels, le peuple doit renforcer sa
politique indépendante, ses organisations, sa pensée, son ordre du jour
et ses médias.
Le battage des médias de masse en faveur
de l'ACEUM et la promotion de certaines personnalités politiques qui
lui sont associées montrent que l'ordre du jour, les préoccupations et
le pouvoir de l'oligarchie financière sont contraires à l'ordre du
jour, aux préoccupations et au pouvoir des peuples d'Amérique du Nord
et à leur désir de renouveler la démocratie et de s'investir de
pouvoir. Le pouvoir, la conception du monde et le but de l'oligarchie
financière sont imposés à force de répétition et d'exclusion de toute
alternative. Face au battage médiatique en faveur de l'ordre du jour
antisocial étouffant de l'oligarchie financière et de ses représentants
politiques dans les partis cartels, le peuple doit renforcer sa
politique indépendante, ses organisations, sa pensée, son ordre du jour
et ses médias.

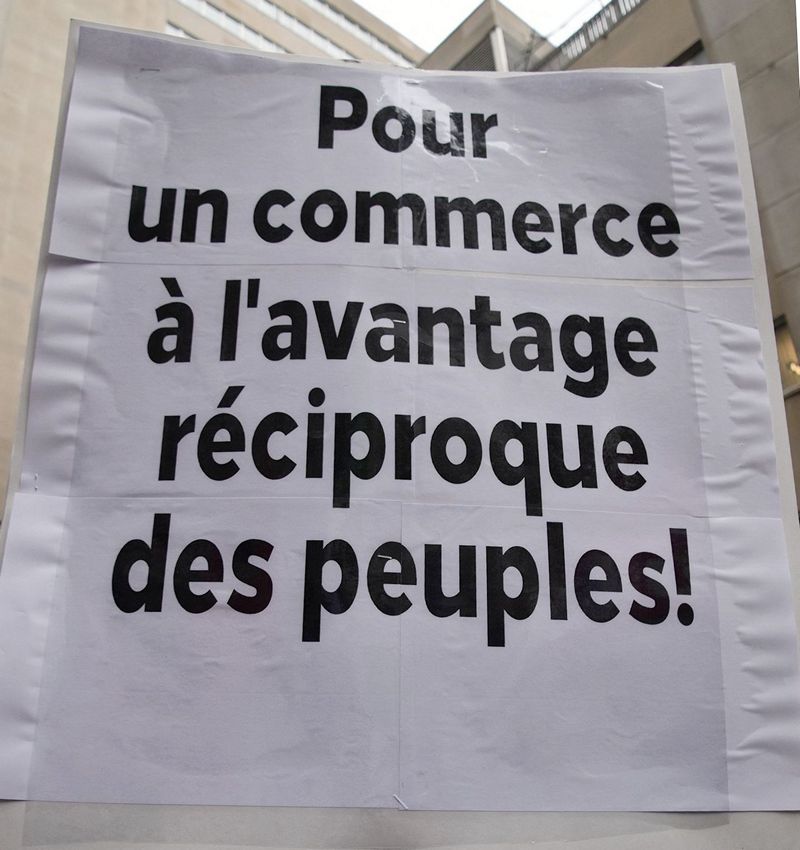 La politisation des intérêts privés de
l'oligarchie
financière se traduit par l'anarchie et la violence à l'échelle
mondiale sans droit commercial international pour empêcher les
concurrents de se détruire ou de s'entre-tuer. D'une certaine manière,
les intérêts privés politisés reflètent l'anarchie du Far West à
l'échelle mondiale. L'arbitraire des intérêts privés politisés se voit
dans la façon dont le président Trump brandit les tarifs comme arme
pour gagner des avantages sur la Chine et d'autres pays identifiés
comme des concurrents hostiles, et imposer des sanctions et des
boycottages à tout pays qui ne se soumet pas à la domination des
États-Unis.
La politisation des intérêts privés de
l'oligarchie
financière se traduit par l'anarchie et la violence à l'échelle
mondiale sans droit commercial international pour empêcher les
concurrents de se détruire ou de s'entre-tuer. D'une certaine manière,
les intérêts privés politisés reflètent l'anarchie du Far West à
l'échelle mondiale. L'arbitraire des intérêts privés politisés se voit
dans la façon dont le président Trump brandit les tarifs comme arme
pour gagner des avantages sur la Chine et d'autres pays identifiés
comme des concurrents hostiles, et imposer des sanctions et des
boycottages à tout pays qui ne se soumet pas à la domination des
États-Unis. L'oligarchie financière tient
particulièrement à éliminer le système traditionnel de gestion de
l'offre du Canada et du Québec dans le secteur laitier. Les
agriculteurs ont mené une lutte acharnée pour défendre leurs droits au
sein d'un Canada souverain et de son économie. En accordant l'accès en
franchise de droits au marché laitier canadien pour les deux autres
pays et inversement, l'ACEUM cherche à détruire le droit souverain des
agriculteurs d'organiser leur secteur. Le secteur agricole américain
est reconnu pour sa domination en raison de la taille de ses
exploitations et de son intégration avec l'oligarchie financière. Les
conglomérats du secteur pourront vendre à des prix inférieurs aux prix
de production pour éliminer les concurrents dans le secteur laitier,
comme ils l'ont fait aux États-Unis.[
L'oligarchie financière tient
particulièrement à éliminer le système traditionnel de gestion de
l'offre du Canada et du Québec dans le secteur laitier. Les
agriculteurs ont mené une lutte acharnée pour défendre leurs droits au
sein d'un Canada souverain et de son économie. En accordant l'accès en
franchise de droits au marché laitier canadien pour les deux autres
pays et inversement, l'ACEUM cherche à détruire le droit souverain des
agriculteurs d'organiser leur secteur. Le secteur agricole américain
est reconnu pour sa domination en raison de la taille de ses
exploitations et de son intégration avec l'oligarchie financière. Les
conglomérats du secteur pourront vendre à des prix inférieurs aux prix
de production pour éliminer les concurrents dans le secteur laitier,
comme ils l'ont fait aux États-Unis.[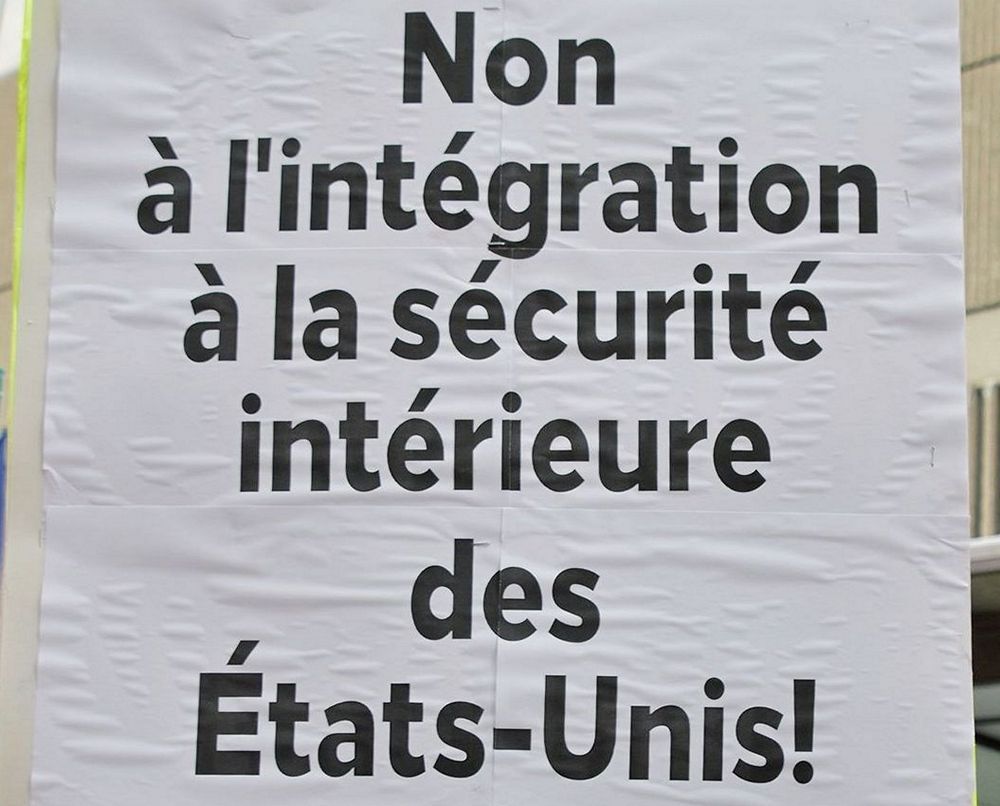 Dans le cadre de l'ACEUM, pour
être exempt de droits de
douane sur le marché nord-américain, un minimum de 75 % du
prix de production d'un véhicule doit avoir été produit à l'intérieur
de la Forteresse Amérique du Nord. Cela n'apporte aucune garantie que
la production se poursuivra dans des usines déjà établies, car ceux qui
en ont le contrôle introduisent rapidement de nouvelles techniques de
production et déplacent la production selon leurs intérêts privés
étroits, perspectives et critères qui vont à l'encontre du bien-être du
facteur humain, du développement d'une économie durable diversifiée qui
diminue le fardeau de l'introduction de nouvelles techniques et
détourne de la culture automobile, de sa pollution de l'environnement
et d'autres facteurs négatifs.
Dans le cadre de l'ACEUM, pour
être exempt de droits de
douane sur le marché nord-américain, un minimum de 75 % du
prix de production d'un véhicule doit avoir été produit à l'intérieur
de la Forteresse Amérique du Nord. Cela n'apporte aucune garantie que
la production se poursuivra dans des usines déjà établies, car ceux qui
en ont le contrôle introduisent rapidement de nouvelles techniques de
production et déplacent la production selon leurs intérêts privés
étroits, perspectives et critères qui vont à l'encontre du bien-être du
facteur humain, du développement d'une économie durable diversifiée qui
diminue le fardeau de l'introduction de nouvelles techniques et
détourne de la culture automobile, de sa pollution de l'environnement
et d'autres facteurs négatifs. L'ACEUM donne à l'oligarchie
financière des pouvoirs
extraordinaires pour contrôler les règlements couvrant toutes sortes
d'affaires économiques qui empêchent le gouvernement de s'acquitter de
ses responsabilités sociales. Dans le cadre de l'ACEUM, les
gouvernements doivent permettre aux grandes entreprises d'examiner tout
projet de règlement régissant leur secteur ou leur industrie avant
d'adopter une loi. De fait, cela politise les intérêts privés et les
activités des conglomérats de l'oligarchie financière de manière très
précise.
L'ACEUM donne à l'oligarchie
financière des pouvoirs
extraordinaires pour contrôler les règlements couvrant toutes sortes
d'affaires économiques qui empêchent le gouvernement de s'acquitter de
ses responsabilités sociales. Dans le cadre de l'ACEUM, les
gouvernements doivent permettre aux grandes entreprises d'examiner tout
projet de règlement régissant leur secteur ou leur industrie avant
d'adopter une loi. De fait, cela politise les intérêts privés et les
activités des conglomérats de l'oligarchie financière de manière très
précise.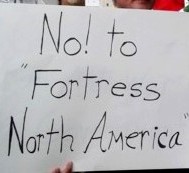 Au moment de la publication du contenu de
l'ACEUM, la Presse canadienne rapportait que le député conservateur
Michael Chong a accusé le gouvernement libéral de renoncer à une mesure
importante de souveraineté dans l'entente. « Nous devons maintenant
demander l'autorisation de Washington pour entamer des négociations
commerciales avec certains pays que les États-Unis désigneront comme
pays n'ayant pas une économie de marché, a déclaré Chong. Cela fait
littéralement de nous un État vassal des Américains. »
Au moment de la publication du contenu de
l'ACEUM, la Presse canadienne rapportait que le député conservateur
Michael Chong a accusé le gouvernement libéral de renoncer à une mesure
importante de souveraineté dans l'entente. « Nous devons maintenant
demander l'autorisation de Washington pour entamer des négociations
commerciales avec certains pays que les États-Unis désigneront comme
pays n'ayant pas une économie de marché, a déclaré Chong. Cela fait
littéralement de nous un État vassal des Américains. »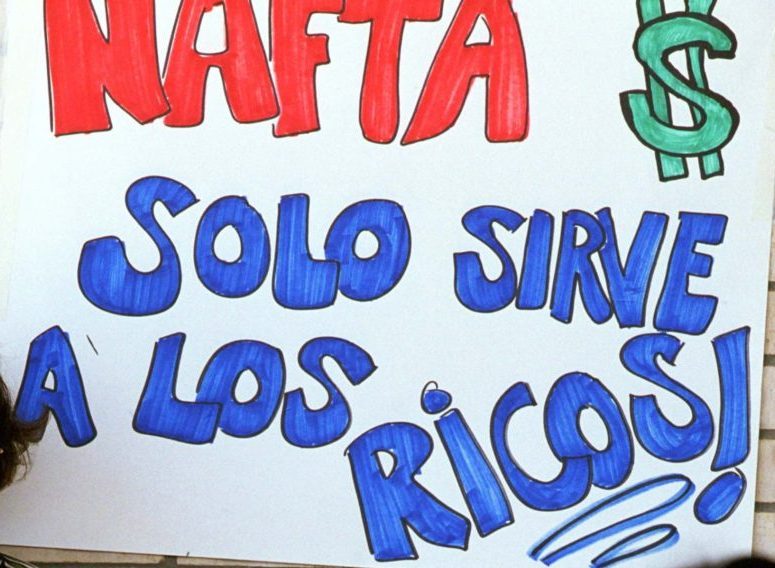 L'Accord de libre-échange nord-américain
(ALÉNA) est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Depuis
lors, le commerce entre les trois pays a connu une croissance
exponentielle, en partie grâce à l'établissement de chaînes
d'approvisionnement continentales des plus grands conglomérats. Chaque
jour, les États-Unis font plus de 3,6 milliards de dollars
d'échanges commerciaux avec le Canada et le Mexique. Le PIB annuel
combiné de la Forteresse Amérique du Nord est supérieur à 22
billions de dollars américains.
L'Accord de libre-échange nord-américain
(ALÉNA) est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Depuis
lors, le commerce entre les trois pays a connu une croissance
exponentielle, en partie grâce à l'établissement de chaînes
d'approvisionnement continentales des plus grands conglomérats. Chaque
jour, les États-Unis font plus de 3,6 milliards de dollars
d'échanges commerciaux avec le Canada et le Mexique. Le PIB annuel
combiné de la Forteresse Amérique du Nord est supérieur à 22
billions de dollars américains. Manifestation à Toronto le 18 janvier 2019
contre les coupures au Régime d'aide financière aux étudiants ontariens
et contre l'« Initiative de liberté de choix des étudiants »
Manifestation à Toronto le 18 janvier 2019
contre les coupures au Régime d'aide financière aux étudiants ontariens
et contre l'« Initiative de liberté de choix des étudiants » Le gouvernement avait affirmé que le but
de son initiative, qui s'accompagnait d'une fausse réduction
de 10 % des frais de scolarité et de réductions des prêts aux
étudiants, était d'améliorer l'accessibilité financière et l'accès aux
universités et collèges publics. Il avait aussi dit que ses directives
étaient fondées sur des « décisions de politique majeure » prises
par le Cabinet et qu'elles « dépassent donc la portée de la compétence
du tribunal en matière d'examen ». Il avait également soutenu que
les directives avaient été prises en vertu du pouvoir de dépenser de la
Couronne et que le tribunal n'avait pas la compétence pour s'ingérer
dans les décisions de dépenser du gouvernement.
Le gouvernement avait affirmé que le but
de son initiative, qui s'accompagnait d'une fausse réduction
de 10 % des frais de scolarité et de réductions des prêts aux
étudiants, était d'améliorer l'accessibilité financière et l'accès aux
universités et collèges publics. Il avait aussi dit que ses directives
étaient fondées sur des « décisions de politique majeure » prises
par le Cabinet et qu'elles « dépassent donc la portée de la compétence
du tribunal en matière d'examen ». Il avait également soutenu que
les directives avaient été prises en vertu du pouvoir de dépenser de la
Couronne et que le tribunal n'avait pas la compétence pour s'ingérer
dans les décisions de dépenser du gouvernement. Les arguments maintenant avancés par
B'nai Brith qui affirme que l'adhésion obligatoire à des associations
étudiantes viole les droits individuels des étudiants qui ne sont pas
d'accord avec leurs actions montrent que, comme le gouvernement Ford,
il veut briser les organisations de défense collective des étudiants au
nom des droits individuels. En tant que « fidèle allié » autoproclamé «
d'Israël », le B'nai Brith soutient-il l'initiative du
gouvernement Ford pour essayer de faire taire les étudiants ou du moins
interférer avec la capacité des étudiants à s'organiser collectivement
contre l'occupation israélienne de la Palestine ? Si c'est le cas, cela
ne révèle-t-il pas le caractère antidémocratique de l'initiative ? Ce
n'est pas un hasard si les arguments de B'nai Brith sont en fait les
mêmes que ceux avancés par le gouvernement Ford, que le paiement des
cotisations aux associations étudiantes devrait être une question de «
choix ».
Les arguments maintenant avancés par
B'nai Brith qui affirme que l'adhésion obligatoire à des associations
étudiantes viole les droits individuels des étudiants qui ne sont pas
d'accord avec leurs actions montrent que, comme le gouvernement Ford,
il veut briser les organisations de défense collective des étudiants au
nom des droits individuels. En tant que « fidèle allié » autoproclamé «
d'Israël », le B'nai Brith soutient-il l'initiative du
gouvernement Ford pour essayer de faire taire les étudiants ou du moins
interférer avec la capacité des étudiants à s'organiser collectivement
contre l'occupation israélienne de la Palestine ? Si c'est le cas, cela
ne révèle-t-il pas le caractère antidémocratique de l'initiative ? Ce
n'est pas un hasard si les arguments de B'nai Brith sont en fait les
mêmes que ceux avancés par le gouvernement Ford, que le paiement des
cotisations aux associations étudiantes devrait être une question de «
choix ».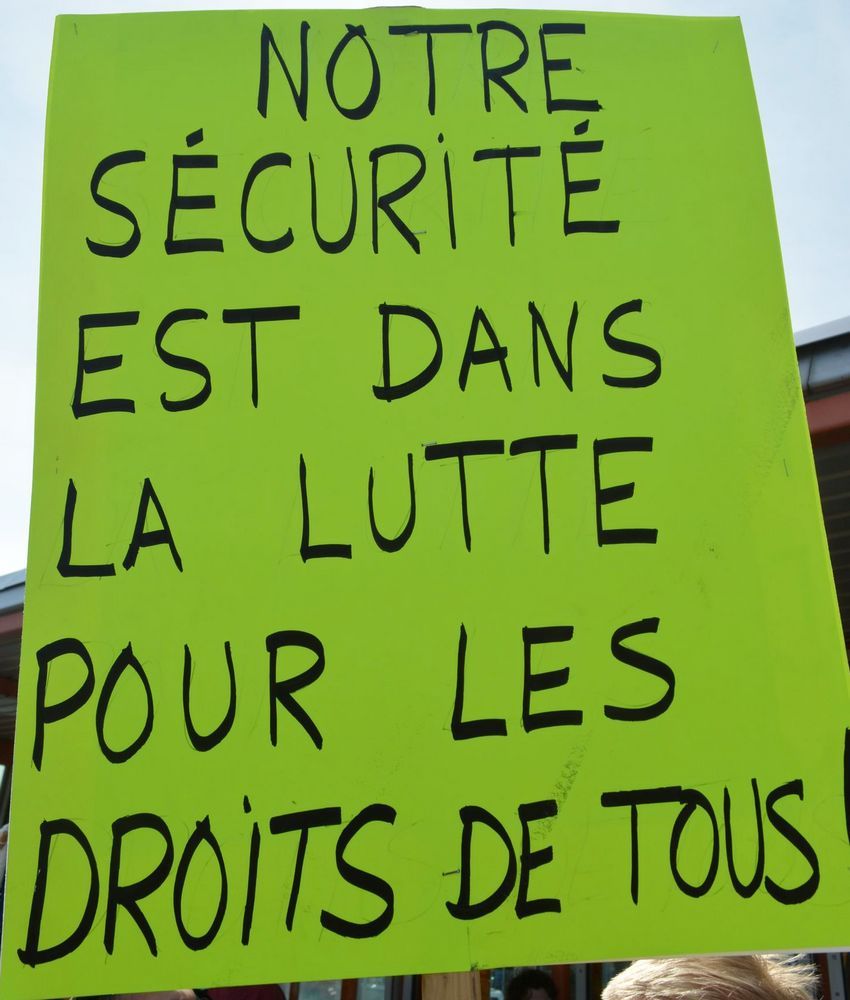
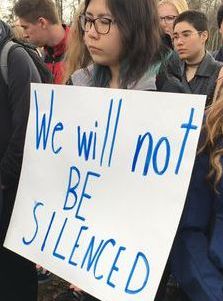

 La litanie des bons ou mauvais
comportements du gouvernement illustre l'hypocrisie de ceux qui, à tous
les jours, s'attaquent à la dignité des femmes, à leurs conditions de
travail et de vie. La politique antisociale des gouvernements n'est pas
un problème de comportement, tout comme la politique étrangère
d'ingérence et d'agression, la politique raciste et coloniale à
l'endroit des femmes des Premières Nations et de leur communauté. La
violence contre les femmes et les enfants est intimement liée la
direction antisociale et guerrière de la société et à la destruction
aujourd'hui des arrangements et institutions qui ne fonctionnent plus.
La litanie des bons ou mauvais
comportements du gouvernement illustre l'hypocrisie de ceux qui, à tous
les jours, s'attaquent à la dignité des femmes, à leurs conditions de
travail et de vie. La politique antisociale des gouvernements n'est pas
un problème de comportement, tout comme la politique étrangère
d'ingérence et d'agression, la politique raciste et coloniale à
l'endroit des femmes des Premières Nations et de leur communauté. La
violence contre les femmes et les enfants est intimement liée la
direction antisociale et guerrière de la société et à la destruction
aujourd'hui des arrangements et institutions qui ne fonctionnent plus. 



