|
Des sujets de préoccupation pour le corps
politique
• Le Parlement devient de moins en moins
pertinent
dans la prise de décisions
- Anna Di Carlo - • La politique étrangère servile du
gouvernement Trudeau
- Margaret Villamizar -
Mise à jour sur la COVID 19
• La situation au Canada avec les vaccinations
et les
nouveaux variants
- Nick
Lin -
• Les pays à
faible ou moyen revenu privés de vaccins
Le « Sommet pour
la démocratie » des États-Unis
• Efforts futiles
des États-Unis pour dicter l'issue de la crise
de la démocratie
- Kathleen
Chandler -
Le succès revigorant des fermiers
indiens
• Ce succès historique mènera certainement à une
victoire historique
- J.
Singh -
Des sujets de préoccupation pour le corps
politique
- Anna Di Carlo -
 Le
manque de pertinence du Parlement du Canada dans la prise de décisions
importantes qui affectent l'avenir du pays est parfaitement évident à
l'approche de la fin des travaux de la Chambre des communes et du Sénat
le vendredi 17 décembre, 20 jours après l'ouverture de la législature.
Il est de
plus en plus difficile de voir dans les délibérations du Parlement
canadien, qui est censé être un organe décisionnel, un but autre que
d'être le lieu des querelles partisanes et des jeux de surenchère,
lesquels ne font que discréditer davantage les partis cartellisés et le
système de gouvernement
de parti. Il y a absence de toute délibération sérieuse, sur quelque
sujet que ce soit. Les problèmes urgents auxquels sont confrontés la
population et le corps politique ne figurent pas à l'ordre du jour : de
la crise climatique à la détérioration et à la précarité des conditions
économiques qui
voient l'utilisation des banques alimentaires monter en flèche et les
travailleurs être traités comme des objets jetables, en passant par
l'escalade de la violence contre les plus vulnérables et le déni des
droits ancestraux des peuples autochtones, sans oublier l'instabilité de
la situation
internationale et la place qu'y occupe le Canada en tant que membre de
l'OTAN. Le
manque de pertinence du Parlement du Canada dans la prise de décisions
importantes qui affectent l'avenir du pays est parfaitement évident à
l'approche de la fin des travaux de la Chambre des communes et du Sénat
le vendredi 17 décembre, 20 jours après l'ouverture de la législature.
Il est de
plus en plus difficile de voir dans les délibérations du Parlement
canadien, qui est censé être un organe décisionnel, un but autre que
d'être le lieu des querelles partisanes et des jeux de surenchère,
lesquels ne font que discréditer davantage les partis cartellisés et le
système de gouvernement
de parti. Il y a absence de toute délibération sérieuse, sur quelque
sujet que ce soit. Les problèmes urgents auxquels sont confrontés la
population et le corps politique ne figurent pas à l'ordre du jour : de
la crise climatique à la détérioration et à la précarité des conditions
économiques qui
voient l'utilisation des banques alimentaires monter en flèche et les
travailleurs être traités comme des objets jetables, en passant par
l'escalade de la violence contre les plus vulnérables et le déni des
droits ancestraux des peuples autochtones, sans oublier l'instabilité de
la situation
internationale et la place qu'y occupe le Canada en tant que membre de
l'OTAN.
Les délibérations du Parlement du Canada sont devenues un camouflage
pour les décisions prises sur la base du fédéralisme exécutif. Les
décisions sont également prises par des instances supranationales créées
pour servir les intérêts néolibéraux des oligarques financiers mondiaux
les plus
puissants. Il est devenu courant pour les ministres et leurs suppléants
de répondre aux questions sur ce que fait le gouvernement, par exemple
sur des sujets liés à l'environnement ou à la pandémie de COVID-19, en
débutant avec des phrases comme « nous consultons nos alliés », « nous
travaillons
avec nos partenaires » ou « nous discutons avec des pays aux vues
similaires ».
L'insignifiance du Parlement a été illustrée par la formation d'un
Comité spécial sur l'Afghanistan le 9 décembre, avec le soutien de tous
les députés sauf les députés libéraux. La motion créant le comité avait
comme préambule : « Étant donné que la dissolution du Parlement a rendu
impossible
pendant un certain temps la surveillance parlementaire en temps réel »
de la chute de l'Afghanistan aux mains des talibans (parce que les
élections avaient été déclenchées). Elle faisait valoir que le Comité
spécial était nécessaire pour tenir des audiences et revoir les
événements qui ont mené à la
chute de l'Afghanistan. La raison pour laquelle le Canada était en
Afghanistan n'est toutefois pas sujette à l'enquête, pas plus que
l'imputabilité pour le désastre qui a résulté de la participation du
Canada à l'agression américaine contre ce pays. Le Comité spécial se
concentrera sur la façon dont
le gouvernement a géré l'évacuation des personnes qui avaient collaboré
avec les forces dirigées par l'OTAN en Afghanistan, mais il ne se
penchera pas sur pourquoi les collaborateurs d'une agression et d'une
occupation étrangères sont appelés des héros ou pourquoi les forces
spéciales ukrainiennes
formées par les forces spéciales canadiennes ont dû tirer les marrons du
feu pour le Canada.
Pendant ce temps, dans l'ici-présent de la « surveillance
parlementaire en temps réel », il n'y a pas eu la moindre délibération à
la Chambre des communes avant que la nouvelle ministre des Affaires
étrangères, Mélanie Joly, et le nouveau ministre du Développement
international, Harjit Sajjan,
qui était auparavant au ministère de la Défense, aux commandes des
forces canadiennes en Afghanistan, ne se rendent à la réunion des
ministres des Affaires étrangères et du Développement du G7 du 10 au 12
décembre à Liverpool, en Angleterre. On savait que les États-Unis y
imposeraient leur discours
belliciste contre la Russie en ce qui concerne l'Ukraine. Le communiqué
d'Affaires mondiales Canada pour l'occasion indique que « les ministres
Joly et Sajjan chercheront à harmoniser les efforts du Canada avec ceux
de partenaires aux vues similaires sur un certain nombre de priorités ».
Rien de
plus. Le communiqué indique que les ministres du G7 « échangeront
également sur des questions géopolitiques urgentes, y compris la
situation en Afghanistan, la Chine, la Corée du Nord, l'Éthiopie,
l'Iran, le Myanmar, la Russie, le Soudan et l'Ukraine ». La ministre des
Affaires étrangères, dont la
principale expertise semble être sa capacité à inventer des façons de ne
rien dire, a envoyé un gazouillis depuis Liverpool pour dire qu'elle
était « impatiente d'avoir des discussions importantes avec mes
collègues et de chercher des solutions réelles à certains des problèmes
les plus pressants de
notre époque ».
Les explications pour le manque de pertinence du Parlement
Le manque de pertinence du Parlement est devenu un sujet d'intérêt
pour plusieurs experts. Un des aspects qui retient l'attention est
l'extrême lenteur du Parlement à assumer ses fonctions après l'élection
fédérale anticipée du 20 septembre, que le gouvernement prétendait
nécessaire pour définir
une nouvelle orientation dans les conditions de la pandémie. Le premier
ministre Justin Trudeau, qui en est à son troisième mandat, a retardé la
convocation du Parlement pendant plus de deux mois après cette élection
qui a donné une Chambre des communes pratiquement identique à la
précédente. Il a
inauguré la session parlementaire avec un discours du Trône pratiquement
identique aux déclarations d'intention qu'il avait publiées après la
prorogation de la Chambre en août 2020.
Une fois le Parlement finalement réuni, le 22 novembre, le
gouvernement n'a pas considéré que c'était une priorité de rétablir les
comités parlementaires, qui sont censés être les forums permettant aux
élus d'examiner les lois et d'étudier les questions importantes. Au 10
décembre, seuls deux
comités avaient commencé leurs travaux : le Comité permanent des finances
et le Comité permanent de la sécurité publique et nationale. La liste
des membres de tous les autres comités a été déposée le 9 décembre et
ceux-ci ont reçu l'ordre d'élire leur président avant que la Chambre
n'ajourne ses
travaux pour la pause de six semaines débutant le 17 décembre.
Par ailleurs, depuis le début de son deuxième mandat en octobre 2019,
le gouvernement libéral a pris de nombreuses mesures et a tenté
d'instituer des mesures caractérisées par un mépris de la Chambre des
communes en tant qu'organe décisionnel présumé des représentants élus
des Canadiens. Il a
notamment tenté de déposer un projet de loi qui aurait donné au ministre
des Finances le pouvoir d'augmenter les dépenses sans demander
l'approbation du Parlement et de contester une décision du président de la
Chambre devant la Cour fédérale lui ordonnant de fournir les documents
demandés à la Chambre
des communes.
Dans un éditorial du 9 décembre, le Globe and Mail déplore
que la Chambre des communes ne sera pas « pleinement fonctionnelle »
avant février. Il rappelle que depuis juin 2019, la Chambre n'a siégé
que 169 jours. Il note que la prorogation d'août 2020 a servi à étouffer
l'enquête
sur le scandale de l'organisme UNIS et conclut : « M. Trudeau préfère de
toute évidence ne pas être tenu responsable par les institutions
démocratiques auxquelles il prétend croire. Il semble même qu'il se
considère au-dessus de ces institutions [...]. Mais M. Trudeau n'est pas
au-dessus du
Parlement. Dans un gouvernement minoritaire, il n'est premier ministre
qu'au bon plaisir de la Chambre des communes. Ce n'est pas à lui
d'étouffer le débat et l'examen minutieux qui sont l'oxygène de notre
démocratie, et le fait qu'il continue à s'en sauver devrait inquiéter
tous les Canadiens.
»
Dans la même veine, d'autres experts politiques ont appelé le premier
ministre « M. Tergiversation » et ont inventé un terme pour décrire la
lenteur du fonctionnement du Parlement comme étant « le temps de Justin
». L'absence de lettres de mandat pour les ministres du Cabinet est
également
dénoncée, surtout qu'au début de son premier mandat Justin Trudeau avait
fait si grand cas de ces lettres comme outils essentiels avec lesquels
son gouvernement allait assurer la « transparence » et la «
responsabilité ». Des « sources » du gouvernement promettaient encore,
44 jours après
l'assermentation du Conseil des ministres, qu'elles seraient publiées «
bientôt ».
Les diversions se succèdent rapidement et la dernière en date est
que, même dans les rangs du Parti libéral, personne ne s'oppose à ce que
l'on parle de remplacer le premier ministre le plus tôt possible.
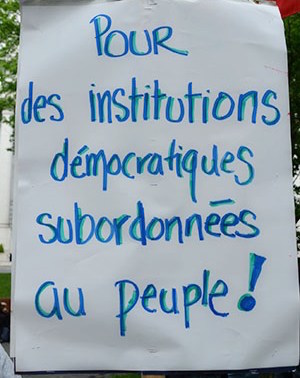 La
situation ne peut être expliquée par un penchant personnel, par le
narcissisme ou le manque de substance du premier ministre. L'explication
se trouve dans les structures mêmes du système démocratique dominé par
les partis, qui n'est tout simplement pas représentatif du peuple, car
il
représente des intérêts privés étroits qui sont habilités à dominer et à
maintenir le peuple sous contrôle. L'état de décrépitude de toutes les
institutions, structures et agences de la société civile, qui sont
censées représenter la société civile – depuis les partis cartellisés jusqu'aux notions
de responsabilité ministérielle qui ne sont plus pratiquées –, fait en
sorte que le discours politique a disparu pour être remplacé par une
chasse aux scandales qui mène dans des voies sans issue. Tout cela pour
détourner l'attention des enjeux qui sont devenus les plus importants
aujourd'hui : par
qui sont prises les décisions et comment obliger les forces corrompues
qui prennent ces décisions dans leurs propres intérêts à rendre des
comptes. La
situation ne peut être expliquée par un penchant personnel, par le
narcissisme ou le manque de substance du premier ministre. L'explication
se trouve dans les structures mêmes du système démocratique dominé par
les partis, qui n'est tout simplement pas représentatif du peuple, car
il
représente des intérêts privés étroits qui sont habilités à dominer et à
maintenir le peuple sous contrôle. L'état de décrépitude de toutes les
institutions, structures et agences de la société civile, qui sont
censées représenter la société civile – depuis les partis cartellisés jusqu'aux notions
de responsabilité ministérielle qui ne sont plus pratiquées –, fait en
sorte que le discours politique a disparu pour être remplacé par une
chasse aux scandales qui mène dans des voies sans issue. Tout cela pour
détourner l'attention des enjeux qui sont devenus les plus importants
aujourd'hui : par
qui sont prises les décisions et comment obliger les forces corrompues
qui prennent ces décisions dans leurs propres intérêts à rendre des
comptes.
Partout dans le monde, les peuples sont assaillis par le pouvoir
d'instances décisionnelles et consultatives néolibérales établies aux
niveaux national et international. Le Canada n'est pas le seul pays à
constater que son Parlement n'est pas pertinent dans la prise de
décisions sur la direction
du pays. C'est un grave sujet de préoccupation pour tous les peuples du
Canada et du monde qui se battent pour la dignité du travail, pour une
solution à la crise qui paralyse l'environnement social et
l'environnement naturel et pour mettre fin aux dangers de nouvelles
guerres et aux ravages
qu'elles laissent dans leur sillage. Nous sommes une seule humanité, qui
mène une seule lutte pour le droit d'être – comme nous le définissons nous-mêmes, ensemble.
Le fait que le Parlement n'ait plus rien à voir avec les décisions
qui affectent nos vies marque la fin des formes de gouvernement de parti
et le début de quelque chose d'autre. Assurons-nous que ce qui vient
favorise les intérêts des peuples du Canada et du monde, et non les
intérêts privés
étroits qui se battent pour tout contrôler et tout soumettre à leurs
besoins.

- Margaret Villamizar -
 
Le discours du Trône libéral prononcé le 23 novembre par la
gouverneure générale Mary May Simon a clairement indiqué les intentions
du gouvernement Trudeau en matière de politique étrangère pour la 44e
législature. La gouverneure générale a identifié ce qu'elle a appelé les
défis pressants de
notre époque comme étant « la montée de l'autoritarisme » et « la lutte
entre les grandes puissances » et a déclaré que cela exige un engagement
accru du Canada auprès de ses alliés clés et des coalitions, des
organisations et des partenaires internationaux. Elle a également
annoncé que le Canada
allait déployer des efforts conscients pour approfondir les partenariats
dans la région indo-pacifique et dans l'ensemble de l'Arctique.
Pas besoin d'être un génie pour comprendre que cela signifie
intensifier la participation du Canada aux tentatives de plus en plus
désespérées de son « allié clé » d'imposer au reste du monde son
soi-disant ordre international fondé sur des règles, mettant ainsi en
danger la paix et la sécurité.
Il s'agit d'accroître l'intégration du Canada dans la machine de guerre
des États-Unis par l'entremise de l'OTAN, qui élargit son champ
d'activité dans la région de l'Asie-Pacifique et au-delà, se livrant à
de dangereuses provocations contre la Chine et la Russie. Il s'agit
d'intensifier l'ingérence
du Canada dans les affaires des nations et des peuples souverains qui
refusent de se plier aux diktats des États-Unis et adoptent et défendent
leur propre voie indépendante de développement.
Les intentions du gouvernement Trudeau de maintenir le cap avec une
politique étrangère qui s'aligne sur l'ordre du jour hégémonique de
l'impérialisme américain sont claironnées par sa nouvelle ministre des
Affaires étrangères Mélanie Joly. À sa première rencontre avec le
secrétaire d'État
américain Antony Blinken, lors d'une séance d'information à Washington
le 12 novembre, Mélanie Joly s'est enthousiasmée à l'idée qu'une de
leurs priorités serait de travailler ensemble « pour protéger et
promouvoir la démocratie et les droits de la personne dans le monde ».
Il y a de nombreux
exemples de ce que cela signifie en pratique.
La « promotion de la démocratie » de type américain
au Nicaragua et au Venezuela
Dans une déclaration arrogante faite au nom du Canada à la suite
des élections générales du 7 novembre au Nicaragua, dans lesquelles les
électeurs ont réaffirmé à une majorité écrasante leur soutien à la
révolution sandiniste et à son dirigeant, le président Daniel Ortega,
Mélanie Joly dit au
peuple du Nicaragua que l'élection ne reflétait pas sa volonté et que «
le régime » l'avait privé de son droit de voter dans des élections
libres et équitables. D'autres accusations et calomnies sans fondement
contre le président Ortega ont suivi. La déclaration concluait en disant
que le Canada
avait l'intention de « demander des comptes à ce régime oppressif et à
ceux qui le soutiennent ».
 Une
semaine plus tard, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il étendait ses
sanctions dites ciblées à onze autres personnes liées à l'État et au
gouvernement du Nicaragua, prétendument pour violations des droits
humains. Le Canada suit en cela l'exemple du Congrès américain qui,
quelques jours
avant les élections, a adopté la Loi RENACER (Reinforcing
Nicaragua's Adherence to Conditions for Electoral Reform) pour renforcer
ses mesures coercitives unilatérales dans une tentative évidente
d'influencer les élections. La loi des États-Unis exige expressément une
meilleure coordination
de ces mesures avec l'Union européenne et le Canada. Une
semaine plus tard, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il étendait ses
sanctions dites ciblées à onze autres personnes liées à l'État et au
gouvernement du Nicaragua, prétendument pour violations des droits
humains. Le Canada suit en cela l'exemple du Congrès américain qui,
quelques jours
avant les élections, a adopté la Loi RENACER (Reinforcing
Nicaragua's Adherence to Conditions for Electoral Reform) pour renforcer
ses mesures coercitives unilatérales dans une tentative évidente
d'influencer les élections. La loi des États-Unis exige expressément une
meilleure coordination
de ces mesures avec l'Union européenne et le Canada.
D'autres sales coups, étroitement coordonnés avec les États-Unis, ont
eu lieu lors de la 51e Assemblée générale de l'Organisation des États
américains (OÉA) qui s'est tenue du 10 au 12 novembre. C'est là
que Mélanie Joly a pris l'initiative de présenter, au nom des
États-Unis, du Canada et de six autres pays, un projet de résolution qui
déclarait que les élections du 7 novembre au Nicaragua « n'étaient pas
libres, justes ou transparentes et n'avaient aucune légitimité
démocratique ».[1].
Une des choses que les pouvoirs en place à l'OÉA ne peuvent pardonner
au Nicaragua est sans aucun doute son refus de permettre à une mission
d'observation de l'OÉA de superviser son élection du 7 novembre. Ce
refus s'explique par l'ingérence constante de l'organisation dans les
affaires intérieures du pays au cours des dernières années et par le
rôle malveillant que l'OÉA a joué dans l'instigation du coup d'État de
2019 en Bolivie, en soulevant des allégations sans fondement selon
lesquelles Evo Morales avait été réélu par fraude. L'examen ultérieur
par des enquêteurs indépendants des données recueillies et interprétées
par la mission d'observation de l'OÉA a démontré sur tous les fronts
qu'il n'y avait pas eu de fraude et qu'Evo Morales n'avait pas « volé »
l'élection comme l'a déclaré à qui voulait l'entendre l'infâme
secrétaire général de l'OÉA, Luis Almagro.
Le fait que son élection ait été jugée illégitime par l'OÉA a été la
goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le Nicaragua. Comme le
Venezuela l'avait fait quatre ans plus tôt, le Nicaragua a annoncé le 19
novembre qu'il se retirait de l'OÉA. Dans un communiqué, le ministre
des Affaires étrangères Denis Moncada déclare que le Nicaragua n'est pas
intéressé à faire partie d'une organisation interventionniste qui a
pour mission de faciliter l'hégémonie des États-Unis sur les pays
d'Amérique latine.
La décision du Nicaragua de quitter l'OÉA n'a pas empêché le Canada
et la poignée d'autres pays qui ont coparrainé sa résolution condamnant
l'élection du Nicaragua de demander la convocation d'une session
extraordinaire du Conseil permanent de l'OÉA le 8 décembre. L'objectif
était d'adopter une autre résolution d'ingérence, cette fois-ci à la
suite de « l'évaluation de la situation au Nicaragua » demandée dans la
résolution précédente. La résolution du 8 décembre, qui a été adoptée
sans discussion, rappelait au Nicaragua que tant que le processus de
retrait de l'OÉA, qui doit durer deux ans, n'est pas achevé, ses
obligations envers l'organisation restent en vigueur, de même que son
devoir de se conformer à ses obligations internationales en matière de
droits humains. Il contenait une liste d'exigences et d'impositions
auxquelles le Nicaragua devait se conformer, sans doute pour éviter
d'être expulsé d'une organisation qu'il avait déjà dit vouloir quitter,
mais plus probablement pour tenter de légitimer l'application de mesures
plus coercitives par des pays comme les États-Unis et le Canada
lorsqu'ils décideront de le faire. L'une des demandes les plus
scandaleuses de la liste, surtout si l'on considère les sources, était
que le Nicaragua mette en uvre les « réformes électorales complètes
demandées dans les résolutions précédentes et conformément aux
obligations du Nicaragua en vertu du droit international ». De toute
évidence, le Canada et les autres pays qui ont soutenu cette résolution
pompeuse se sentent non seulement qualifiés pour juger le système et les
lois électorales du Nicaragua, mais ne se sentent pas non plus tenus de
respecter le droit international lorsqu'il s'agit de respecter la
souveraineté des pays et de ne pas s'ingérer dans leurs affaires
intérieures.
Le représentant du Nicaragua a déclaré que son pays rejetait la tenue
de cette session illégitime et que celle-ci représentait une nouvelle
attaque contre le Nicaragua et son peuple, en violation de la Charte des Nations unies,
du droit international et de la charte de l'OÉA elle-même.
Dans une déclaration faite le même jour, le ministre Moncada a déclaré
que les positions du Nicaragua sont et ont été claires, à savoir que «
nous ne sommes pas une colonie, nous ne sommes pas des esclaves, nous ne
sommes pas les serviteurs de qui que ce soit, d'un empire ou d'un
gouvernement qui se
prend pour une puissance ». Au contraire, a-t-il dit, « nous accusons
l'OÉA, qui n'a aucune autorité morale pour accuser qui que ce soit,
parce qu'elle est, avec les États-Unis, selon les mots de Sandino, 'la
tanière où l'on fabrique les crimes, les violences et les atrocités'contre tous les
droits humains, politiques, économiques, climatiques et sociaux, et
contre les libertés que nos peuples revendiquent et exigent avec
toujours plus de force et de détermination ».
Les résultats des « mégas-élections » du 21 novembre au Venezuela,
qui n'est plus membre de l'OÉA, n'ont pas non plus été du goût des
États-Unis et du Canada, malgré la large participation des partis
d'opposition et des candidats qu'ils soutiennent, notamment ceux qui
avaient boycotté les
élections précédentes. Les États-Unis et le Canada ont publié des
déclarations peu après la fin des élections, affirmant qu'elles
n'avaient été ni « libres » ni « équitables ». Le président Nicolas
Maduro a été accusé de toutes sortes de crimes et de méfaits, et même
des effets des sanctions
brutales des États-Unis qui font tant de mal au peuple vénézuélien. Les
deux gouvernements ont affirmé, sans apporter de preuve, que l'élection
ne reflétait pas la volonté du peuple vénézuélien. Mélanie Joly a ajouté
que le Canada soutenait les forces d'opposition et leur appel à une
élection qui «
reflète les véritables désirs du peuple vénézuélien ».
Le gouvernement Trudeau a beaucoup de comptes à rendre aux peuples
nicaraguayen, vénézuélien et canadien au nom desquels sa ministre des
Affaires étrangères prétend parler alors qu'elle ne fait que répéter
comme un perroquet des lignes de conduite qui proviennent du département
d'État des
États-Unis
Note
1. La résolution a été
présentée au nom d'Antigua-et-Barbuda, du Canada, du Chili, du Costa
Rica, de la République dominicaine, de l'Équateur, des États-Unis et de
l'Uruguay. Antigua-et-Barbuda, l'Argentine, les Bahamas, la Barbade, le
Brésil, le Canada, le Chili, la
Colombie, le Costa Rica, la République dominicaine, l'Équateur, le
Salvador, la Grenade, le Guatemala, la Guyane, Haïti, la Jamaïque, le
Panama, le Paraguay, le Pérou, le Suriname, Trinité-et-Tobago, les
États-Unis et l'Uruguay ont voté pour. Le Nicaragua s'y est opposé,
tandis que le Belize, la
Bolivie, la Dominique, le Honduras, le Mexique, Sainte-Lucie et
Saint-Vincent-et-les-Grenadines se sont abstenus. Le représentant
illégalement accrédité Juan Guaido, prétendant représenter le Venezuela,
a également voté pour. Saint-Kitts-et-Nevis était absent.

Mise à jour sur la COVID 19
- Nick
Lin -
À la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre, la
pandémie de COVID-19 persiste dans le monde entier, y compris au Canada.
En date du 9 décembre au Canada, il y avait eu 1 821 890 cas
cumulatifs de COVID-19 et 29 863 décès. Il y a 31 197 cas actifs et 1
760 830 personnes se sont rétablies. Les deux cartes ci-dessous montrent
les cas actuels et les vaccinations :
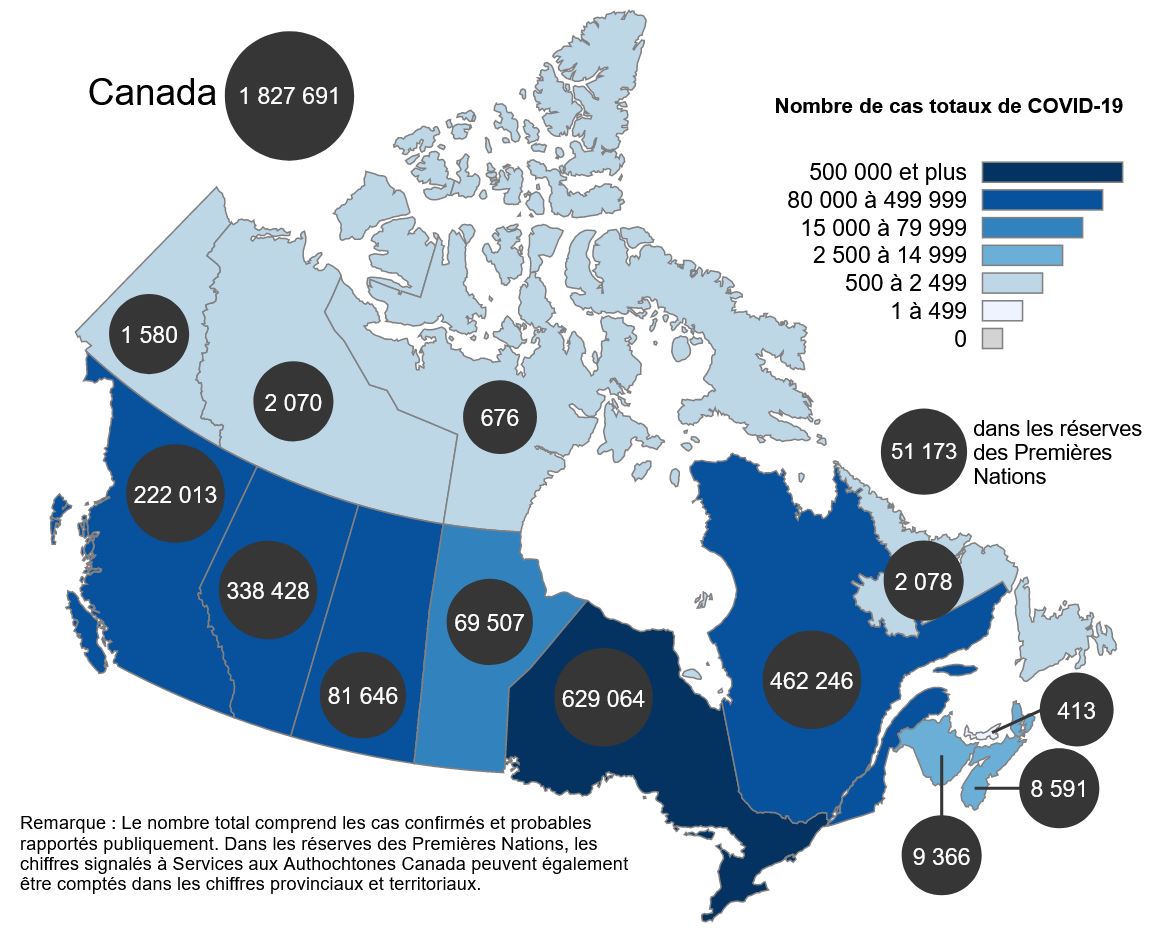
L'évolution du nombre quotidien de nouveaux cas depuis le début de la
pandémie est illustrée dans le graphique ci-dessous :
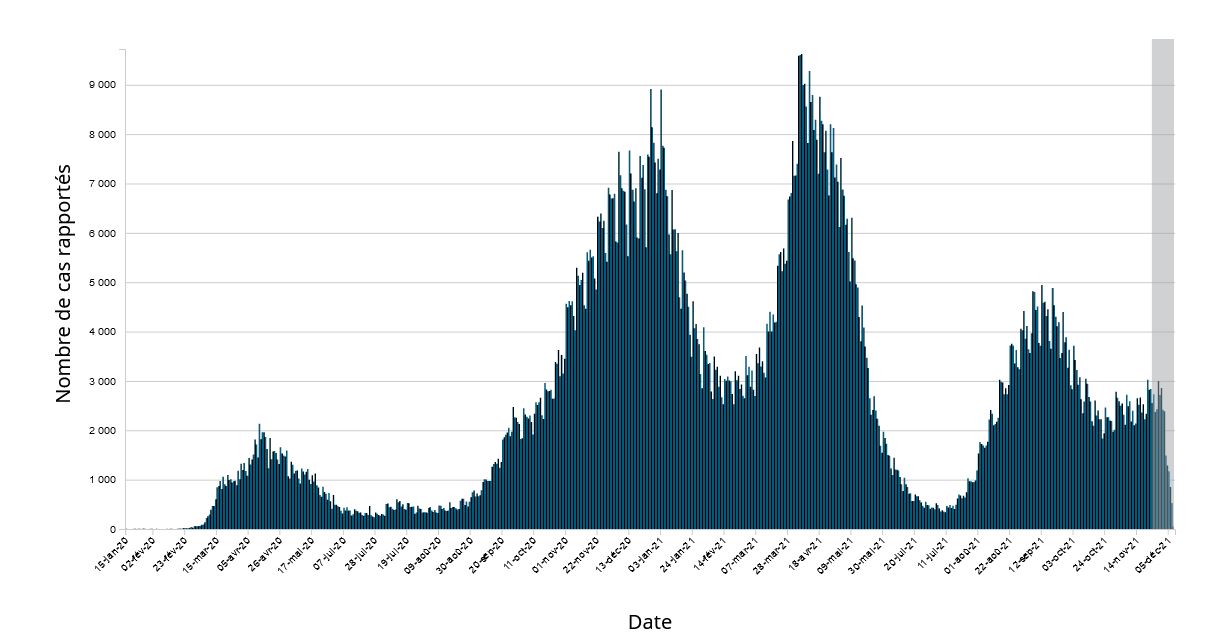
Cliquer pour agrandir.
Dans le contexte du variant Delta, qui représente maintenant la
majorité des cas actuels, et du variant Omicron émergent, la Dre Theresa
Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a noté
dans sa dernière déclaration, publiée le 3 décembre :
« Les données de surveillance continuent de montrer que l'activité de
la maladie à coronavirus (COVID-19) présente des variations régionales
considérables à la grandeur du pays. Le nombre de cas signalés à
l'échelle nationale chaque jour a connu une augmentation graduelle, les
taux d'infection
restant toujours élevés dans de nombreuses régions. Durant la plus
récente période de sept jours (du 26 nov. au 2 déc.), 2 821 nouveaux cas
ont été signalés en moyenne, ce qui représente une augmentation de 8 %
par rapport à la semaine précédente. Les tendances actuelles montrent
que le nombre
d'hospitalisations et d'admissions aux soins intensifs diminue toujours
lentement. Cependant, advenant une augmentation des taux d'infection,
les tendances pourraient recommencer à augmenter. Les dernières données
provinciales et territoriales montrent que, en moyenne, 1 540 personnes
touchées par
la COVID-19 recevaient des soins en milieu hospitalier chaque jour au
cours de la période de sept jours la plus récente (du 26 nov. au 2
déc.), ce qui représente une baisse de 4 % comparativement à la semaine
dernière. Cela comprend notamment une moyenne de 465 personnes aux soins
intensifs, soit 1
% de moins que la semaine précédente, et une moyenne de 19 décès
signalés chaque jour, du 26 nov. au 2 déc. Au cours des semaines et des
mois à venir, il demeurera crucial de maintenir un faible taux
d'infection pour éviter une nouvelle hausse des tendances relatives aux
cas graves et pour alléger
le fardeau qui continue de peser sur le système de santé,
particulièrement dans les régions fortement affectées
« Bien que la grande majorité des récents cas de COVID-19 au Canada
continue d'être attribuable au variant Delta, en date du 2 décembre
2021, 11 cas du nouveau variant préoccupant Omicron ont été signalés en
Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Alors que
nous continuons à
évaluer l'importance et l'incidence de ce nouveau variant préoccupant,
les Canadiens sont priés de demeurer vigilants et de continuer de se
protéger.
« Quel que soit le variant du SARS-CoV-2 qui domine dans une région,
nous savons que la vaccination, combinée aux mesures de santé publique
et aux pratiques individuelles, favorise toujours la réduction de la
transmission de la COVID-19 et des complications graves. Plus
particulièrement, les
données probantes continuent d'indiquer qu'une série complète de vaccins
contre la COVID-19 approuvée par Santé Canada fournit une protection
importante contre la maladie grave surtout parmi les groupes d'âge
jeunes. Selon les dernières données provenant des 9 provinces et
territoires portant sur
les populations âgées de 12 ans et plus, dans les dernières semaines (du
17 octobre au 13 novembre 2021), la moyenne hebdomadaire ajustée selon
l'âge indique que les personnes non vaccinées étaient nettement plus
nombreuses à être hospitalisées pour la COVID-19 que les personnes
entièrement
vaccinées.
« - Chez les jeunes et les adultes âgés de 12 à 59 ans, les personnes
non vaccinées étaient 37 fois plus nombreuses à être hospitalisées que
les personnes entièrement vaccinées.
- Chez les adultes de 60 ans et plus, les personnes non vaccinées
étaient 18 fois plus nombreuses à être hospitalisées que les personnes
entièrement vaccinées. »
La Dre Tam dit également que le Comité consultatif national de
l'immunisation (CCNI) recommande l'administration de trois doses de
vaccins pour renforcer l'immunisation. Elle déclare :
« Le CCNI a réitéré que les avantages d'un vaccin à ARNm contre la
COVID-19 continuent de l'emporter sur les risques d'effets secondaires
rares associés à un vaccin à ARNm, ce qui comprend le faible risque
d'une myocardite et/ou d'une péricardite à la suite d'une immunisation,
le plus souvent
observée chez les hommes âgés de 12 à 29 ans. Le CCNI recommande
également, et les autorités sanitaires du Canada sont d'accord, que
l'immunisation des personnes admissibles - mais qui n'ont pas encore
reçu leur première série de vaccins - continue d'être la priorité
absolue, au Canada et partout
dans le monde.
« Concernant les doses de rappel, le CCNI a tenu compte des nouvelles
données probantes sur le déclin de la protection des vaccins avec le
temps ainsi que sur l'innocuité et les possibles avantages des doses de
rappel des vaccins à ARNm. Dans le contexte du variant Delta, selon les
données
probantes dont nous disposons, l'efficacité du vaccin contre les
infections et les maladies symptomatiques, et possiblement aussi contre
les maladies graves, diminue avec le temps, surtout chez les personnes
d'un certain âge. Aucune préoccupation supplémentaire relative à
l'innocuité n'a été relevée
à la suite de l'administration de doses de rappel des vaccins à ARNm. Le
risque rare de myocardite et/ou de péricardite semble être plus faible
après la dose de rappel qu'après la deuxième dose de la série primaire -
quoique plus élevé qu'après la première dose. En fonction de cette
information, le
CCNI a augmenté la force de ses recommandations et affirme désormais
qu'une dose de rappel d'un vaccin à ARNm autorisé contre la COVID-19
devrait être administrée 6 mois ou plus après la fin d'une première
série de vaccins contre la COVID-19. »
Cependant, en octobre, les Nations unies et l'Organisation mondiale
de la santé ont déconseillé aux pays riches de procéder à des injections
de rappel, affirmant que cela se fait au détriment de l'accès aux
vaccins des pays plus pauvres.
(Avec des informations de ASPC, OMS)

Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le
président de l'Afrique du Sud ont récemment soulevé un point important :
la meilleure protection contre le COVID-19 et ses variants consiste à
s'assurer que les peuples du monde entier sont vaccinés. Les efforts
déployés par l'OMS
pour s'assurer que tous les pays reçoivent les vaccins dont ils ont
besoin, afin de limiter l'émergence de nouvelles variants, ont été minés
par le manque de coopération des pays qui ont des vaccins en réserve.
Le Canada et d'autres pays ont réagi au variant Omicron du coronavirus
responsable de la
COVID-19, le dernier variant préoccupante, en imposant des restrictions
de voyage à plusieurs pays, dont la plupart se trouvent en Afrique
australe
Entretemps, les pays des peuples opprimés, anciennement colonisés et
ceux qui sont victimes de l'agression impérialiste et de la guerre ont
été laissés à eux-mêmes.
Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, lors d'une
conférence le 6 décembre à Dakar, au Sénégal, a condamné les nouvelles
restrictions imposées par l'Union européenne, le Royaume-Uni, les
États-Unis et d'autres pays à suite de la découverte du nouveau variant
Omicron initialement
repéré par des scientifiques sud-africains à la fin du mois de novembre,
disant qu'il s'agissait d'« apartheid vaccinal ».
« Vous vous demandez où est la science là-dedans. Ils nous ont
toujours dit de baser nos décisions sur la science, mais quand vient le
moment pour eux de le faire, ils ne le font pas », a-t-il expliqué.
Cyril Ramaphosa a aussi accusé ces nations d'avoir « accaparé les
vaccins », ajoutant : « La cupidité dont ils ont fait preuve est
décevante, surtout quand ils disent être nos partenaires. Nos vies en
Afrique sont tout aussi importantes que les vies en Europe, en Amérique
du Nord et partout
ailleurs . »
Le président sénégalais Mackay Sall a quant à lui prévenu que la
réaction des pays augmentait le risque que des pays ne divulguent pas
d'informations sur les variants de la Covid-19 dans le futur par crainte
de devoir faire face à des répercussions similaires.
Allocution du président sud-africain à la 8e réunion du Conseil de
facilitation du Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte
contre la COVID-19 (Accélérateur ACT)
Le 9 décembre, le président Ramaphosa a étoffé ses remarques du 5 décembre à la
8e réunion du Conseil de facilitation du Dispositif pour accélérer
l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19.
Il a notamment déclaré : « Depuis sa formation, le dispositif pour
accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 a fait des
progrès remarquables dans l'exécution de son mandat de rendre
disponibles aux pays les plus vulnérables les outils dont ils ont besoin
pour combattre cette
pandémie.
« La réunion d'aujourd'hui est aussi importante et nécessaire que la première.
« La pandémie de la COVID-19 est loin d'être terminée.
« Même avant l'émergence du nouveau variant Omicron, plusieurs pays
ont subi des hausses d'infections, d'hospitalisations et de décès.
« Comme l'ont démontré les événements des derniers jours, nous vivons
sous la menace de variants en mutation, qui ont le potentiel de faire
déferler d'autres dévastations sur nos communautés dans le monde entier.
« Nous ne savons pas encore si le variant Omicron se propage plus
facilement, si le variant augmente le risque d'infection, si le variant
cause des maladies plus graves, ou si les vaccins actuels sont efficaces
contre le variant.
« Et pourtant, plusieurs pays ont décidé d'isoler certains pays du continent africain.
« Nous devons être préoccupés que certaines décisions ne sont plus
fondées sur la science et ne sont pas prises sur la base de la
solidarité.
« Cette pandémie a montré comment nous réagissons à une crise véritablement mondiale.
« Elle a montré plusieurs lacunes et faiblesses.
« Mais nous pouvons et devons améliorer notre façon de répondre aux crises.
« La vie et le moyen de subsistance de milliards de personnes sont en jeu ici.
« Nous avons dit à plusieurs reprises que personne ne sera en
sécurité si nous ne protégeons pas nos populations vulnérables partout.
« Nous possédons en partie la solution : le Dispositif pour accélérer
l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 qui, s'il est pleinement
financé, fournirait aux pays à faible ou moyen revenu des vaccins, des
traitements, des tests et des ÉPI pour les travailleurs de la santé de
premières
lignes.
« Il y a deux leçons importantes à tirer de la situation actuelle.
« Premièrement, l'inégalité vaccinale est dangereuse mais elle est aussi tout à fait évitable.
« Après un an de campagne vaccinale la plus ambitieuse au monde,
aucun pays ne devrait souffrir de manquer d'un accès suffisant aux
vaccins.
« Et pourtant, sur les près de 7,5 milliards de doses de vaccins
contre la COVID-19 administrées de par le monde en date du mi-novembre,
71 % ont été administrées aux pays à revenu élevé et intermédiaire. «
Seulement 0,6 % ont été administrées aux pays à faible revenu.
« L'Afrique est la plus durement frappée par l'accès inéquitable à ces vaccins qui sauvent des vies.
« Deuxièmement, nous devons investir dans tous les aspects de la réponse à la pandémie.
« En plus de la vaccination, il faut des tests et la surveillance
génomique pour identifier les points chauds de la maladie et localiser
l'émergence de nouveaux variants.
« Il faut des traitements, y compris d'oxygène médicale, pour les personnes gravement atteintes de la COVID-19.
« Des traitements potentiellement efficaces sont en développement.
« Nous devons assurer que, dès qu'ils seront approuvés pour leur
sécurité et leur efficacité, ils soient également disponibles pour tous
les pays.
« Pour cette raison, nous réclamons toujours l'ADPIC [l'Accord sur
les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce de l'Organisation mondiale du commerce], même dans ses diverses
formes pouvant être négociées.
« Nous devons investir dans le renforcement des systèmes de santé
parce que les systèmes de santé sont ce qui transforment les vaccins en
campagnes de vaccination et les tests de dépistage en dépistage sur le
terrain.
« Nous avons besoin de recherche et de développement pour adapter nos
outils et garder une longueur d'avance sur le virus en mutation.
« Nous avons besoin du plein éventail de contre-mesures – que ce
soit les vaccins, les traitements, des systèmes de santé qui
fonctionnent, et de l'équipement de protection personnelle – pour
combattre la COVID-19 et sauver des vies.
« Et le monde a besoin de l'Accélérateur ACT pour que cela se produise.
« Cette initiative existe pour répondre à l'objectif le plus vital de tous : sauver des vies.
« Nous ne pouvons vaciller et j'aimerais ajouter que c'est un domaine dans lequel nous ne devons pas échouer.
« Il est donc nécessaire que les dirigeants mondiaux s'unissent pour
financer intégralement le nouveau Plan stratégique de l'Accélérateur ACT
pour que nous puissions sauver des vies, et pour que nous puissions
mettre fin à cette pandémie, pas seulement pour quelques-uns, mais pour
tous et toutes,
surtout dans les communautés les plus vulnérables. »
La mise en réserve des vaccins dans les pays européens
Une étude publiée le 18 novembre par la Plate-forme internationale de
responsabilisation par rapport à la COVID (PIR-COVID), intitulée «
Tenir le monde responsable : des actions urgentes requises pour combler
les écarts dans la réponse mondiale à la COVID-19 », confirme et
quantifie les
accusations voulant que les pays riches font des réserves de vaccins
contre la COVID-19. PIR-COVID est une initiative du Centre mondial
d'innovation en santé et de l'effort collaboratif de l'Université Duke.
PIR-COVID souligne que son plus récent rapport « s'attarde aux
objectifs de couverture vaccinale, qui ont été largement adoptés par les
dirigeants mondiaux mais en l'absence d'un plan d'action qui puisse
garantir sa mise en oeuvre. Se basant sur des données du compteur Launch and Scale
de recherche sur la COVID, de l'Équipe spéciale multilatérale de
dirigeants contre la COVID-19, et de l'OMS, nous trouvons que 82 pays
(notamment la plupart des pays à faible revenu et les pays africains) ne
réussiront pas à atteindre la couverture vaccinale de 40 % avant la fin
de 2021.
« Au niveau mondial, ce n'est pas une question d'approvisionnement
mais de distribution. L'augmentation de la production des vaccins contre
la COVID-19 au cours de cette année a été une réussite exceptionnelle ;
le monde fabrique maintenant près de 1,5 milliards de doses par mois.
Nous avons
suffisamment de doses pour vacciner beaucoup plus que 40 % de la
population dans chaque pays. Cependant, une grande part de ces réserves
est concentrée dans un nombre restreint de pays riches, qui en ont plus
que ce qui leur est nécessaire. Sur la base de données sur les taux de
réserves et de
vaccination, nous prévoyons que les pays du G7 et de l'UE auront
collectivement plus de 830 millions de doses en surplus à la fin de
2021. Entretemps, plusieurs pays sont aux prises avec des manques
importants de réserves. Pour les pays qui n'ont pas encore atteint la
couverture à 40 %, notre
analyse indique qu'un autre 1,05 milliards de doses sont requises pour
atteindre cet objectif. Suite aux livraisons attendues de COVAX [un
accès mondial et équitable aux vaccins contre la COVID-19] en novembre
et en décembre, le manque dans ces pays se chiffre à 650 millions de
doses. »

Cliquer pour agrandir
Le rapport souligne que les pays du G7 possèdent 1 618 765 480 doses
qui permettraient aux pays à faible ou moyen revenu d'atteindre le taux
mondial minimal de 40 %, mais à ce jour ils n'ont expédié que près de
319 millions de ces doses ou environ 20 % de leur engagement. Pour ce
qui est du
Canada, il s'est engagé à faire don de 51, 542 080 doses. De ce nombre,
seulement 10 % ont été expédiées.
Notamment, PIR-COVID souligne que « les pays à revenu élevé ont
continué de s'en tenir à l'objectif d'un taux de vaccination de 40 %
sans adopter des mesures d'envergure et d'urgence pour les atteindre de
façon réaliste. »
Ce rapport ne s'attarde qu'aux vaccinations et PIR-COVID affirme : «
De futures analyses cibleront la quantification des besoins et des
engagements envers le dépistage lié à la thérapeutique, la diagnostique,
l'oxygène, ainsi que l'état de préparation à venir. »
Pour lire le rapport de PIR-COVID dans son intégralité, cliquez ici.
Le manque d'accès fiable aux vaccins
Le 29 novembre, l'Union africaine, les Centres africains pour le
contrôle et la prévention des maladies, la Coalition pour l'innovation
de la préparation épidémique, Gavi (l'Alliance vaccinale), l'Unicef et
l'OMS ont émis une déclaration conjointe sur les dons de doses de vaccin
contre la
COVID-19 aux pays africains. Ils soulignent que les dons qui arrivent
présentement en Afrique sont problématiques. Ils affirment que « la
majorité des dons reçus jusqu'à présent étaient ponctuels et fournis
avec peu de préavis, et leur durée de conservation était courte. Il est
donc extrêmement
difficile pour les pays de planifier des campagnes de vaccination et
d'accroître leur capacité d'absorption. Pour atteindre des taux de
couverture plus élevés sur le continent, et pour que les dons soient une
source d'approvisionnement durable qui puisse compléter
l'approvisionnement provenant des
accords d'achat de l'AVAT et de COVAX, cette tendance doit changer.
« Les pays ont besoin d'un approvisionnement prévisible et fiable. Le
fait de devoir planifier à court préavis et d'assurer l'utilisation de
doses à courte durée de conservation augmente de façon exponentielle la
charge logistique de systèmes de santé déjà mis à rude épreuve. En
outre, ce type
d'approvisionnement ponctuel utilise des capacités – ressources
humaines, infrastructures, chaîne du froid – qui pourraient être
orientées vers un déploiement efficace et durable à long terme. Il
augmente aussi considérablement les risques de péremption lorsque des
doses dont la durée de
conservation est déjà courte arrivent dans le pays, ce qui peut avoir
des répercussions à long terme sur la confiance dans les vaccins.
« Les dons à COVAX, à l'AVAT et aux pays africains doivent être faits
de manière à permettre aux pays de mobiliser efficacement leurs
ressources nationales pour soutenir le déploiement et permettre une
planification à long terme afin d'augmenter les taux de couverture. Nous
demandons à la
communauté internationale, en particulier les donateurs et les
fabricants, de s'engager à l'égard de cet effort en adhérant aux normes
suivantes, à compter du 1er janvier 2022 :
« -quantité et prévisibilité : Les pays donateurs doivent s'efforcer
de libérer les doses données en grandes quantités et de manière
prévisible, afin de réduire les coûts de transaction. Nous reconnaissons
et saluons les progrès réalisés dans ce domaine, mais nous constatons
que la fréquence des
exceptions à cette approche impose un fardeau accru aux pays, à l'AVAT
et à COVAX.
- Mise en réserve : Ces doses ne doivent pas être mises en réserve,
afin d'accroître l'efficacité et de soutenir la planification à long
terme. Leur mise en réserve rend beaucoup plus difficile l'affectation
de l'approvisionnement sur la base de l'équité et la prise en compte de
la capacité
d'absorption de certains pays. Cela augmente également le risque que les
dons à courte durée de conservation mobilisent la capacité de la chaîne
du froid des pays – capacité qui n'est ensuite plus disponible lorsque
l'AVAT ou le COVAX allouent des doses à plus longue durée de
conservation dans le
cadre de leurs propres accords d'achat.
- Durée de conservation : Par défaut, les doses données devraient
avoir une durée de conservation d'au moins 10 semaines à leur arrivée
dans le pays, avec des exceptions limitées uniquement lorsque les pays
bénéficiaires indiquent leur volonté et leur capacité à absorber des
doses ayant une durée
de conservation plus courte.
- Préavis : Les pays bénéficiaires doivent être informés de la
disponibilité des doses données au moins quatre semaines avant leur
arrivée prévue.
- Temps de réponse : Toutes les parties prenantes doivent s'efforcer
de fournir une réponse rapide aux informations essentielles. Il s'agit
notamment des informations essentielles sur l'approvisionnement fournies
par les fabricants (volumes totaux disponibles pour les dons, durée de
conservation,
site de fabrication), de la confirmation de l'offre de dons par les
donateurs et de l'acceptation ou du refus des allocations par les pays.
Les informations de dernière minute peuvent encore compliquer les
processus, augmenter les coûts de transaction, réduire la durée de
conservation disponible et
augmenter le risque de péremption.
- Produits complémentaires : La majorité des dons reçus jusqu'à
présent ne comprenaient pas les fournitures nécessaires à la
vaccination, telles que des seringues et du diluant, et ne couvraient
pas non plus les frais de transport. Par conséquent, ces fournitures
doivent être achetées séparément,
ce qui entraîne des coûts, une complexité et des délais supplémentaires.
Les doses données devraient être accompagnées de tous les produits
complémentaires essentiels afin de garantir une allocation et une
absorption rapides. »

Le « Sommet pour
la démocratie » des États-Unis
- Kathleen
Chandler -
L'administration Biden a organisé son « Sommet pour la démocratie »
virtuel pour coïncider avec la Journée des droits de l'homme le 10
décembre. Le sommet a été présenté comme une occasion de « soutenir la
démocratie et de défendre les droits humains dans le monde ». Le
président américain Biden
a déclaré : « Nous rassemblons des dirigeants de plus de 100
gouvernements aux côtés de militants, de syndicalistes et d'autres
membres de la société civile, d'experts et de chercheurs de premier
plan, et de représentants du milieu des affaires [pour] faire équipe et
réaffirmer notre engagement
commun à améliorer nos démocraties. » Il s'agit notamment de diverses
organisations et personnes que les États-Unis financent et soutiennent
déjà au niveau international, comme la Communauté des démocraties et son
réseau de jeunes. Ce qui a toujours été appelé organisations non
gouvernementales est
désormais appelé organisations de la société civile (OSC).
La fiche d'information publiée par la Maison Blanche le 9 décembre
décrit ce que l'administration Biden a en tête. Elle indique que le
travail visant à « renforcer la démocratie et à faire progresser le
respect des droits humains » est une question de sécurité nationale pour
les États-Unis : «
L'Initiative présidentielle pour le renouveau démocratique représente un
accroissement significatif et ciblé des actions du gouvernement des
États-Unis visant à défendre, soutenir et développer la résilience
démocratique avec des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux
partageant les
mêmes idées. Au cours de l'année à venir, les États-Unis prévoient de
fournir jusqu'à 424,4 millions de dollars pour l'Initiative
présidentielle. »
Les États-Unis, dont la démocratie est en lambeaux, parlent de cinq
domaines de travail « essentiels au fonctionnement d'une gouvernance
transparente et responsable ». Ces domaines sont :
- Soutenir les médias libres et indépendants
- Lutter contre la corruption
- Soutenir les réformateurs démocratiques
- Faire progresser la technologie au service de la démocratie
- Défendre des élections et des processus politiques libres et équitables.
L'initiative est une farce compte tenu de l'état actuel de la
démocratie américaine, largement considérée comme un échec sur tous les
fronts, notamment en matière d'élections. De manière significative, aux
États-Unis même, ce que l'on appelle les institutions démocratiques ne
sont plus capables
de résoudre les conflits entre les forces en présence. En outre, étant
donné que les intérêts privés qui se sont emparés des pouvoirs de l'État
sont mondiaux, le discours actuel sur la représentation d'un « intérêt
national » ne correspond plus à la réalité. Les forces en présence se
livrent une
lutte acharnée pour affirmer que leur faction représente l'intérêt
national et que leurs rivaux commettent une trahison. Le Congrès est
tellement dysfonctionnel qu'il ne parvient pas à adopter un budget, qui
aurait dû être adopté en octobre dernier, et menace sans cesse de fermer
le gouvernement.
Ces menaces affectent des centaines de milliers de travailleurs
fédéraux, de personnes âgées, de mères, d'enfants et de chômeurs qui ont
besoin de paiements fédéraux comme la sécurité sociale pour simplement
survivre.
La Cour suprême a également été discréditée, considérée comme une
force politisée au service de l'une ou l'autre faction en lice, non
seulement en ce qui concerne le droit à l'avortement, mais aussi dans
d'autres domaines. Il y a aussi les conflits entre les États et le
gouvernement fédéral, sur
des questions comme l'immigration, les élections, etc. Puis il y a le
contrôle monopoliste et la corruption des médias existants, avec une
technologie de plus en plus utilisée par des forces comme Facebook et le
gouvernement lui-même pour intensifier les divisions et attiser les
passions au sein
de la population, tout en justifiant davantage de violence
gouvernementale, de détentions racistes, d'incarcération de masse et
plus encore.
C'est dans ce contexte de rivalité entre les factions au pouvoir,
d'institutions discréditées et dysfonctionnelles et d'un mouvement
grandissant des peuples qui revendiquent leurs droits et un plus grand
contrôle, que l'initiative de Biden est présentée. Joe Biden s'efforce
d'unir ce qu'il
appelle « nous tous », derrière la présidence et au-delà des séparations
habituelles entre les pays, les niveaux de gouvernement et les peuples
qui s'organisent pour affirmer les droits humains. À titre d'exemple,
des maires des États-Unis et d'ailleurs ont été réunis, en contournant
les forces des
niveaux étatique, provincial et fédéral. Les diverses responsabilités et
autorités doivent être écartées de manière à « rassembler » tous ceux
dont on peut dire qu'ils ont rejoint l'initiative du président.
Ce que les impérialistes entendent par soutenir les
médias libres et indépendants
L'USAID (Agence américaine pour le développement international) a
été désignée comme le principal instrument de financement d'un « Fonds
international pour les médias d'intérêt public, un nouveau fonds
regroupant plusieurs donateurs, conçu pour renforcer l'indépendance, le
développement et la
durabilité des médias indépendants, en particulier dans les contextes
fragiles et pauvres en ressources ». En outre, l'USAID fournira jusqu'à 5
millions de dollars « pour lancer un accélérateur de viabilité des
médias » et améliorer « la viabilité financière des médias indépendants
dans les marchés
des médias sous-développés et plus développés ».
L'idée même que les médias financés par le gouvernement américain
soient indépendants montre la grandeur du défi auquel est confrontée
l'imagination de Joe Biden. L'USAID est réputée au niveau international
pour financer les forces politiques les plus réactionnaires et pour
miner le développement
indépendant des économies. Il est clair que la question n'est pas
seulement le financement, mais aussi et surtout la mise en place des
diverses formes d'organisation qui ne sont plus secrètes mais manifestes
dans leur mission d'ingérence dans les affaires de divers pays. Les
médias officiels se sont
joints à l'administration Biden pour promouvoir des organismes tels que
la Central Intelligence Agency (CIA) et ses appendices de la « société
civile » comme des champions des droits humains et de la démocratie.
Seules une imagination et une présidence gravement déficientes peuvent
être détachées de
la réalité au point de penser que cela va se produire.
L'initiative appelle également à une « protection physique, numérique
et juridique des journalistes ». Cela comprend offrir à ceux qu'elle
considère comme des journalistes « une formation en matière de sécurité
numérique et physique, une prise en charge psychosociale, une aide
juridique et
d'autres formes d'assistance ». Étant donné l'exigence de départ que
tous soutiennent ce que les États-Unis déclarent être des « valeurs
démocratiques », cela fait de tout journaliste qui expose les crimes de
génocide, les guerres d'agression et la torture des États-Unis tout en
élaborant des droits
une persona non grata. Ce programme met ainsi en danger tous ceux qui se
considéraient jusqu'à présent comme des membres de bonne foi d'une
société civile. Seuls les réactionnaires doivent postuler à des emplois
et seuls les réactionnaires les conserveront. Les États-Unis trouveront
ainsi une
justification supplémentaire pour s'ingérer dans les affaires
intérieures d'autres pays et pour financer et aider ceux qui participent
à leurs efforts de changement de régime.
Le « Sommet pour la démocratie » pose le problème de la démocratie
comme une opposition entre ce qu'il considère comme le sommet de la
démocratie – le système raciste et misogyne des États-Unis basé sur
l'oppression et l'exploitation – et ce qu'il appelle les « autocraties
». Toute discussion sur
la démocratie qui va au coeur du sujet est taboue. Seule la
désinformation qui cible les efforts des peuples pour donner une
garantie aux réclamations qu'ils sont en droit de faire à la société est
considérée comme valable.
Lutter contre la corruption et soutenir
les réformateurs démocratiques
Sous la rubrique de « soutien aux agents de changement dans la
lutte contre la corruption », 5 millions de dollars serviront à «
soutenir et mettre en relation les acteurs de la lutte contre la
corruption au sein de la société civile, des médias, du monde
universitaire et des organisations
syndicales ». Cinq autres millions de dollars serviront à promouvoir «
des mesures de protection des lanceurs d'alerte, des activistes de la
société civile, des journalistes et d'autres personnes en danger en
raison de leur travail de lutte contre la corruption » et six millions
de dollars serviront
à « mettre en liaison les médias et les organisations de la société
civile ».
La demande de protection des dénonciateurs intervient à un moment où
les États-Unis ont réussi à obtenir l'extradition de Julian Assange de Grande-Bretagne vers
les États-Unis et à emprisonner d'autres personnes qui ont exposé les
crimes des États-Unis, en invoquant l'espionnage. Il s'agit d'un
indicateur clair de
la façon dont les États-Unis décideront qui est et n'est pas un « acteur
de la lutte contre la corruption », tout en utilisant la corruption des
fonds de l'USAID pour essayer d'unir « la société civile, les médias,
le monde universitaire et les organisations syndicales ». Tous avaient
des
représentants participant au sommet sous diverses formes.
En outre, des millions de dollars supplémentaires seront alloués à «
une plateforme de partenariat pour trouver des solutions participatives
innovantes auprès d'entreprises, de technologues, de philanthropies et
d'autres acteurs » afin « de dynamiser et d'institutionnaliser
l'engagement existant
du secteur public dans la lutte contre la corruption avec le monde des
affaires ». Il semble également qu'au nom de la lutte contre la
corruption des efforts seront faits pour augmenter le contrôle financier
à l'échelle internationale. Combattre la corruption par la corruption
fait partie de
l'arsenal des guerres de territoire mafieuses, et c'est en fait ce qui
se passe aux niveaux gouvernementaux aux États-Unis et, par extension,
au Canada également. Avec des réformes et des initiatives telles que
celles
décrites dans le « Sommet pour la démocratie », les conflits entre ceux
qui rivalisent pour le pouvoir aux États-Unis ne peuvent que poser
davantage de dangers pour les peuples des États-Unis et du monde.
L'institutionnalisation des différents partenariats et la mise en
place de moyens intégrés sous le commandement des pouvoirs exécutifs
américains visent à placer les fonctions du gouvernement, du secteur
public et de la « société civile » sous l'emprise d'intérêts privés
étroits. Rien de plus et
rien de moins ne fera l'affaire en ce qui concerne ces pouvoirs
exécutifs.
Ceci est encore plus évident dans la section intitulée « Soutenir les
réformateurs démocratiques ». Le langage et les demandes de droits
formulés dans le monde entier sont utilisés pour confondre la résistance
et l'amener à soutenir la soi-disant initiative démocratique. Il s'agit
notamment de «
renforcer l'autonomie des groupes historiquement marginalisés et veiller
à ce que tous aient leur mot à dire dans la démocratie », ainsi que de
cibler les femmes, les filles et la communauté LGBTQI+. Le secrétaire
d'État Anthony Blinken s'est exprimé en ces termes : « Nos démocraties
dépendent de
leur réussite et la réussite dépend de la participation d'un plus grand
nombre de jeunes – en votant, en se présentant aux élections, en
s'impliquant dans la vie civique, en améliorant nos démocraties ».
Dans cette veine, il y a une section « Soutenir les activistes, les
travailleurs et les dirigeants réformateurs » et une autre intitulée «
Initiative ‘Bridging Understanding, Integrity, and Legitimacy for
Democracy (BUILD)' ». « BUILD » fait référence au slogan de Biden «
Build Back Better »
(reconstruire en mieux) et est ouvertement destiné à des fins
d'ingérence pour « poser les bases pour fournir aux professionnels de
carrière dans des espaces politiques fermés les compétences et les
ressources nécessaires pour tirer parti des ouvertures démocratiques
lorsqu'elles se produisent
».
Un autre volet de l'initiative présidentielle comprend l'octroi par
USAID de 15 millions de dollars pour l'initiative « Powered by the
People » (animé par le peuple), qui est spécifiquement conçue pour
déstabiliser les vastes mouvements sociaux pour l'égalité, la justice et
les droits. Elle vise
à intervenir dans « les mouvements sociaux non violents en renforçant la
coordination par le biais d'échanges, de subventions de démarrage et
d'engagement avec des acteurs prodémocratie plus jeunes ».
Un des engagements les plus importants du point de vue financier,
soit l'octroi de 122 millions de dollars provenant des départements du
Travail et d'État et de l'USAID, permettra « d'établir un partenariat
multilatéral pour l'organisation, l'octroi de pouvoir aux travailleurs
et les droits
(M-POWER) ». Ce partenariat est censé « aider les travailleurs du monde
entier à faire valoir leurs droits et à améliorer les salaires ainsi que
les conditions de travail, en renforçant les organisations de
travailleurs démocratiques et indépendantes et en soutenant la réforme
et l'application du
droit du travail ».
Il est clair que les États-Unis craignent le mouvement grandissant de
résistance organisée des travailleurs et leurs nombreuses luttes pour
le changement qui cherchent à résoudre la crise en faveur des intérêts
du peuple. L'hypocrisie de l'initiative est mise en évidence par le fait
que les
millions d'infirmières aux États-Unis et dans le monde réclament des
conditions de travail sécuritaires et des soins de santé pour tous, dont
des dizaines de milliers sont en grève présentement. « L'application du
droit du travail » est inexistante. Loin d'avoir pour objectif de
donner du pouvoir au
peuple, il s'agit de créer des formes d'organisation qui éliminent
l'état de droit et les normes existantes et d'institutionnaliser l'ordre
américain fondé sur des règles où l'exécutif décide seul des règles. La
classe ouvrière américaine ne sera jamais d'accord avec cela, et les
peuples du monde
non plus. Les tentatives de prétendre que ces mesures sont une
alternative aux guerres de destruction et d'occupation sont carrément
stupides.
Faire progresser la technologie au service de la démocratie
L'utilisation et la restriction de l'Internet est un autre
domaine abordé par l'Initiative présidentielle. Cette section mentionne à
plusieurs reprises le besoin de « concrétiser les avantages des
technologies numériques qui soutiennent les valeurs démocratiques et
respectent les droits humains,
plutôt que les compromettre ». Là encore, c'est l'exécutif qui
déterminera qui est dans le tort et qui est dans le droit. Des pays
comme Cuba, le Venezuela, l'Iran et la République populaire démocratique
de Corée sont déjà des cibles parce que, selon les États-Unis, elles
minent les « valeurs
démocratiques ». L'USAID va maintenant fournir jusqu'à 20,3 millions de
dollars pour « s'appuyer sur la programmation soutenant les écosystèmes
numériques ouverts, sécurisés et inclusifs. Cette programmation aidera
les gouvernements à inscrire les principes démocratiques dans
l'utilisation, le
développement et la gouvernance des technologies dans leur pays, tout en
permettant à la société civile, aux technologues et au secteur privé de
les encourager. »
Les États-Unis sont habités par la croyance en leur propre
supériorité. Ils sous-estiment donc toujours la créativité et les
capacités des peuples libres à les surpasser dans de nombreux domaines.
Toujours dans le but de justifier davantage l'intervention dans les
affaires des autres pays, l'« Initiative » appelle également à « se
défendre contre l'autoritarisme numérique ». Cette initiative est censée
« réduire le risque de violation des droits humains que permettent
certaines
technologies à double usage » et laisse présager une guerre brutale pour
le contrôle de l'espace. Dans ce contexte, à l'issue du sommet, les
États-Unis, l'Australie, le Danemark et la Norvège ont annoncé
l'initiative « Contrôle des exportations et les droits humains » visant
tous ceux qui ne se
rallient pas à la « vision des technologies ancrées dans les valeurs
démocratiques » définie par les États-Unis. Les quatre pays ont été
rejoints par le Canada, la France, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne.
Cette initiative de « contrôle des exportations » est censée s'attaquer à
la «
cyberintrusion, à la surveillance et à d'autres technologies à double
usage » qui sont « utilisées à mauvais escient pour étouffer la
dissidence, harceler les défenseurs des droits humains, intimider les
communautés minoritaires, décourager les dénonciateurs, refroidir la
liberté d'expression,
cibler les opposants politiques, les journalistes et les avocats, ou
interférer arbitrairement ou illégalement dans la vie privée ».
Tout cela sert à souligner que la bataille pour la démocratie et la bataille de la démocratie ont vraiment éclaté au grand jour.
Défendre des élections et des processus politiques
libres et équitables
Comme pour le reste de l'« Initiative », les États-Unis sont
tellement discrédités sur le front électoral que peu de gens prêtent
attention à leurs prétentions. En fait, la plupart s'en moquent, sachant
qu'elles sont, au mieux, creuses. Néanmoins, Joe Biden affirme que le
droit de voter, de
voter librement, est « sacré ». « Le droit de voir son vote compté est
le seuil de la liberté pour la démocratie, pour toute démocratie. Avec
ce droit, tout est possible. Sans lui, pratiquement rien n'est possible
», a-t-il déclaré. Ses efforts pour intégrer « la société civile, les
médias, le monde
universitaire et les organisations syndicales » visent tous à miner la
résistance et à institutionnaliser la domination sous les pouvoirs
exécutifs directs des États-Unis.
Cette institutionnalisation doit fournir jusqu'à 17,5 millions de dollars pour créer un «
Fonds de défense des élections démocratiques » afin de « piloter,
d'élargir et d'appliquer des réponses factuelles aux menaces à
l'intégrité électorale et aux processus politiques connexes dans le
monde entier. Ce Fonds
s'attaquera à des problèmes tels que la cybersécurité, la manipulation
électorale nationale et étrangère, la violence électorale, y compris la
violence basée sur le genre, le financement politique national et
étranger illicite, la désinformation liée aux élections et les obstacles
à la participation
politique des populations marginalisées. »
Bien que cela ne s'adresse pas seulement aux forces à l'étranger mais
aussi à l'intérieur des États-Unis, il est difficile de concevoir
comment les élections, qui ne servent plus à résoudre les conflits entre
les factions en présence mais les intensifient, vont miraculeusement
servir à unir les
intérêts divergents ou à éliminer les divergences. Ce qui est évident,
cependant, c'est que dans le grand schéma des choses, 17,5 millions de
dollars, ce n'est pas beaucoup d'argent, ce qui signifie que des pays
comme le Canada sont censés utiliser leurs propres pouvoirs exécutifs
pour imposer la
même chose dans les domaines qui relèvent de leurs compétences.
L'ensemble de l'« Initiative » est un effort grossier et désespéré
pour faire face à la résistance et au rejet croissant, dans le monde
entier, des institutions démocratiques libérales anglo-américaines
existantes. Pour y parvenir, « deux nouveaux programmes transversaux de
réponse rapide »
seront également développés.
Le premier, « Prouver que la démocratie tient ses promesses » pour
les pays « en transition démocratique », fournira 55 millions de dollars
pour lancer des « Partenariats pour la démocratie ». Ce programme est
censé permettre aux États-Unis de « renforcer l'assistance
intersectorielle aux
gouvernements réformateurs partenaires, afin de les aider à produire des
bénéfices visibles pour leurs populations dans des domaines tels que
les soins de santé et l'éducation ».
Le second, destiné au « renforcement de l'état de droit, la lutte
contre la corruption, le renforcement de la sécurité civile et la
promotion des droits humains », est le « Fonds pour le renouveau
démocratique (FDR) ». Ce « fonds d'intervention rapide et flexible
permettra aux bureaux du
département d'État » de « réagir de manière collective et collaborative
pour soutenir les partenaires qui travaillent sur les lignes de front de
la démocratie ».
Le mot « partenaires » fait référence à une variété de forces en
dehors des gouvernements existants. La pauvreté de leur matière
intellectuelle est telle que tous les efforts sont faits pour diriger
l'attention vers le passé, vers « l'Alliance pour le progrès » de
Kennedy et le « New Deal » de
Franklin Delano Rosevelt. Il s'agit d'une tentative futile de cacher ce
qui ne peut l'être, à savoir que la sécurité et l'avenir du monde sont
dans la volonté des peuples de s'émanciper. Décrire l'échec et le
dysfonctionnement de la démocratie et des valeurs de type américain est
une perte de temps
et d'efforts. Leur prétention à garantir les droits humains des peuples
dans leur pays et à l'étranger est creuse. Tous les efforts devraient
être dirigés vers la satisfaction des demandes de l'époque pour que les
peuples eux-mêmes gouvernent et décident.

Le succès revigorant des fermiers
indiens
- J.
Singh -

 Le 11 décembre, par centaines de milliers, les fermiers indiens ont entrepris la marche du Fateh (de la Victoire), revenant des morchas (campements)
pour regagner leurs demeures après avoir remporté un succès historique. Le 11 décembre, par centaines de milliers, les fermiers indiens ont entrepris la marche du Fateh (de la Victoire), revenant des morchas (campements)
pour regagner leurs demeures après avoir remporté un succès historique.
Le contingent pendjabi avance de façon unitaire, en
procession. Des gens des deux côtés des routes ont installé des langars (des cuisines mobiles) et des fleurs sont lancées des avions et des maisons. Des remorques des tracteurs, les chants de la Morcha jouent à plein volume : Zindabad, Faslan De Fiasle Kisan Karuga (Les
fermiers contrôleront ce qu'ils produisent). Les couleurs sont vives. Les Nihangs,
à cheval, brandissent leurs armes traditionnelles ; les femmes portent
leurs vêtements les plus colorés ; les chariots bondés de monde se
frayent un chemin dans la mer humaine dans cette marche triomphale de
retour à la maison. Le son des Gurbani est partout. Des robes
bleues, des drapeaux safran, verts, jaunes, rouges et bleus – les
couleurs des fermiers, sont partout. Des cris de Bole So Nihal, Sat Sri Akal (gloire à la Victoire) résonnent. Les trompettes éclatent et les percussions
battent la mesure. Sur la route, les gens dansent le Bhangra et le Giddha
sous les drapeaux des fermiers qui battent au vent. Des affiches à
l'effigie de Banda Singh Bahadur, Guru Nanak, Guru Gobind Singh, Kartar
Singh Sarabha et Bhagat Singh sont hissées tandis qu'aînés et jeunes
dansent ensemble au rythme de la caravane.
Le 13 décembre, la Marche de la victoire s'arrêtera au Temple d'Or à
Amritsar pour l'offrande de prières et de remerciements. Les Pendjabis
l'appellent le 20e Delhi Fateh – la victoire sur Dehli. Entre
1716 et 1799, les Pendjabis ont assujetti Delhi 19 fois. Un orateur
après l'autre a
souligné à quel point le président Modi et d'autres ministres faisaient
preuve d'arrogance en croyant qu'ils pouvaient imposer leur volonté au
Pendjab. L'unité des fermiers a fait sauter leur arrogance et les a
assujettis. Arde So Jharde (L'arrogance s'effrite) est un
dicton souvent utilisé
au Pendjab. Il rappelle ce que le dirigeant Hardial Bains avait prédit
en 1985 : que le jour viendrait où les Pendjabis marcheraient sur Delhi,
le forceraient à se soumettre à leurs réclamations et ouvriraient une
nouvelle voie pour le peuple partout en Inde. Il a dit que ce sera une
nouvelle
Bataille de Panipat dans de nouvelles conditions et avec de nouvelles
formes. Depuis 1526, Panipat est décisif dans le destin de l'Inde.
 Le
15 décembre, toutes les agitations des fermiers seront suspendues
partout en Inde jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué de presse du 9
décembre 2021, l'organisme cadre Sanyukta Kisan Morcha (SKM) a dit : «
SKM annonce officiellement notre réponse de lever les morchas
aux frontières de
Delhi sur les autoroutes nationales et à dans divers autres endroits.
Les agitations actuelles sont suspendues. La bataille a été remportée ;
la guerre pour assurer les droits des fermiers, elle, se poursuit. » Le
15 décembre, toutes les agitations des fermiers seront suspendues
partout en Inde jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué de presse du 9
décembre 2021, l'organisme cadre Sanyukta Kisan Morcha (SKM) a dit : «
SKM annonce officiellement notre réponse de lever les morchas
aux frontières de
Delhi sur les autoroutes nationales et à dans divers autres endroits.
Les agitations actuelles sont suspendues. La bataille a été remportée ;
la guerre pour assurer les droits des fermiers, elle, se poursuit. »
SKM se réunira le 15 janvier 2022 pour décider des actions à venir et
évaluer la situation pour ce qui est des négociations avec le
gouvernement central.
Des célébrations sont organisées partout dans le monde alors que les
membres des communautés indiennes et leurs amis fêtent le succès de la
lutte des fermiers. En plus des discours, des chansons et des slogans,
les orateurs ont hâte aux annonces du SKM pour planifier les futures
activités.
Plusieurs s'en prennent aussi aux médias monopolisés qui ont dépeint
les fermiers comme des terroristes, des extrémistes et des éléments
marginaux. Les fermiers ont dit que non seulement ils ont obtenu ce
qu'ils réclamaient, mais ils ont conquis le coeur du peuple dans
l'Haryana, dans l'Uttar
Pradesh, dans le Madhya Pradesh, au Pendjab et dans toute l'Inde, où,
selon les médias, les gens ne seraient que des fanatiques du BJP, des
arriérés qui se préoccupent peu du sort de leurs confrères dans le nord.
Cette désinformation véhiculée jour et nuit par la classe dirigeante a
été contredite
par les faits.
Des jeunes poètes et des chanteurs ont exprimé par leurs nouvelles chansons ce que le peuple ressent :
Soyez vigilants, la lutte des fermiers n'est pas terminée
Veillez à ce que nos sacrifices ne soient pas détournés au profit de votes aux élections
Pensez à pourquoi les dirigeants vous jettent du sable aux yeux
Pourquoi les politiciens jouent avec votre sort
Rappelle-toi de tout à ton retour
Ceux pour qui tu as voté t'ont trahi
Ne te fais de souci Baba pour les conditions
Cette terre fertile produira toujours des combattants
Notre mot d'ordre est l'unité fermier-travailleur
Vous serez forcés de dire Zindabad
Notre unité sonne le glas des dirigeants
Les fermiers décideront de ce qu'ils produisent.

(Pour voir les articles individuellement, cliquer sur le titre de l'article.)
PDF
ARCHIVES
| ACCUEIL
Site Web: www.pccml.ca
Courriel: redaction@cpcml.ca
|

 Le
manque de pertinence du Parlement du Canada dans la prise de décisions
importantes qui affectent l'avenir du pays est parfaitement évident à
l'approche de la fin des travaux de la Chambre des communes et du Sénat
le vendredi 17 décembre, 20 jours après l'ouverture de la législature.
Il est de
plus en plus difficile de voir dans les délibérations du Parlement
canadien, qui est censé être un organe décisionnel, un but autre que
d'être le lieu des querelles partisanes et des jeux de surenchère,
lesquels ne font que discréditer davantage les partis cartellisés et le
système de gouvernement
de parti. Il y a absence de toute délibération sérieuse, sur quelque
sujet que ce soit. Les problèmes urgents auxquels sont confrontés la
population et le corps politique ne figurent pas à l'ordre du jour : de
la crise climatique à la détérioration et à la précarité des conditions
économiques qui
voient l'utilisation des banques alimentaires monter en flèche et les
travailleurs être traités comme des objets jetables, en passant par
l'escalade de la violence contre les plus vulnérables et le déni des
droits ancestraux des peuples autochtones, sans oublier l'instabilité de
la situation
internationale et la place qu'y occupe le Canada en tant que membre de
l'OTAN.
Le
manque de pertinence du Parlement du Canada dans la prise de décisions
importantes qui affectent l'avenir du pays est parfaitement évident à
l'approche de la fin des travaux de la Chambre des communes et du Sénat
le vendredi 17 décembre, 20 jours après l'ouverture de la législature.
Il est de
plus en plus difficile de voir dans les délibérations du Parlement
canadien, qui est censé être un organe décisionnel, un but autre que
d'être le lieu des querelles partisanes et des jeux de surenchère,
lesquels ne font que discréditer davantage les partis cartellisés et le
système de gouvernement
de parti. Il y a absence de toute délibération sérieuse, sur quelque
sujet que ce soit. Les problèmes urgents auxquels sont confrontés la
population et le corps politique ne figurent pas à l'ordre du jour : de
la crise climatique à la détérioration et à la précarité des conditions
économiques qui
voient l'utilisation des banques alimentaires monter en flèche et les
travailleurs être traités comme des objets jetables, en passant par
l'escalade de la violence contre les plus vulnérables et le déni des
droits ancestraux des peuples autochtones, sans oublier l'instabilité de
la situation
internationale et la place qu'y occupe le Canada en tant que membre de
l'OTAN.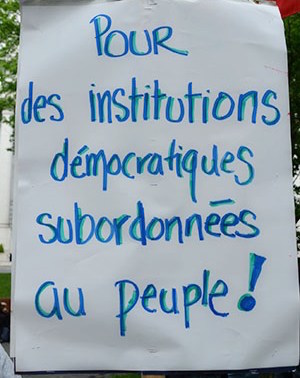 La
situation ne peut être expliquée par un penchant personnel, par le
narcissisme ou le manque de substance du premier ministre. L'explication
se trouve dans les structures mêmes du système démocratique dominé par
les partis, qui n'est tout simplement pas représentatif du peuple, car
il
représente des intérêts privés étroits qui sont habilités à dominer et à
maintenir le peuple sous contrôle. L'état de décrépitude de toutes les
institutions, structures et agences de la société civile, qui sont
censées représenter la société civile – depuis les partis cartellisés jusqu'aux notions
de responsabilité ministérielle qui ne sont plus pratiquées –, fait en
sorte que le discours politique a disparu pour être remplacé par une
chasse aux scandales qui mène dans des voies sans issue. Tout cela pour
détourner l'attention des enjeux qui sont devenus les plus importants
aujourd'hui : par
qui sont prises les décisions et comment obliger les forces corrompues
qui prennent ces décisions dans leurs propres intérêts à rendre des
comptes.
La
situation ne peut être expliquée par un penchant personnel, par le
narcissisme ou le manque de substance du premier ministre. L'explication
se trouve dans les structures mêmes du système démocratique dominé par
les partis, qui n'est tout simplement pas représentatif du peuple, car
il
représente des intérêts privés étroits qui sont habilités à dominer et à
maintenir le peuple sous contrôle. L'état de décrépitude de toutes les
institutions, structures et agences de la société civile, qui sont
censées représenter la société civile – depuis les partis cartellisés jusqu'aux notions
de responsabilité ministérielle qui ne sont plus pratiquées –, fait en
sorte que le discours politique a disparu pour être remplacé par une
chasse aux scandales qui mène dans des voies sans issue. Tout cela pour
détourner l'attention des enjeux qui sont devenus les plus importants
aujourd'hui : par
qui sont prises les décisions et comment obliger les forces corrompues
qui prennent ces décisions dans leurs propres intérêts à rendre des
comptes.


 Une
semaine plus tard, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il étendait ses
sanctions dites ciblées à onze autres personnes liées à l'État et au
gouvernement du Nicaragua, prétendument pour violations des droits
humains. Le Canada suit en cela l'exemple du Congrès américain qui,
quelques jours
avant les élections, a adopté la Loi RENACER (Reinforcing
Nicaragua's Adherence to Conditions for Electoral Reform) pour renforcer
ses mesures coercitives unilatérales dans une tentative évidente
d'influencer les élections. La loi des États-Unis exige expressément une
meilleure coordination
de ces mesures avec l'Union européenne et le Canada.
Une
semaine plus tard, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il étendait ses
sanctions dites ciblées à onze autres personnes liées à l'État et au
gouvernement du Nicaragua, prétendument pour violations des droits
humains. Le Canada suit en cela l'exemple du Congrès américain qui,
quelques jours
avant les élections, a adopté la Loi RENACER (Reinforcing
Nicaragua's Adherence to Conditions for Electoral Reform) pour renforcer
ses mesures coercitives unilatérales dans une tentative évidente
d'influencer les élections. La loi des États-Unis exige expressément une
meilleure coordination
de ces mesures avec l'Union européenne et le Canada.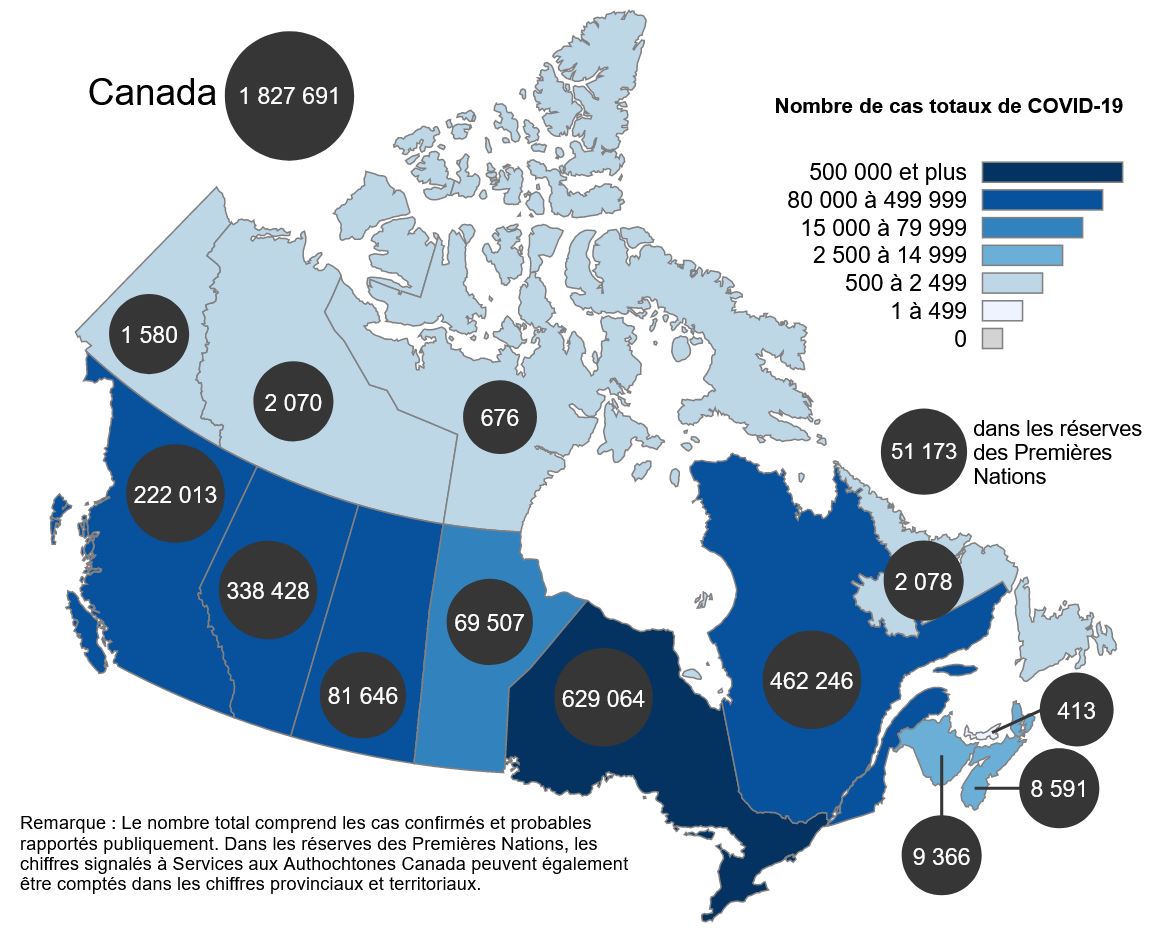
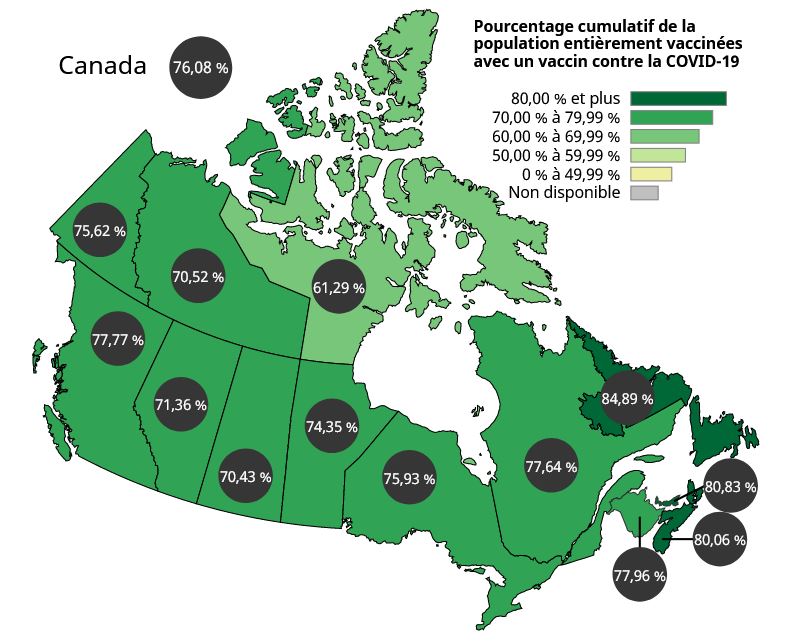
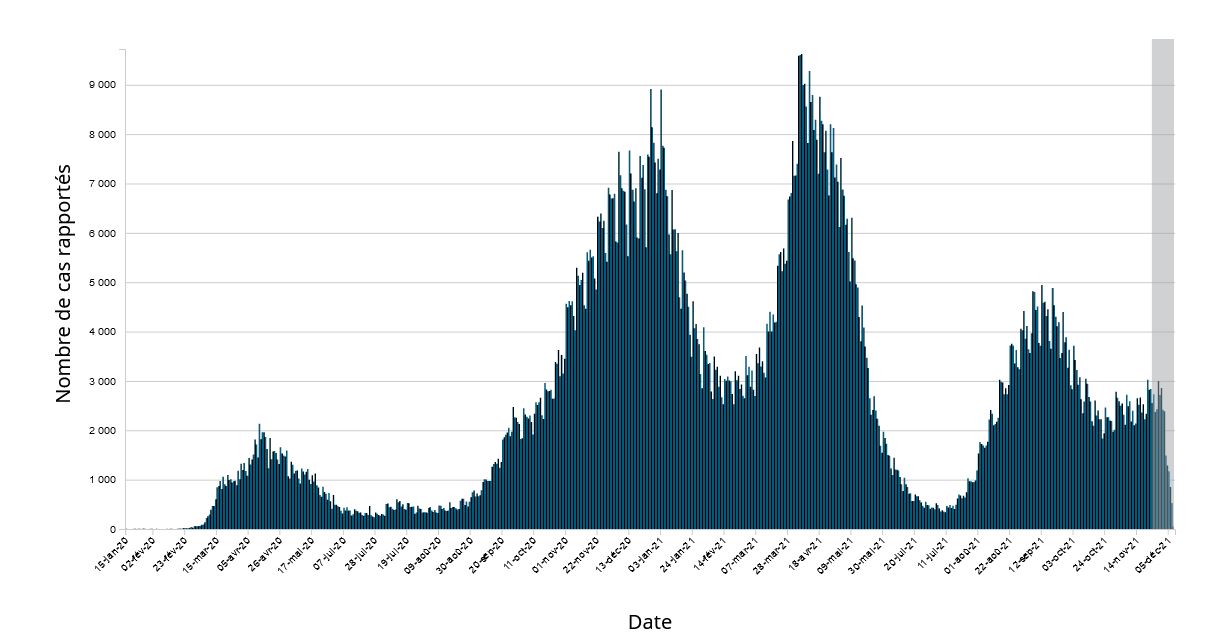
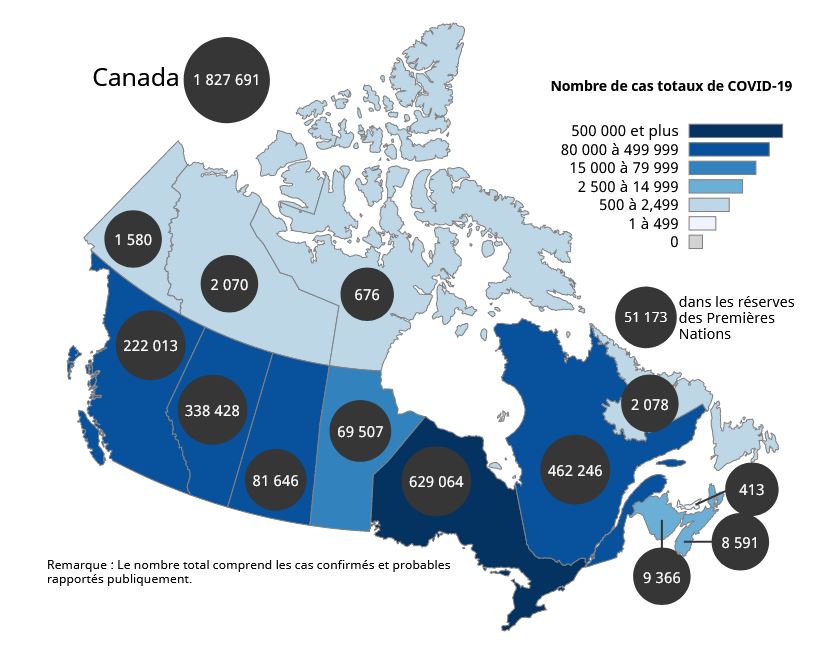


 Le 11 décembre, par centaines de milliers, les fermiers indiens ont entrepris la marche du Fateh (de la Victoire), revenant des morchas (campements)
pour regagner leurs demeures après avoir remporté un succès historique.
Le 11 décembre, par centaines de milliers, les fermiers indiens ont entrepris la marche du Fateh (de la Victoire), revenant des morchas (campements)
pour regagner leurs demeures après avoir remporté un succès historique.
 Le
15 décembre, toutes les agitations des fermiers seront suspendues
partout en Inde jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué de presse du 9
décembre 2021, l'organisme cadre Sanyukta Kisan Morcha (SKM) a dit : «
SKM annonce officiellement notre réponse de lever les morchas
aux frontières de
Delhi sur les autoroutes nationales et à dans divers autres endroits.
Les agitations actuelles sont suspendues. La bataille a été remportée ;
la guerre pour assurer les droits des fermiers, elle, se poursuit. »
Le
15 décembre, toutes les agitations des fermiers seront suspendues
partout en Inde jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué de presse du 9
décembre 2021, l'organisme cadre Sanyukta Kisan Morcha (SKM) a dit : «
SKM annonce officiellement notre réponse de lever les morchas
aux frontières de
Delhi sur les autoroutes nationales et à dans divers autres endroits.
Les agitations actuelles sont suspendues. La bataille a été remportée ;
la guerre pour assurer les droits des fermiers, elle, se poursuit. »