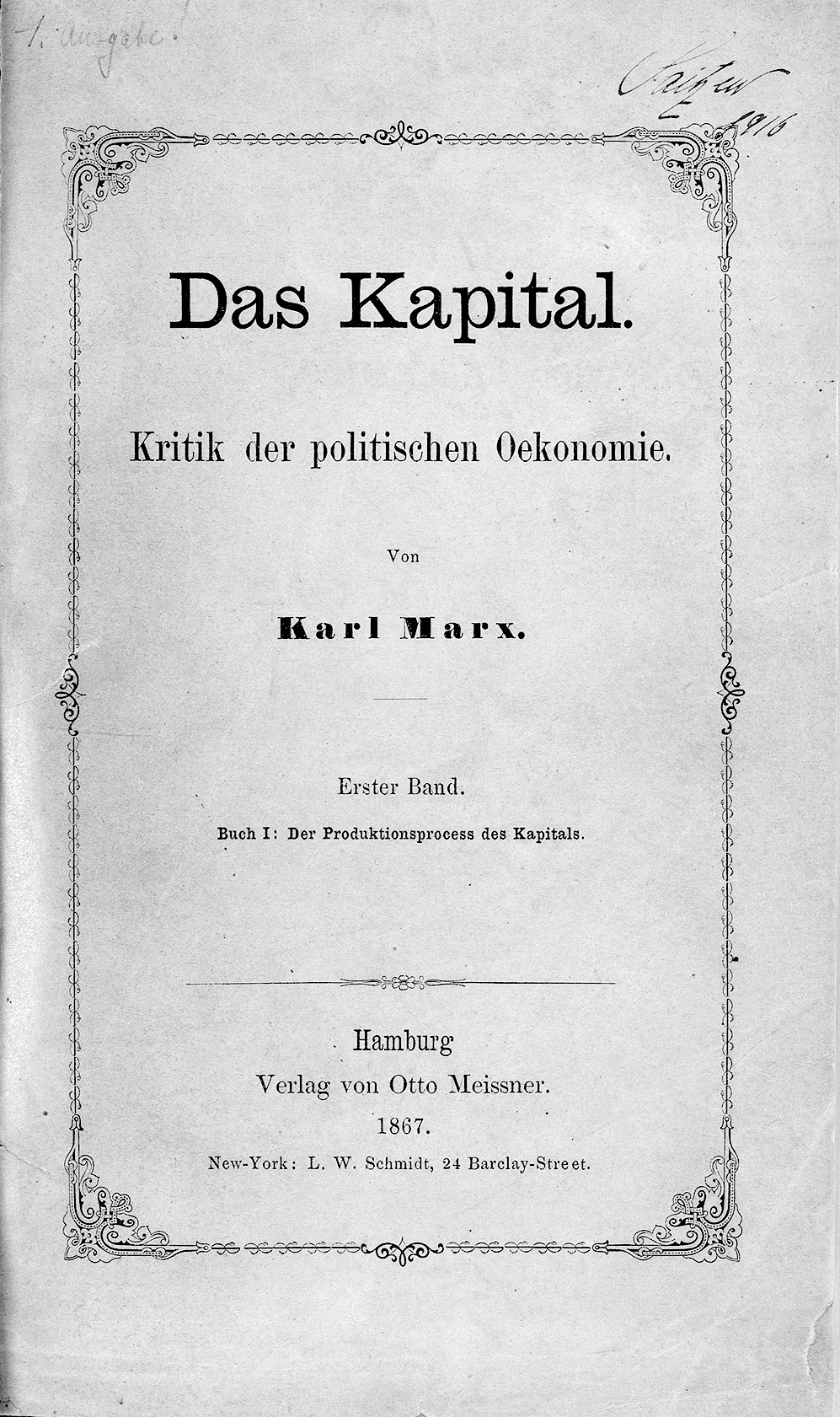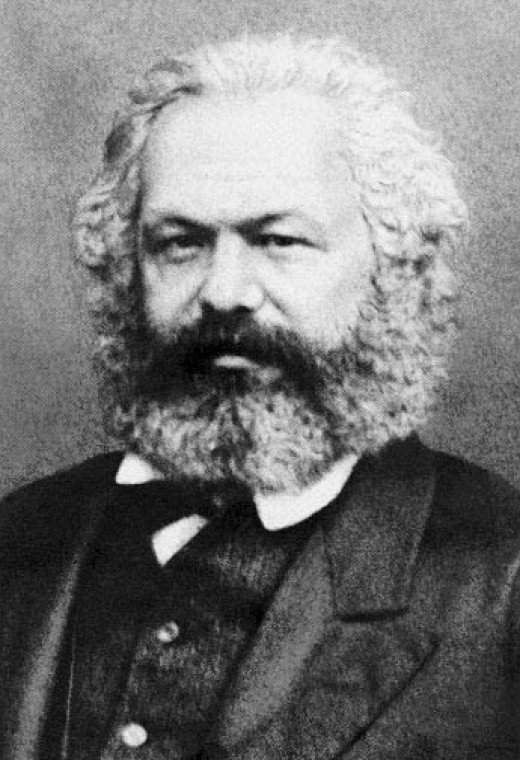|
Numéro 37 - 16 septembre 2017
Supplément
150e anniversaire de la publication du
tome I du Capital le 14
septembre 1867-
PDF
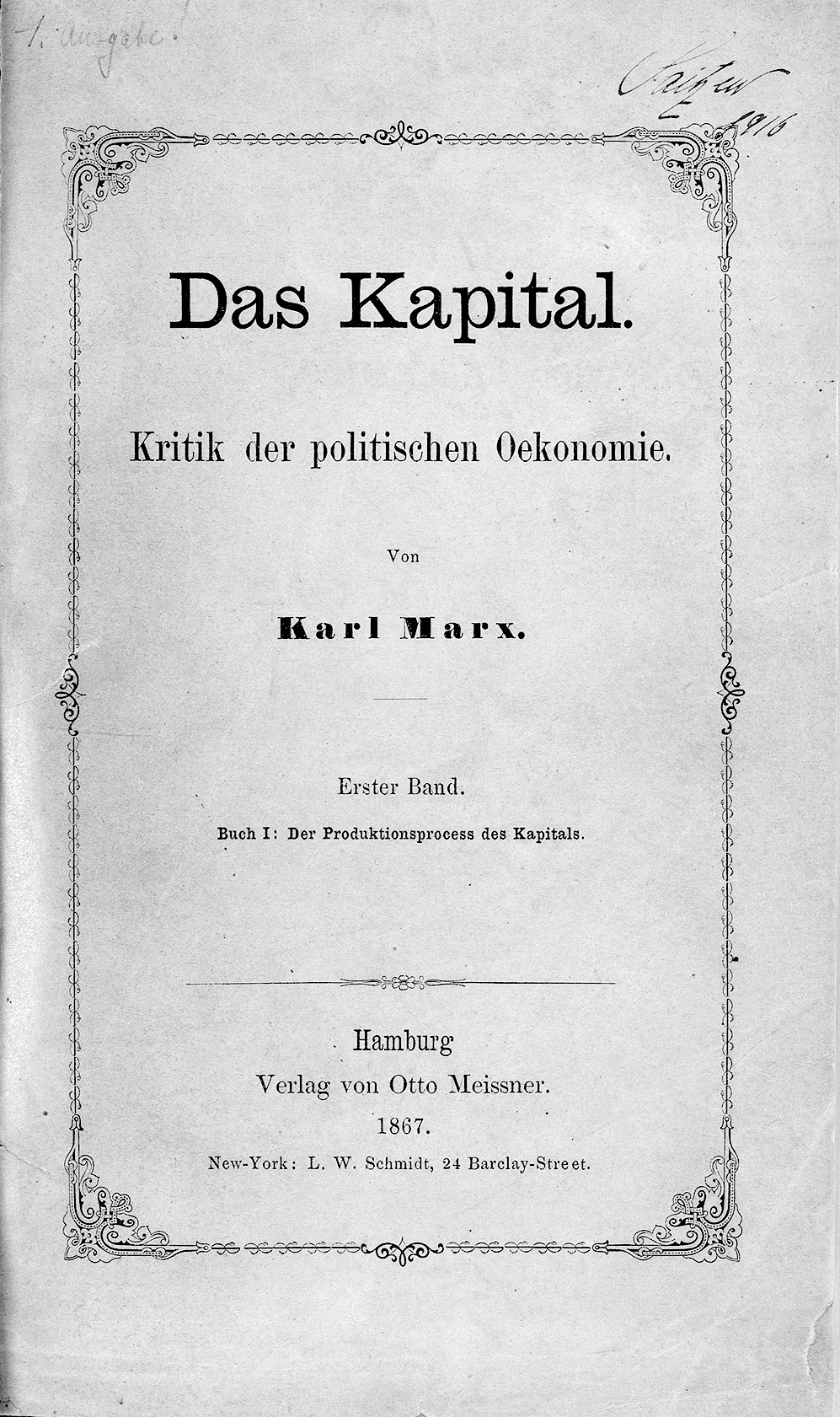 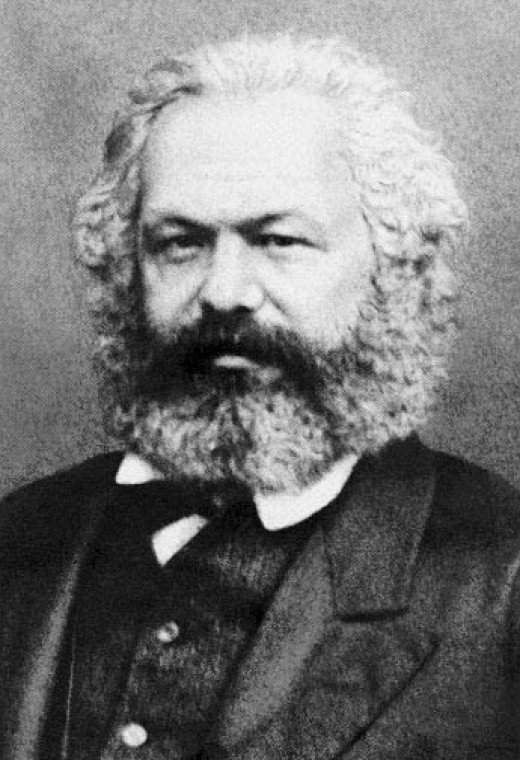
Das Kapital et son auteur Karl Marx en 1869
150e
anniversaire
de
la
publication
du tome I du Capital le 14 septembre 1867
• Les trois sources et les trois parties
constitutives du marxisme - Lénine
• La théorie marxiste de la plus-value
conserve encore toute sa valeur
- Hardial Bains
150e anniversaire de la publication du
tome I du Capital le 14 septembre 1867
Les trois sources et les trois parties
constitutives du marxisme
- Lénine -
La doctrine de Marx suscite, dans l'ensemble du monde
civilisé, la plus grande hostilité et la haine de toute
la science bourgeoise (officielle comme libérale), qui voit dans
le marxisme quelque chose comme une « secte
malfaisante ». On ne peut s'attendre à une autre
attitude, car dans une société fondée sur la lutte
des classes, il ne
saurait y avoir de science sociale « impartiale ».
Toute la science officielle et libérale défend, de
façon ou d'autre, l'esclavage
salarié, tandis que le marxisme lui a déclaré une
guerre implacable. Demander une science impartiale dans une
société fondée sur l'esclavage salarié est
d'une naïveté aussi puérile que de demander
aux fabricants de se montrer impartiaux dans la question de savoir s'il
convient de diminuer les profits du Capital pour augmenter le salaire
des ouvriers.
Mais ce n'est pas tout. L'histoire de la philosophie et
de la science sociale montre en toute clarté que le marxisme n'a
rien qui ressemble à du « sectarisme » dans le
sens d'une doctrine repliée sur elle-même et
ossifiée, surgie à l'écart de la grande
voie du développement de la civilisation universelle. Au
contraire, le génie de
Marx est d'avoir répondu aux questions que l'humanité
avancée avait déjà soulevées. Sa doctrine
naquit comme la continuation directe et immédiate des
doctrines des représentants les plus éminents de la
philosophie, de l'économie politique et du socialisme.
La doctrine de Marx est toute-puissante, parce qu'elle
est juste. Elle est harmonieuse et complète ; elle donne
aux hommes une conception cohérente du monde, inconciliable avec
toute superstition, avec toute réaction, avec toute
défense de l'oppression bourgeoise. Elle est le successeur
légitime de tout ce que l'humanité a créé
de
meilleur au XIXe siècle : la philosophie allemande,
l'économie politique anglaise et le socialisme français.
C'est à ces trois sources, aux trois parties
constitutives du marxisme que nous nous arrêterons
brièvement.
I
La philosophie du marxisme est le matérialisme.
Au cours de toute l'histoire moderne de l'Europe et
surtout à la fin du XVIIIe siècle, en France, où
se déroulait une lutte décisive contre tout le fatras du
moyen âge, contre la féodalité dans les
institutions et dans les idées, le matérialisme fut
l'unique philosophie conséquente, fidèle à
tous les enseignements des sciences naturelles, hostile aux
superstitions, au cagotisme, etc. Aussi les ennemis de la
démocratie s'appliquèrent-ils de toutes leurs forces
à « réfuter » le matérialisme,
à le discréditer, à le calomnier ; ils
défendaient les diverses formes de l'idéalisme
philosophique qui de toute façon se réduit toujours
à la
défense ou au soutien de la religion.
Marx et Engels défendirent résolument le
matérialisme philosophique et ils montrèrent maintes fois
ce qu'il y avait de profondément erroné dans toutes les
déviations par rapport à cette doctrine fondamentale.
C'est dans les ouvrages d'Engels : Ludwig Feuerbach et l'Anti-Dühring
que leurs vues sont exposées avec le
plus de clarté et de détails, et ces ouvrages, comme le Manifeste
du
Parti
communiste,
sont les livres de chevet de tout ouvrier
conscient.
Mais Marx ne s'arrêta pas au matérialisme
du XVIIIe siècle, il poussa la philosophie plus en avant. Il
l'enrichit des acquisitions de la philosophie classique allemande,
surtout du système de Hegel, lequel avait conduit à son
tour au matérialisme de Feuerbach. La principale de ces
acquisitions est la dialectique, c'est-à-dire la
théorie de
l'évolution, dans son aspect le plus complet, le plus profond et
le plus exempt d'étroitesse, théorie de la
relativité des connaissances humaines qui nous présentent
l'image de la matière en perpétuel développement.
Les récentes découvertes des sciences naturelles — le
radium, les électrons, la transformation des
éléments — ont admirablement
confirmé le matérialisme dialectique de Marx, en
dépit des doctrines des philosophes bourgeois et de leurs
« nouveaux » retours à l'ancien
idéalisme pourri.
Approfondissant et développant le
matérialisme philosophique, Marx le fit aboutir à son
terme logique, et il l'étendit de la connaissance de la nature
à la connaissance de la société humaine. Le
matérialisme historique de Marx fut la plus grande
conquête de la pensée scientifique. Au chaos et à
l'arbitraire qui régnaient
jusque-là dans les conceptions de l'histoire et de la politique
succéda une théorie scientifique remarquablement
cohérente et harmonieuse qui montre comment, d'une forme
d'organisation sociale, surgit et se développe, par suite de la
croissance des forces productives, une autre forme, plus
élevée, comment par exemple le capitalisme naît du
féodalisme.
De même que la connaissance de l'homme
reflète la nature qui existe indépendamment de lui,
c'est-à-dire la matière en voie de développement,
de même la connaissance sociale de l'homme
(c'est-à-dire les différentes opinions et doctrines
philosophiques, religieuses, politiques, etc.) reflète le
régime
économique de la société.
Les institutions politiques s'érigent en superstructure sur une
base économique. Nous voyons, par exemple, comment les
différentes formes politiques des Etats européens
modernes servent à renforcer la domination de la bourgeoisie sur
le prolétariat.
La philosophie de Marx est un matérialisme
philosophique achevé, qui a donné de puissants
instruments de connaissance à l'humanité et surtout
à la classe ouvrière.
II
Après avoir constaté que le régime
économique constitué la base sur laquelle s'érige
la superstructure politique, Marx réserve essentiellement son
attention à l'étude de ce régime
économique. L'oeuvre principale de Marx, Le Capital,
est consacrée à l'étude du régime
économique de la société moderne,
c'est-à-dire capitaliste.
L'économie politique classique antérieure
à Marx naquit en Angleterre, le pays capitaliste le plus
évolué. Adam Smith et David Ricardo, en étudiant
le régime économique, jetèrent les bases de la
théorie
de
la valeur-travail. Marx continua leur oeuvre. Il donna un
fondement strictement scientifique à cette théorie et la
développa de
façon conséquente. Il montra que la valeur de toute
marchandise est déterminée par le temps de travail
socialement nécessaire à sa production.
Là où les économistes bourgeois
voyaient des rapports entre objets (échange d'une marchandise
contre une autre), Marx découvrit des rapports entre hommes.
L'échange de marchandises exprime le lien
établi par l'intermédiaire du marché entre les
producteurs isolés. L'argent signifie que ce lien
devient de plus en plus étroit,
unissant en un tout indissoluble toute la vie économique des
producteurs isolés. Le capital signifie le
développement continu de ce lien : la force de travail de
l'homme devient une marchandise. Le salarié vend sa force de
travail au propriétaire de la terre, des usines, des instruments
de travail. L'ouvrier emploie une partie de la
journée de travail à couvrir les frais de son entretien
et de celui de sa famille (le salaire) ; l'autre partie à
travailler gratuitement, en créant pour le capitaliste la plus-value,
source de profit, source de richesse pour la classe
capitaliste.
La théorie de la plus-value constitue la pierre
angulaire de la théorie économique de Marx.
Le capital créé par le travail de
l'ouvrier opprime l'ouvrier, ruine les petits patrons et crée
une armée de chômeurs. Dans l'industrie, la victoire de la
grosse production est visible d'emblée ; nous observons
d'ailleurs un phénomène analogue dans
l'agriculture : la supériorité de la grosse
exploitation agricole capitaliste s'accroît,
l'emploi des machines se généralise, les exploitations
paysannes voient se resserrer autour d'elles le noeud coulant du
capital financier, elles déclinent et se ruinent sous le joug de
leur technique arriérée. Dans l'agriculture, les formes
du déclin de la petite production sont autres, mais le
déclin lui-même est un fait incontestable.
Le capital qui bat la petite production conduit
à augmenter la productivité du travail et à
créer une situation de monopole pour les associations de gros
capitalistes. La production elle-même devient de plus en plus
sociale : des centaines de milliers et des millions d'ouvriers
sont réunis dans un organisme économique
coordonné, tandis
qu'une poignée de capitalistes s'approprient le produit du
travail commun. L'anarchie de la production grandit : crises,
course folle à la recherche de débouchés et, de
là, existence non assurée pour la masse de la population.
Tout en augmentant la dépendance des ouvriers
envers le capital, le régime capitaliste crée la grande
puissance du travail unifié.
Marx a suivi le développement du capitalisme
depuis les premiers rudiments de l'économie marchande,
l'échange simple jusqu'à ses formes supérieures,
la grande production.
Et l'expérience de tous les pays capitalistes,
vieux et neufs, montre nettement d'année en année
à un nombre de plus en plus grand d'ouvriers la justesse de
cette doctrine de Marx.
Le capitalisme a vaincu dans le monde entier, mais
cette victoire n'est que le prélude de la victoire du Travail
sur le Capital.
III
Lorsque le régime féodal fut
renversé et que la « libre »
société capitaliste vit le jour, il apparut tout de suite
que cette liberté équivalait à un nouveau
système d'oppression et d'exploitation des travailleurs.
Aussitôt diverses doctrines socialistes commencèrent
à surgir, reflet de cette oppression et protestation contre
elle. Mais le
socialisme primitif était un socialisme utopique. Il
critiquait la société capitaliste, la condamnait, la
maudissait ; il rêvait de l'abolir, il imaginait un
régime meilleur ; il cherchait à persuader les
riches de l'immoralité de l'exploitation.
Mais le socialisme utopique ne pouvait indiquer une
véritable issue. Il ne savait ni expliquer la nature de
l'esclavage salarié en régime capitaliste, ni
découvrir les lois de son développement, ni trouver la
force
sociale capable de devenir le créateur de la
société nouvelle.
Cependant, les révolutions orageuses qui
accompagnèrent partout en Europe, et principalement en France,
la chute de la féodalité, du servage, montraient avec
toujours plus d'évidence que la lutte des classes est
la base et la force motrice du développement.
Aucune liberté politique n'a été
conquise sur la classe des féodaux sans une résistance
acharnée. Aucun pays capitaliste ne s'est constitué sur
une base plus ou moins libre, démocratique, sans qu'une lutte
à mort n'ait mis aux prises les différentes classes de la
société capitaliste.
Marx a ceci de génial qu'il fut le premier
à dégager et à appliquer de façon
conséquente l'enseignement que comporte l'histoire universelle.
Cet enseignement, c'est la doctrine de la lutte des classes.
Les hommes ont toujours été et seront
toujours en politique les dupes naïves des autres et
d'eux-mêmes, tant qu'ils n'auront pas appris, derrière les
phrases, les déclarations et les promesses morales, religieuses,
politiques et sociales, à discerner les intérêts de
telles ou telles classes. Les partisans des
réformes et améliorations seront
dupés par les défenseurs du vieux régime aussi
longtemps qu'ils n'auront pas compris que toute vieille institution, si
barbare et pourrie qu'elle paraisse, est soutenue par les forces de
telles ou telles classes dominantes. Et pour briser la
résistance de ces classes, il n'y a qu'un moyen :
trouver dans la société même qui nous entoure,
puis éduquer et organiser pour la lutte, les forces qui peuvent
— et doivent de par leur situation sociale — devenir la force
capable de balayer le vieux et de créer le nouveau.
Seul le matérialisme philosophique de Marx a
montré au prolétariat la voie à suivre pour sortir
de l'esclavage spirituel où végétaient
jusque-là toutes les classes opprimées. Seule la
théorie économique de Marx a expliqué la situation
véritable du prolétariat dans l'ensemble du régime
capitaliste.
Les organisations prolétariennes
indépendantes se multiplient dans le monde entier, de
l'Amérique au Japon, de la Suède à l'Afrique du
Sud. Le prolétariat s'instruit et s'éduque en menant sa
lutte de classe ; il s'affranchit des préjugés de la
société bourgeoise, il acquiert une cohésion de
plus en plus grande, il apprend à apprécier ses
succès à leur juste valeur, il retrempe ses forces et
grandit irrésistiblement.

La théorie marxiste de la plus-value conserve
encore toute sa valeur
- Hardial Bains -
Marx a découvert la loi économique du
développement de la société
capitaliste, la loi de la plus-value. Il a montré que le but de
la
production sous le capitalisme est le profit, qui représente le
travail
non payé de la classe ouvrière, la valeur nouvelle
créée par les
travailleurs au cours du processus de production capitaliste en sus de
la valeur
de leurs salaires. Marx a été le premier à
découvrir l'origine du
profit capitaliste dans l'exploitation de la classe ouvrière. Il
a
montré que sous le capitalisme, la production se
développe à travers
des crises et des bouleversements en raison de l'anarchie de la
production, anarchie qui a sa racine dans la contradiction fondamentale
du mode de
production capitaliste, la contradiction entre le caractère
social de
la production et l'appropriation capitaliste privée des fruits
de la
production. À un certain stade, la croissance des forces
productives
entre en conflit avec la croissance des profits, avec l'appropriation
capitaliste privée. C'est alors qu'éclate la crise,
caractérisée par un
phénomène
apparemment illogique : il y a une surabondance de biens, mais les
travailleurs, ne pouvant se les payer, vivent dans le besoin. Marx a
prédit tous les traits de la société capitaliste
telle que nous la
connaissons en se basant sur la loi économique du
développement du
capitalisme. À partir de cette loi, il a pu formuler la loi
générale et
absolue
de l'accumulation capitaliste, qui affirme qu'à mesure que le
capitalisme se développe et que la richesse se concentre entre
les
mains de la bourgeoisie, la condition de la classe ouvrière va
nécessairement se détériorant : les riches
s'enrichissent et les
pauvres s'appauvrissent.
« L'armée industrielle de
réserve est d'autant plus nombreuse
que la richesse sociale, le capital en fonction, l'étendue et
l'énergie
de son accroissement, donc aussi la masse absolue du prolétariat
et la
force productive de son travail, sont plus considérables. Les
mêmes
causes qui développent la force expansive du capital
développent la
force de travail disponible. La grandeur relative de l'armée
industrielle de réserve s'accroît donc en même temps
que les ressorts
de la richesse. Mais plus cette armée de réserve grossit,
comparativement à l'armée active du travail, plus grossit
la
surpopulation consolidée, excédent de population, dont la
misère est
inversement proportionnelle aux
tourments de son travail. Plus s'accroît enfin cette couche des
Lazare
de la classe salariée, plus s'accroît aussi le
paupérisme officiel. Voilà la loi absolue,
générale, de l'accumulation capitaliste . »[1]
Marx en concluait que le système capitaliste
serait frappé par des
crises cycliques d'une ampleur toujours plus grande et que seul le
renversement du mode de production capitaliste par la révolution
violente du prolétariat avec ses alliés pouvait mettre
fin à cette
situation.[2]
Ainsi, raisonnait Marx, la
propriété privée capitaliste et les rapports de
production capitalistes
seraient renversés et remplacés par la
propriété sociale des moyens de
production, ce qui permettrait d'abolir la contradiction entre le
caractère social de la production et les rapports de
propriété
existants.
Avec la loi de la plus-value, Marx découvrait
l'origine et le développement du profit capitaliste et mettait
à nu la « loi économique du
développement de la société moderne ».
Ce problème avait laissé perplexes tous les
économistes avant lui. Bien
que s'approchant plus ou moins de la théorie de la
valeur-travail, ces
derniers
n'avaient pas su expliquer scientifiquement l'origine du profit. Engels
a expliqué :
« Marx a également découvert la
loi particulière du mouvement
du mode de production capitaliste actuel et de la société
bourgeoise
qui en est issue. La découverte de la plus-value a, du coup,
fait ici
la lumière, alors que toutes les recherches antérieures
aussi bien des
économistes bourgeois que des critiques socialistes
s'étaient perdues
dans les ténèbres. » [3]
Après la première crise industrielle
de 1825, et après son
accession définitive au pouvoir en France et en Angleterre
vers 1830,
la bourgeoisie, devant la montée de la lutte de classe du
prolétariat,
s'est désintéressée complètement de la
recherche d'une économie
politique scientifique. Marx a expliqué dans la postface de la
deuxième édition allemande du Capital :
« En France et en Angleterre, la bourgeoisie
s'empare du
pouvoir politique. Dès lors, dans la théorie comme dans
la pratique, la
lutte des classes revêt des formes de plus en plus
accusées, de plus en
plus menaçantes. Elle sonne le glas de l'économie
bourgeoise
scientifique. Désormais, il ne s'agit plus de savoir si tel ou
tel
théorème est vrai,
mais s'il est bien ou mal sonnant, agréable ou non à la
police, utile
ou nuisible au capital. La recherche désintéressée
fait place au
pugilat payé, l'investigation consciencieuse à la
mauvaise conscience,
aux misérables subterfuges de l'apologétique. »
[4]
C'est dans les années 1840 que Marx a
commencé à élaborer sa
doctrine économique en s'appuyant sur la loi économique
du
développement de la société moderne. Dès
lors, l'économie politique
scientifique et le marxisme étaient synonymes. La rigueur
scientifique
devenait synonyme de parti-pris prolétarien, car le marxisme
avait
montré qu'on ne peut mettre fin aux crises et aux autres maux du
capitalisme qu'en abolissant le système capitaliste
lui-même, que seul
le renversement de l'ordre bourgeois par la révolution permettra
de
changer la condition de la classe ouvrière, de briser les
chaînes de
l'esclavage salarié qui lie l'ouvrier au capital.
Avec le passage du capitalisme au stade du capitalisme
monopoliste
et de l'impérialisme, toutes ses contradictions s'exacerbent
à
l'extrême. La révolution, loin d'être une
perspective qui s'éloigne,
s'impose à l'ordre du jour comme une nécessité,
comme la solution à
toutes ces contradictions, elle devient un problème posé
et à résoudre.
Aujourd'hui, comme à l'époque où Marx a fait son
analyse minutieuse de
la production de marchandises sous le capitalisme, l'ouvrier n'a rien
à
vendre que sa force de travail ; il est un esclave salarié
forcé de
s'offrir sur le marché pour gagner sa vie. Le
développement de la
grande production, la concentration implacable de la production et
du capital entre les mains d'une poignée de riches, la
croissance du
capital financier, l'exportation de capitaux vers tous les coins du
globe, la division du monde entre les puissances impérialistes,
tout
cela n'a pas infirmé les lois économiques du capitalisme
découvertes
par Marx. Les conditions objectives actuelles ne font que confirmer la
valeur de
la doctrine économique de Marx.
C'est la justesse indéniable de la doctrine
économique de Marx et
la grande force de ses enseignements qui contraignent la bourgeoisie
à
jeter tous ses apologistes dans l'arène contre le marxisme, dans
le but
de le « réfuter ». Aujourd'hui comme par le
passé, ces apologistes
présentent des arguments pour justifier l'exploitation des
travailleurs et le système du profit capitaliste. Du temps de
Marx, ils
prétendaient que le capitaliste avait droit à un «
retour sur son
investissement » « du fait de son
abstinence », pour « compenser les
risques encourus » ou pour « payer son salaire de
gérant ». Mais de
telles explications n'ont pu résister à la doctrine
scientifique qui prouvait que, peu importe la justification que l'on
invente pour les profits, les intérêts, les rentes et les
autres gains
réalisés par les propriétaires bourgeois, ces
« retours sur
l'investissement » n'avaient qu'une origine : le
travail vivant de la
classe ouvrière et des autres travailleurs. La bourgeoisie niait
totalement la
théorie de la valeur-travail. Elle identifiait la valeur au prix
et
soutenait que les prix étaient déterminés par le
rapport entre «
l'offre et la demande », et plus particulièrement par
les préférences
subjectives des consommateurs, de telle sorte qu'il n'y avait et ne
pouvait y avoir de mesure objective de la valeur du travail.
C'est avec cette théorie psychologique de la
valeur que les
économistes bourgeois espéraient écarter la
théorie de la
valeur-travail et justifier la répartition inégale des
fruits du
travail entre les exploiteurs et les exploités, entre les riches
et les
pauvres. W.S. Jevons, un des fondateurs de la théorie
psychologique de
la valeur basée sur la
philosophie utilitariste, a également élaboré une
théorie selon
laquelle les crises périodiques du capitalisme s'expliquent par
le
cycle des taches solaires ! Et dire que cette nouvelle version de
la
théorie de la valeur est apparue simultanément en
Angleterre, en
Autriche et en France précisément en 1871,
année de batailles acharnées
de
classe, année de la révolte du prolétariat
parisien et de la
proclamation de la Commune de Paris !
Lorsque le capitalisme a atteint son stade monopoliste,
les
théoriciens révisionnistes ont cherché à
leur tour à discréditer la
doctrine économique marxiste en s'appuyant sur ce qu'ils
appelaient les « nouvelles données » du
développement économique. Ils
prétendaient que la concentration du capital et
l'évincement de la
petite
production ne se poursuivaient que très lentement dans
l'industrie et
pas du tout dans l'agriculture ; que les crises se faisaient de
plus en
plus rares et moins aiguës ; que les cartels et les trusts
permettraient d'enrayer les crises définitivement ; et que
la théorie
de « l'effondrement » n'était pas valable parce
que les
antagonismes de classe s'atténuaient. En somme, ils soutenaient
que les
contradictions du capitalisme s'émoussaient et même
disparaissent avec
son passage au state du capitalisme monopoliste.
Lénine s'est élevé contre les
révisionnistes qui cherchaient à
dénaturer les conclusions de Marx, à en supprimer la
définition des
lois économiques du développement du capitalisme et la
doctrine de la
lutte de classe. Il a montré que le capitalisme s'était
développé selon
la loi économique découverte par Marx, que c'est par la
concentration
du
capital et de la production qu'il était passé au stade du
capitalisme
monopoliste, et que les antagonismes de classe s'en étaient
trouvés
intensifiés. Il a souligné :
« La réalité ne tarda pas
à montrer aux révisionnistes que
l'époque des crises n'était pas révolue : une
crise succéda à la
prospérité. Les formes, la succession, la physionomie de
certaines
crises s'étaient modifiées ; mais les crises
demeuraient partie
intégrante, inéluctable du régime capitaliste. Les
cartels et les
trusts, en unifiant
la production, aggravaient en même temps aux yeux de tous
l'anarchie de
la production, l'incertitude du lendemain pour le prolétariat et
l'oppression du capital ; ils envenimaient ainsi, à un
degré inconnu
jusque-là, les antagonismes de classe. » [5]
Dans son ouvrage monumental L'impérialisme,
stade suprême du capitalisme,
Lénine a montré comment le capitalisme était
passé au stade du
capitalisme monopoliste, au stade de l'impérialisme capitaliste.
S'appuyant sur les lois économiques découvertes par Marx,
il a décrit
le développement des traits du capitalisme monopoliste, de
son caractère parasitaire et moribond : la concentration du
capital et
de la production et l'apparition des monopoles ; la naissance du
capital financier par la fusion, sous la domination des banques, du
capital industriel et du capital bancaire ; l'exportation de
capitaux
et la division du monde entre les monopoles capitalistes et les
puissances impérialistes. Il a décrit
l'impérialisme comme le stade du
capitalisme où la révolution est à l'ordre du
jour, où elle est un
problème posé et à résoudre. De plus, il a
analysé l'action de la loi
économique fondamentale du capitalisme dans les conditions du
capitalisme monopoliste, et en a conclu que les capitalistes cherchent
à s'accaparer
le profit maximum en exigeant un tribut de toutes les cellules de la
société.
Le capital financier, concentré en quelques
mains et exerçant
un monopole de fait, prélève des bénéfices
énormes et toujours
croissants sur la constitution de firmes, les émissions de
valeurs, les
emprunts d'État, etc., affermissant la domination des
oligarchies
financières et frappant la société tout
entière d'un tribut au profit
des
monopolistes. » [6]
Staline a formulé cette loi avec
précision dans son ouvrage Les problèmes
économiques du socialisme en URSS.
Il a montré que la loi de la plus-value, qui explique l'origine
et le
développement du profit capitaliste, demeure la loi
économique
fondamentale du capitalisme, et que, même si l'action de cette
loi est
en quelque sorte
modifiée dans les conditions de l'impérialisme, ses
principes restent
toujours les mêmes. Staline a conclu que les traits principaux et
les
exigences de la loi économique fondamentale du capitalisme
moderne
pouvaient se formuler ainsi :
« assurer le maximum de profit capitaliste en
exploitant, en
ruinant, en appauvrissant la majeure partie de la population d'un pays
donné ; en asservissant et en dépouillant de
façon systématique les
peuples des autres pays, notamment ceux des pays
arriérés ; enfin, en
déclenchant des guerres et en militarisant l'économie
nationale en vue d'assurer le maximum de profits. » [7]
Staline réfutait ainsi le point de vue des
révisionnistes modernes
comme Browder et Tito qui prétendaient que le capitalisme
monopoliste
aux États-Unis était un « capitalisme
jeune », que l'économie
socialiste était compatible avec le marché capitaliste et
la
circulation capitaliste des marchandises, ainsi qu'avec l'action de la
loi de la
valeur en tant qu'agent régulateur de la production et de la
distribution. [...]
Aujourd'hui, la bourgeoisie est toujours aussi
déterminée à «
réfuter » la théorie marxiste de la
plus-value, à obscurcir l'origine
du profit et à dépeindre le système d'esclavage
salarié sous des
couleurs chatoyantes. En 1983, les impérialistes ont
même attribué le
prix Nobel d'économie à un « savant »
professeur, G. Debreu,
qui a consacré toute sa vie à chercher en vain un
substitut à la
théorie marxiste de la plus-value. Le président de Gulf
Canada prétend
que c'est la bourgeoisie, les monopoles et les multinationales qui
créent la richesse, tandis que les travailleurs ne font que
consommer !
La bourgeoisie ne cesse de chanter sa ritournelle voulant que la
croissance économique et le bien-être du peuple
dépendent entièrement
des profits des corporations, que la croissance des profits soit
nécessaire à l'expansion économique, et ainsi de
suite. Elle soutient
que la crise actuelle résulte, du moins en grande partie, d'une
chute
des profits. Selon ce « raisonnement », la solution de
la crise passe
par
une hausse des profits. Cette idée est poussée à
la limite par les
idéologues bourgeois, qui répètent sans
arrêt que les profits sont la
clé de la « création d'emplois » et que
les travailleurs ne peuvent
mieux servir leurs intérêts qu'en acceptant de sacrifier
leurs salaires
et leurs conditions de travail (et jusqu'à leur
sécurité d'emploi et
leurs
emplois mêmes !), afin d'accroître les profits des
employeurs et de
préserver ainsi des emplois ou en «
créer » de nouveaux.
Par ces prétentions saugrenues, la bourgeoisie
s'offre une farce
cruelle aux dépens des travailleurs et des larges masses du
peuple.
Tant la théorie marxiste de la plus-value que la
réalité elle-même
démentent les dires de la bourgeoisie à propos des
bénéfices
qu'apporteraient les profits aux travailleurs. Les profits des
monopoles et des
multinationales se sont accrus considérablement en 1983,
mais cette «
relance » n'a pas créé d'emplois pour les
chômeurs. Au contraire, le
chômage se maintient autour de 11 pour cent, un des niveaux
les plus
élevés que l'histoire ait connus. Malgré cela, la
bourgeoisie et ses
media persistent à colporter leur propagande
trompeuse. Le bien-être du peuple ne préoccupe pas la
bourgeoisie ; «
créer des emplois » ne l'intéresse pas. Sa
préoccupation est de
s'assurer le profit maximum par l'exploitation des travailleurs et en
frappant d'un tribut la société tout entière.
La loi de la plus-value continue d'opérer
aujourd'hui. Telle que
modifiée dans son action à l'époque de
l'impérialisme, elle demeure la
loi économique fondamentale du capitalisme moderne. La loi de la
plus-value n'a pas besoin d'amendements » ni de «
corrections », comme
le prétendent les révisionnistes et les opportunistes. Au
contraire, on ne peut comprendre le développement actuel de
l'économie
capitaliste, caractérisé par des crises
périodiques et par
l'approfondissement constant de la crise générale, sans
se référer à
cette loi économique fondamentale du capitalisme moderne. [...]
Notes
1. Marx, K., Le Capital,
Éditions sociales, Paris, 1976, Livre 1, p. 465.
2. L'idée que « la
classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre telle quelle
la machine de l'État et de la faire fonctionner pour son propre
compte » est un principe fondamental du marxisme.
Voir : Marx, K. « La guerre civile en France », Marx
et
Engels,
Oeuvres
choisies ,
tome 2, Éditions du progrès,
Moscou, 1970,p. 230.
3. Engels, F., "Discours sur la
tombe de Karl Marx", Marx et Engels, Oeuvres choisies,
tome 3, Éditions du Progrès, Moscou, 1978,
p. 167.
4. Marx, K., Le Capital.
Livre 1, op. cit., p. 17.
5. Lénine, V.1., "Marxisme
et révisionnisme", Oeuvres complètes.
tome 15, Éditions sociales, Éditions du
Progrès, Paris, Moscou, 1967, p. 31-32
6. Lénine, V.I.,
"L'impérialisme, stade suprême du capitalisme", Oeuvres complètes,
tome 22, Éditions sociales,
Éditions en langues étrangères, Paris,
Moscou ; 1960, p. 252.
7. Staline, J., "Les
problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S.", Oeuvres
choisies,
op.
cit.,
p. 599.

Lisez Le
Marxiste-Léniniste
Site web: www.pccml.ca
Courriel: redaction@cpcml.ca
|