|
|
Numéro 11 - 24 mars 2018 Supplément Projet de loi C-59: Loi concernant
Audiences
du
Comité
permanent
de
la
sécurité
publique et
nationale Audiences du Comité permanent de la sécurité publique et nationale Inquiétudes au sujet du dangereux projet de loiDurant les audiences du Comité permanent de la sécurité publique nationale qui ont eu lieu du 5 décembre 2017 au 8 février 2018, des organisations ont été invitées à donner leurs opinions. Voici certains extraits des interventions des organisations de défense des droits et libertés, d'associations d'avocats et de professeurs.
Organisations de défense des libertés civiles Cara Zwibel, avocate générale par
intérim, Association canadienne des libertés civiles : « ...l'expression 'réduire les menaces pour la sécurité du Canada', qui enclenche la communication d'information, demeure inutilement vaste et circulaire. On voit mal pourquoi cette définition est beaucoup plus vaste que celle de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), et nous craignons encore que des actes de défense, de protestation, de dissidence ou d'expression artistique protégés par la Constitution, surtout de la part de militants écologistes ou autochtones, continuent d'être visés dans le processus. » « ...la liste de mesures énoncées à l'article 21.1(1.1) du projet de loi n'exige un mandat que lorsque le SCRS détermine qu'il pourrait enfreindre la loi ou limiter un droit garanti par la Charte. Il faudrait qu'un mandat soit toujours exigé lorsque le SCRS prend ces mesures. Il est essentiel de ne pas laisser le SCRS déterminer seul si une loi est violée ou si un droit garanti par la Charte est limité. » Elle a dit ce qui suit au sujet des modifications
apportées à la Loi sur la sûreté des
déplacements aériens : « Le processus
utilisé pour ajouter des noms à la liste [Liste
d'interdiction de vol] demeure opaque, et les mécanismes de
recours sont inadéquats. Le projet de loi C-59 omet
également de corriger les lacunes de la
procédure d'appel, qui ressemble au système qui
était en place pour les certificats de sécurité
avant la décision de la Cour suprême dans l'affaire
Charkaoui en 2007. [...] À l'heure actuelle, le processus
autorise l'utilisation de ouï-dire et de preuves secrètes,
sans permettre à un avocat spécial de vérifier les
preuves ou de représenter
les intérêts de la personne dont le nom figure sur la
liste. » « ...les aspects cyberopérationnels actifs et défensifs proposés pour le mandat du CST autorisent essentiellement les autorités en place à se livrer, en secret et largement sans contrainte, à des activités de piratage et de perturbation parrainées par l'État. Ces activités ne doivent pas cibler les infrastructures canadiennes, ce qui est manifestement inadéquat comme restriction compte tenu de la nature fondamentalement interreliée de l'écosystème numérique. Les activités de ce genre auront inévitablement une incidence sur la vie privée, la liberté d'expression et la sécurité des Canadiens et des personnes se trouvant au pays, et elles pourraient menacer l'intégrité des outils de communication comme le cryptage et les logiciels d'anonymat qui sont essentiels pour protéger les droits de la personne à l'ère numérique. » « Les activités cyberopérationnelles du CST ne font l'objet d'aucune mesure importante de protection des renseignements personnels, ne nécessitent qu'une autorisation ministérielle secrète et font seulement l'objet d'un examen après coup. » « Le projet de loi C-59 aggrave ce risque en créant une série d'exceptions relatives aux données canadiennes, notamment en autorisant l'acquisition, l'utilisation, l'analyse, la conservation et la divulgation, pourvu que ce soit accessible au public. « La définition est vaste au point de plausiblement englober les renseignements personnels que les gens tiennent beaucoup à protéger, et de peut-être autoriser la collecte de données personnelles obtenues à la suite de piratage, de fuites ou d'autres moyens illicites. De plus, elle pourrait encourager la création d'un marché gris pour des données qui n'auraient autrement jamais été à la disposition du gouvernement, qui est un client riche. Le gouvernement n'a pas démontré pourquoi cette exception, dans sa formulation actuelle, est nécessaire ou proportionnée, ou quel risque elle est censée atténuer. » « Nous ne croyons pas que l'autorisation du
ministre responsable et du ministre des Affaires
étrangères suffise. Nous préférerions que
ce genre de pouvoir soit encadré à peu près comme
les pouvoirs de perturbation ou de réduction des menaces qu'on
trouve dans la Loi sur le SCRS. Nous observons des mesures de
surveillance et
d'autorisation préalable beaucoup plus rigoureuses dans ce
contexte. » « Grâce aux années de rapports du commissaire du CST, entre autres, nous savons que les litiges relatifs à l'interprétation des normes et des définitions juridiques ont toujours été une source de préoccupation, et que les activités liées à la sécurité nationale en général sont ravagées par le problème des « lois secrètes », où le libellé d'une loi ou d'une directive est interprété d'une façon parfois obscure ou très troublante, des interprétations qui peuvent ne pas être mises au jour avant des années. » « Le critère auquel il faut satisfaire pour acquérir des ensembles de données canadiens -- qui, il ne faut pas l'oublier, sont définis expressément comme étant des ensembles de données qui contiennent des renseignements personnels qui ne sont pas directement et immédiatement liés à des activités représentant une menace à la sécurité du Canada -- consiste simplement à démontrer que les résultats produits par leur recherche ou leur exploitation pourraient être pertinents et il faut que cette évaluation soit raisonnable. « On pourrait faire valoir que la vaste portée dont profite la collecte des données de masse est au moins limitée par l'exigence d'une autorisation judiciaire visant la conservation de ces ensembles de données, mais plutôt que d'offrir une protection efficace, cette autorisation intensifie simplement les effets des critères très peu élevés qui l'ont engendrée. Les renseignements personnels qui ne sont pas directement et immédiatement liés à des menaces à la sécurité du Canada peuvent être recueillis s'ils « peuvent être pertinents », si cette évaluation est « raisonnable », et si le ou la juge décide ensuite que les ensembles de données peuvent être conservés parce qu'ils répondent au critère selon lequel « ils sont susceptibles d'être utiles ». « Ce sont donc les seuils de ce que la plupart des Canadiens qualifieraient de surveillance de masse, et nous croyons que la plupart des Canadiens rejetteraient ces seuils, car ils sont beaucoup trop bas. Ainsi, une bonne occasion d'améliorer ces pratiques de surveillance est gaspillée dans le projet de loi C-59. « Les critères proposés représentent une érosion importante des protections de la vie privée qui découlent du critère de stricte nécessité qui s'applique actuellement. Nous recommandons que les dispositions sur les données de masse du SCRS soient révisées pour qu'elles soient expressément visées par le critère de stricte nécessité au lieu de représenter une exception à ce critère. Nous recommandons également que des critères de collecte de données de masse -- comme ceux établis par le CSARS, qui sont pragmatiques et dotés de principes -- soient établis dans le projet de loi. » Alex Neve, secrétaire général, Amnistie internationale Canada : « Sans mesures de protection et restrictions adéquates, des activités trop générales liées à la sécurité nationale sont préjudiciables pour des particuliers et des collectivités qui ne constituent absolument pas une menace à la sécurité. Dans tous ces cas, l'impact est souvent ressenti de façon disproportionnée et discriminatoire par des communautés religieuses, ethniques et raciales précises, créant ainsi une autre préoccupation liée aux droits de la personne. » « Actuellement, à part la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , aucune des lois canadiennes liées à la sécurité nationale ne mentionne précisément les obligations internationales du Canada en matière des droits de la personne ni ne les intègre. [...] Notre première recommandation, par conséquent, reste de modifier le projet de loi C-59 pour inclure une disposition exigeant que toutes les lois liées à la sécurité nationale soient interprétées conformément aux obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne. » « il doit y avoir une interdiction précise selon laquelle le SCRS ne participera à aucune activité de réduction des menaces qui constituerait un manquement à l'égard des obligations au titre de la Charte ou des obligations internationales en matière de droits de la personne. » « Enfin, le projet de loi C-59 ne réforme
pas comme il faudrait l'approche prise en matière de
sécurité nationale dans le cadre des procédures de
l'immigration. Il y avait de graves préoccupations liées
au fait que le projet de loi C-51 accentue le caractère
inéquitable du processus lié au certificat de
sécurité pour l'immigration, par exemple, en
cachant certaines catégories de preuves aux avocats
spéciaux. » Ce groupe n'a pas été invité à témoigner mais le groupe OpenMedia l'a invité car il croyait qu'il méritait d'être entendu. « Nous maintenons notre opposition fondamentale et nous demandons l'abrogation du système des listes d'interdiction de vol. » « Nous craignons que dans sa formulation actuelle ou future, la LCISC ( Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada ) n'entrave la capacité légitime des dissidents et des manifestants au Canada à se mobiliser du fait de l'inclusion de la définition actuelle des infrastructures essentielles. « ...en ce qui concerne la loi proposée
sur le CST et le SCRS, à savoir qu'il faut attribuer des
rôles proactifs pour ce qui est de la divulgation des
renseignements étrangers. Quant à la LCISC, que nous
ayons des définitions claires du partage de renseignements
étrangers et de la façon dont il peut avoir
lieu. » « Le pouvoir accordé au SCRS de constituer légalement des bases de données sur l'ensemble des Canadiens est inacceptable. Il n'y a pas de restriction sur les données que le SCRS peut compiler, pourvu qu'elles soient considérées comme publiques, ce qui est très large. D'autres ensembles de données pourront être compilés après l'approbation d'un juge sur la base de critères très faibles. Il suffit qu'il soit probable que la conservation de ces données aide le Service. » « En vertu de ces dispositions, le SCRS pourra continuer, en toute légalité, d'espionner et de monter des données et des dossiers sur des groupes contestataires, écologistes, autochtones et autres qui ne font qu'exercer leurs droits démocratiques. Le SCRS pourra compter sur le soutien du CST qui, lui aussi, pourra acquérir, utiliser, analyser, conserver et divulguer de l'information accessible au public et dont le mandat inclut l'assistance technique au SCRS. Ces bases de données pavent également la voie au Big Data et à l'exploration de données qui mènent à la constitution de listes de personnes sur la base de profils de risque. Nous sommes opposés à cette approche de la sécurité, qui finit par placer des milliers d'innocents sur des listes de suspects et qui cible de manière disproportionnée les musulmans et les musulmanes. « Avec le projet de loi C-59, le SCRS pourra continuer de prendre des mesures actives, notamment de perturbation, pour contrer les menaces. Les mesures peuvent limiter un droit ou une liberté garantis par la Charte canadienne des droits et libertés , si un juge accorde un mandat autorisant la prise de ces mesures. Soulignons que ces autorisations judiciaires sont consenties dans le secret, ex parte, de sorte que les personnes visées par ces atteintes à leurs droits ne pourront pas plaider devant le juge leur « innocence » ou le caractère déraisonnable des mesures. II se peut même qu'elles ignorent que le SCRS soit à l'origine de leurs déboires, ce qui les empêcherait de porter plainte après les faits. Ces pouvoirs évoquent les abus révélés par la Commission Macdonald pour contrer la menace séparatiste. En conséquence, nous sommes fermement opposés à l'octroi de ces pouvoirs au SCRS. » Leurs recommandations comprennent : - que la Loi sur la sûreté des transports aériens soit abrogée et que toute liste d'interdiction de vol soit abolie ; - que le critère pour donner et recevoir de l'information dans l'application de la Loi sur la communication d'information soit celui de ce qui est « strictement nécessaire ; - que soit retiré au SCRS le pouvoir de prendre des mesures actives, notamment de perturbation, pour contrer les menaces ; En ce qui concerne l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, ils recommandent qu'il « dispose des ressources matérielles, humaines et financières nécessaires pour accomplir son mandat ». D'autres recommandations comprennent que « l'Office doit être clairement vu comme un organisme indépendant qui a aussi une expertise et dont le mandat est de rendre compte à la population. Nous pensons que ce qui ne fonctionne pas dans le projet de loi C-59, c'est que l'Office rend compte beaucoup plus au ministère et au gouvernement qu'à la population de la façon dont les agences se comportent. On pourrait modifier le projet de loi C-59 pour que l'Office agisse plus comme un chien de garde qui rend compte à la population de la façon dont les agences accomplissent leur mandat par rapport au respect des droits. »
Groupes de défenseIhsaan Gardee, directeur exécutif, Conseil national des musulmans canadiens : « La loi va trop loin. Elle garantit quasiment une violation de la Constitution et offre une justification inadéquate. Elle renforce le milieu de la sécurité alors que toutes les données probantes montrent clairement que les institutions responsables de la collecte de renseignements et d'application de la loi liée à la sécurité nationale sont en difficulté, truffées de préjugés et d'intimidation à tous les échelons. La surveillance de ces agences n'est pas suffisante. Il faut une vraie réforme. » « Au cours des 15 dernières années, il y a eu trois enquêtes judiciaires distinctes, de nombreuses décisions de tribunaux, des ententes à l'amiable et des excuses qui reconnaissent les violations de la Constitution commises par des responsables du renseignement et de l'application de la loi dans le contexte de la sécurité nationale contre d'innocents musulmans. Les musulmans canadiens sont non seulement touchés de façon disproportionnée par ces erreurs et abus, mais ils font les frais des répercussions sociales lorsqu'apparaissent des sentiments xénophobes et antimusulmans. Le CNMC est d'accord avec un grand nombre d'experts
selon lesquels donner plus de pouvoir aux organismes de
sécurité ne signifie pas nécessairement que les
Canadiens seront plus en sécurité. Les erreurs des
responsables de la sécurité nationale non seulement
exposent des personnes innocentes à un risque de soupçons
et de stigmatisation,
mais détournent aussi l'attention des réelles menaces
tout en empêchant des actions pouvant efficacement promouvoir la
sûreté et la sécurité. Alors même
qu'Alexandre Bissonnette concoctait son attaque meurtrière
contre une mosquée de Québec, la GRC ' fabriquait un
crime ' selon un juge de la Cour supérieure de la
Colombie-Britannique, dans
un litige contre John Nuttall et Amanda Korody. Ce sont des personnes
qui se sont converties à l'islam, d'anciens
héroïnomanes vivant sur l'aide sociale, dont les
accusations de terrorisme ont été retirées
l'année dernière lorsqu'un tribunal a découvert
qu'ils avaient été piégés par la police. Le
projet de loi C-59 renforce le milieu de la sécurité,
mais
ne répond pas aux besoins en matière de
sécurité des musulmans canadiens. Même si
l'idée de prévention est louable, tout avantage qu'on
pourra tirer de cette approche sera annulé par les
empiétements sur les droits garantis par la Charte qui touchent
de façon disproportionnée les membres de notre
communauté, empiétements qui continueront de
se produire sous le couvert de la réduction de la menace, de la
communication de renseignements et de l'établissement de listes
d'interdiction de vol. » « Pour beaucoup de jeunes musulmans canadiens, la participation documentée et admise d'organismes responsables du renseignement et de l'application de la loi à des cas d'extradition et d'autres violations des droits de la personne, ce à quoi s'ajoutent le manque total de responsabilisation et les perceptions d'impunité qui en ont découlé, ont suscité un manque de confiance à l'égard du milieu canadien de la sécurité. » « La perte de confiance envers l'organisme de sécurité parmi les communautés musulmanes canadiennes a été exacerbée par l'absence de responsabilisation à l'égard des torts passés dont ont été victimes d'innocents musulmans. Même si le gouvernement a conclu d'importants règlements et présenté des excuses, aucun membre de ces organismes n'a été tenu responsable de ses actes. Autant que nous sachions, il n'y a eu aucune mesure disciplinaire, et aucune reconnaissance publique. Plutôt que d'être tenues responsables, certaines des personnes impliquées dans le cas bien connu de Maher Arar, qui a été torturé, ont même été promues au sein des organismes. Dans le meilleur des cas, il faut parler d'incompétence individuelle et institutionnelle au sein des organismes de sécurité. Dans le pire des cas, c'est une négligence grave et de la mauvaise foi. Ni l'un ni l'autre n'est acceptable, et les contribuables canadiens qui financent ces organismes méritent mieux.L'absence de responsabilité reflète une culture d'impunité au sein des organismes canadiens responsables de la sécurité qui renforce l'insécurité éprouvée par les musulmans canadiens. Le projet de loi C-59 n'atténuera pas les problèmes liés au SCRS. Aucun niveau de surveillance administrative ne peut éliminer des maux systémiques. Ces organismes doivent être réformés. » « Selon nous, le projet de loi ne tient aucun
compte de l'impact réel que des préjugés dans le
milieu de la sécurité nationale, qui créent de
l'insécurité et causent des préjudices, peut avoir
dans nos communautés. Sans un mandat législatif clair et
des directives de notre gouvernement, nous ne croyons pas que la
société civile à elle seule peut
changer la culture au sein du SCRS et d'autres organismes de
sécurité. Nous sommes prêts à aider, mais
nous ne pouvons pas porter ce fardeau seuls. » « Premièrement, nous demandons la suppression de la liste d'interdiction de vol, qu'on appelait avant le Programme de protection des passagers. Nous constatons que cette initiative continue d'être très préjudiciable pour les familles canadiennes et n'offre aucun remède ou recours efficace, comme mon collègue, ici, vous le dira. » « Selon nous, aucun rafistolage ne permettra de régler le problème sous-jacent, soit que la liste d'interdiction de vol est l'un des instruments de profilage racial et religieux les plus dommageables actuellement au pays. C'est le pendant, dans le domaine de la sécurité nationale, du fichage dans le contexte des services policiers en zone urbaine. Depuis la mise en oeuvre de la liste, elle a causé tellement de préjudices sans donner de résultat clair ou établi qu'on ne peut tout simplement pas justifier son maintien au sein de notre démocratie fondée sur la primauté du droit. C'était une expérience intéressante, mais il est temps de l'arrêter. Ce dont le Canada a besoin, c'est non pas d'une liste de voyageurs interdits, mais plutôt de meilleures activités d'enquête et de renseignement afin que les personnes qui constituent vraiment un risque ou qui ont commis des crimes puissent être traduites devant le système de justice pénale. » « La deuxième recommandation, c'est qu'il
faut réformer le SCRS. En ce qui a trait au Service, nous
affirmons qu'on ne peut pas lui donner des pouvoirs
supplémentaires, vu le manque de confiance actuel à
l'égard de l'institution de la part de nombreux Canadiens. Il y
a tout simplement trop de preuves d'un biais et d'une discrimination
systématiques pour que nous puissions demander aux musulmans
canadiens et aux autres citoyens de croire que tout nouveau pouvoir ne
sera pas exercé de façon inappropriée ou
discriminatoire. En fait, tout porte à croire que tout nouveau
pouvoir sera exercé de façon inappropriée et
discriminatoire. Comme on l'a mentionné, les violations
liées à
la sécurité nationale touchent de façon
disproportionnée les musulmans canadiens, même si ce n'est
pas seulement les musulmans canadiens, et ce n'est pas une
coïncidence. Ce dont on a besoin, c'est un changement de culture
au sein des organismes de sécurité nationale avant que
Canadiens puissent croire que les enquêtes ne sont pas
fondées sur
des préjugés et des stéréotypes et que ces
préjugés et stéréotypes ne vont pas
définir la façon dont les nouveaux pouvoirs
proposés de perturbation seront utilisés. » « Je suis simplement un citoyen canadien et un père, ici pour témoigner des répercussions négatives qui peuvent découler des lacunes législatives et lorsque les renseignements recueillis par nos propres organismes de sécurité sont utilisés de façon aléatoire. » « Comme vous le savez probablement, le Programme de protection des passagers, qu'on appelle aussi la liste d'interdiction de vol du Canada, a été mis en oeuvre en 2007. La conception du programme incluait, pour reprendre les mots de notre actuel ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, une ' erreur fondamentale'. Cette lacune, qui persiste aujourd'hui, c'est que la vérification pour déterminer si des passagers figurent peut-être sur la liste des personnes interdites de vol revient aux transporteurs aériens et se fait uniquement en fonction du nom, et ce, même si les renseignements d'enregistrement et la liste de surveillance dressée au titre de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens contiennent des identifiants supplémentaires, comme la date de naissance. » « Les statistiques au sujet du programme et de son efficacité n'ont pas été communiquées depuis sa mise en place en 2007, quand le ministre des Transports a indiqué qu'il y avait jusqu'à 2 000 noms sur la liste. Notre groupe a été contacté par plus de 100 familles touchées, qui représentent seulement la pointe de l'iceberg. La vaste majorité des voyageurs ainsi ennuyés ne connaissent pas la source de leur difficulté puisque la Loi sur la sûreté des déplacements aériens interdit explicitement de divulguer des renseignements liés à une personne inscrite. Cependant, à la lumière des noms des personnes faussement identifiées que nous connaissons et vu le nombre de Canadiens qui ont le même nom, nous pouvons estimer de façon conservatrice que plus de 100 000 Canadiens pourraient être des faux positifs lorsqu'ils prennent l'avion. » « Mon fils de trois ans, Sebastian, a été traité comme une personne possiblement inscrite depuis sa naissance. Cela signifie que, pour les deux premières années de sa vie, Sebastian était assez jeune, au titre de la réglementation sur les voyages, pour être considéré comme un bébé qui voyage sur les 'genoux d'un parent' et qui n'avait pas besoin d'un siège dans l'avion, mais assez vieux pour être considéré comme une possible menace pour la sécurité. » « Cette stigmatisation a été décrite par le ministre comme une expérience traumatisante pour eux et leur famille. Lorsque les enfants grandiront et deviendront adolescents et jeunes adultes, particulièrement les jeunes hommes, leur innocence deviendra moins évidente. Comme notre groupe l'a appris, les retards deviennent plus longs, et les contrôles, plus intenses. Cela signifie que certaines familles ont manqué des vols et que des enfants refusent de voyager par crainte d'être stigmatisés. Ce n'est pas le genre d'avenir que je souhaite à mon fils. La Loi sur la sûreté des déplacements aériens permet au ministre de conclure des accords avec des États étrangers pour divulguer les noms figurant sur notre liste de surveillance. Par exemple, un groupe de travail a été créé en 2016 pour communiquer les noms figurant sur notre liste d'interdiction de vol avec les États-Unis. La possibilité que ces données soient communiquées à l'échelle internationale est troublante pour nos familles, qui ont vécu des épreuves effrayantes, les gens étant questionnés, ou leur passeport, confisqué, lorsqu'ils voyagent à l'étranger. En fait, mon épouse et moi sommes préoccupés par le traitement qu'on nous réservera si notre famille décide de voyager à l'extérieur du Canada, vu ce qui se passe déjà au pays. » « En janvier 2016, le ministre a souligné aux transporteurs aériens que les enfants âgés de moins de 18 ans n'ont pas à faire l'objet de contrôles supplémentaires. Cependant, comme la CBC l'a déclaré, le résultat a été qu'Air Canada a rappelé à ses employés que toute correspondance avec les noms figurant sur la liste doit faire l'objet d'une vérification en personne de l'identité, peut importe l'âge. En juin 2016, le gouvernement a annoncé la création du Bureau de renseignements sur le Programme de protection des passagers, le BDRPPP, visant à aider les voyageurs qui ont eu de la difficulté parce qu'ils figurent sur des listes liées à la sûreté de l'aviation. Notre groupe n'est au fait d'aucune famille dont le problème a pu être réglé par le BDRPPP. Pour le Canadien moyen, une solution consisterait à éliminer de façon permanente une personne fichée à tort. Le BDRPPP considère que recommander d'inscrire son enfant à un programme de récompense d'un transporteur aérien ou que présenter une demande dans le cadre du système de recours du Department of Homeland Security américain est une solution. Pour les personnes visées par la liste canadienne comme mon fils, un numéro de recours américain n'est d'aucune aide. Les programmes de récompense des transporteurs aériens constituent une solution de fortune qui manque d'uniformité et qui est viciée, une solution que le ministre a qualifiée de solution provisoire. Ce n'est pas assez bon. » « Le groupe a réussi à obtenir des lettres de 202 députés, soit les deux tiers de la Chambre des communes, des lettres qui demandaient toutes la création rapide d'un système de recours. Il semble que tous les partis soient favorables à un tel système, mais me voilà rendu aux mauvaises nouvelles. À la lecture des modifications proposées à la Loi sur la sûreté des déplacements aériens contenues dans le projet de loi C-59, il est apparent que, même si le projet de loi fait un petit pas en avant en vue d'établir le système de recours, il n'en établit pas un au bout du compte. » « ...le projet de loi C-59...n'arrive même
pas près de définir en détail un système de
recours à l'intention des personnes faussement visées en
raison de la liste. Mon dernier point, c'est que nous ne demandons pas
au gouvernement de réinventer la roue. On n'a qu'à
regarder ce qu'a fait notre plus proche voisin, les États-Unis.
Nous avons joint
des saisies d'écran de données de réservation pour
le même passager voyageant du Canada à Halifax et New York
avec un transporteur aérien canadien, Air Canada. Comme vous
pouvez le voir, la technologie existe déjà, une
technologie permettant au passager de consigner son numéro de
recours lorsqu'il voyage aux États-Unis afin d'être
autorisé
à voyager au moment de l'enregistrement. » Laura Tribe décrit OpenMedia comme « un organisme communautaire voué à la promotion d'un Internet ouvert, abordable et exempt de surveillance ». Madame Tribe décrit OpenMedia comme « un organisme communautaire voué à la promotion d'un Internet ouvert, abordable et exempt de surveillance ». « Je suis d'avis que les cyberopérations actives, et plus particulièrement celles qui visent à déployer des outils à l'étranger, posent un grand risque pour la sécurité du Canada, dans la façon dont elles pourraient être exploitées. » « Je pense qu'une fois que de tels pouvoirs existent à l'intérieur d'un système très opaque, dans lequel il est difficile d'intégrer des mécanismes de transparence, il est difficile de concevoir comment nous pouvons avoir confiance, alors que nous voyons que ce système est constamment utilisé à mauvais escient dans le monde entier. Nous ne nous inquiétons pas que le gouvernement actuel soit sur le point de déployer toutes ces armes. Nous nous inquiétons plutôt que de tels pouvoirs existent, sans aucune justification pour prouver que nous en avons besoin. » En réponse à une question concernant les rapports de partage d'information entre la GRC et la Drug Enforcement Agency aux États-Unis, madame Tribe dit : « L'un des soucis majeurs, je crois, est que nous ne savons pas combien d'ententes de partage d'information le Canada a conclues et le fait que nous ne disposons d'aucune information à ce sujet. Nous ne savons pas avec qui les ententes ont été conclues. Nous ignorons quelles sont nos alliances ou de quoi il s'agit. Lorsque le gouvernement du Canada obtient nos renseignements, que nous les communiquions ou qu'il les recueille directement, nous ignorons leur destinée. Inversement, quand nous souscrivons des ententes avec d'autres pays, nous ne savons pas comment cette information peut revenir au Canada. En outre, notre communauté n'a de cesse de répéter que, quelle que soit l'information dont il s'agit, n'importe qui peut éventuellement l'obtenir dans le réseau des organismes membres du Groupe des cinq ou de n'importe quel ministère des pays alliés. Une fois qu'une information est saisie dans un ensemble de données, elle l'est dans celui de tout le monde. » Un membre du Comité qui est d'avis que le Canada a besoin d'une « capacité offensive » en matière de cybersécurité lui a demandé : « J'aimerais savoir ce que vous conseilleriez à ce gouvernement ou à tout autre gouvernement canadien pour se prémunir contre les menaces bien réelles qui existent dans le cyberespace ou les cyber-réseaux ? » Ce à quoi elle a répondu : « Ce qui nous préoccupe surtout, c'est l'absence de freins et de contrepoids dans la formulation actuelle de la loi proposée sur le CST. [...] Fondamentalement, cependant, nous sommes préoccupés par le fait que la portée de la loi est trop vaste et qu'elle laisse le CST faire trop de choses sans la reddition de comptes et les mécanismes de contrôle nécessaires pour veiller à ce qu'il soit utilisé uniquement si quelqu'un cible quelque chose comme notre infrastructure énergétique. » « Les précisions qui permettraient aux Canadiens d'avoir confiance sont absentes. Nous n'avons pas été consultés à ce sujet. Lors des consultations, on ne nous a jamais demandé ce que nous pensions donner de nouveaux pouvoirs au CST. Je crois que les préoccupations de notre organisme viennent de là. »
Associations de juristesPeter Edelmann, membre à titre particulier, Section du droit de l'immigration, Association du Barreau canadien : Maître Edelmann dit que bien que l'Association du Barreau canadien « appuie généralement les objectifs et la structure du projet de loi C-59 », elle est d'avis que « la définition d''activité portant atteinte à la sécurité du Canada', à l'article 2, reste très vaste et, en particulier, elle diffère de la définition de 'menaces envers la sécurité du Canada' selon la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité . Rien ne sert d'avoir deux définitions. Cela prête à confusion et ne donne pas de mandat clair aux organismes de sécurité nationale et, en particulier, à un office de surveillance ou d'examen. Je signale au passage que la modification à l'exception au paragraphe 2(2) de la LCISC est troublante, car elle limite considérablement la protection que prévoit la version actuelle. Plusieurs activités politiques légitimes pourraient être perçues comme des atteintes à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale du Canada. « Par le passé, nous avons recommandé d'adopter une définition claire et cohérente de 'sécurité nationale' et nous ne changeons pas d'idée. On ne sait pas non plus si certaines autres activités entrent dans la définition de 'sécurité nationale'. Ainsi, la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, la LSDA, ne dit rien de la sécurité nationale et on ne sait pas trop si la surveillance des activités visées par la LSDA relèverait de l'OSSNR ou pas. Autrement dit, s'agit-il ici d'une loi de sécurité nationale ? Est-ce l'OSSNR qui en est responsable ? « Il est manifestement essentiel de coordonner l'action de l'OSSNR avec celle d'autres organismes de surveillance, mais nous dirions que le cadre de l'examen présente encore des lacunes importantes. Le problème est particulièrement criant dans le cas de l'Agence des services frontaliers du Canada, et nous avons exprimé des préoccupations au sujet de cette absence d'examen indépendant de l'ASFC plusieurs fois par le passé. L'ASFC, l'un des plus importants services d'application de la loi au pays, n'est pas soumise à une surveillance ou un examen indépendant. » « Quant au SCRS, nous demeurons
préoccupés par les pouvoirs de perturbation. En
particulier, les pouvoirs cinétiques du SCRS lui viennent de son
mandat d'origine, consécutif à la Commission McDonald.
[...] Nous avons toujours les mêmes préoccupations que
jadis au sujet de ces mandats qui limitent les droits garantis par la
Charte dans ce
contexte. » Faisal Mirza, président, Conseil
d'administration, Association canadienne des avocats musulmans : « En particulier, le projet de loi passe sous silence un élément clé de la sécurité, à savoir le critère juridique minimal pour la fouille de dispositifs numériques à la frontière. » « [...] je suis d'avis que des directives législatives sont nécessaires pour préciser dans quelles circonstances l'ASFC peut fouiller des dispositifs numériques à la frontière. Nous pouvons nous étendre sur le fait que le projet de loi marque un progrès dans la conciliation des droits individuels et des intérêts de l'État, mais la réalité sur le terrain est qu'il est possible de contourner toutes ces dispositions en fouillant les dispositifs numériques de voyageurs à la frontière. La Loi sur les douanes doit être révisée. Elle date des années 1980, époque où les dispositifs numériques n'étaient pas la norme, et il y était question de la fouille des bagages des voyageurs. « L'utilisation de la collecte de données est l'avenir de la sécurité nationale et les dispositifs qu'emportent les gens font manifestement partie intégrante de l'équilibre à trouver entre les intérêts individuels et la protection de notre sécurité. Dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens voyagent. Les Canadiens de retour au pays sont facilement soumis à la fouille sans restriction de leurs dispositifs numériques. Il faut adopter un meilleur critère juridique minimal qui tienne compte de la nature de la technologie. À l'heure actuelle, les douanes et le gouvernement estiment qu'il n'existe pas de critère juridique minimal qui empêche de fouiller les cellulaires, les portables et ainsi de suite des personnes qui se représentent à la frontière. Même avec une attente réduite de protection des renseignements personnels dans ce contexte, il devient essentiel qu'il y ait au moins un critère juridique minimal quelconque. Autrement, il devient facile de contourner les dispositions du Code criminel ou les modifications à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés visant à protéger l'échange de renseignements lorsque des personnes se présentent à la frontière à leur retour, sans qu'il leur reste aucune protection. » Concernant la liste de personnes soupçonnées d'être liées au terrorisme, il dit : « La difficulté, c'est que des organisations privées de leurs actifs ou dont les actifs sont bloqués sont dans l'impossibilité de prendre un avocat pour présenter des propositions au ministre ou pour participer à un contrôle judiciaire obligatoire. En fait, à notre sens, cette omission est contraire à la Constitution. On se trouve devant une infraction à l'article 7 en même temps qu'une infraction à l'article 10, car ces entités n'ont pas la possibilité d'engager un avocat pour se défendre. Cette faiblesse constitutionnelle pourrait poser un sérieux problème à cette loi à l'avenir. »
ChercheursChristina Szurlej, chaire dotée, Atlantic Human Rights Centre, St. Thomas University, à titre personnel) : « Bien que le projet de loi C-59 ait corrigé certaines lacunes de la Loi antiterroriste de 2015 , il subsiste des préoccupations au sujet de son incidence sur les droits de la personne, et en particulier sur les droits à la vie privée, le droit de liberté de réunion et d'association, la liberté d'expression, la liberté et la sécurité, les droits démocratiques, l'application régulière de la loi et les protections contre la discrimination. » « S'il est question d'ingérence dans la vie privée des gens, il faut en principe un mandat pour agir. Et, oui, il existe des circonstances exceptionnelles, mais la Charte des droits et libertés n'est pas là pour rien : elle protège constitutionnellement ces droits, et toute atteinte à ces droits doit être raisonnable. « Il ne suffit pas de dire que la collecte de données relève des fonctions du SCRS pour qu'elle respecte ce seuil. Peut-être faudrait-il démontrer clairement qu'une menace pèse sur la sécurité nationale pour justifier le dépassement du seuil. » Madame Szurlej recommande : « Veiller
à ce que toute limitation des droits de la personne soit
conforme aux obligations nationales et internationales du Canada. Toute
atteinte à ces droits doit être nécessaire,
proportionnée, raisonnable et justifiable dans une
société libre et démocratique. Le gouvernement
doit veiller à ce que la collecte
de renseignements personnels soit directement liée à la
protection de la sécurité publique et nationale et non
pas tangentiellement associée aux fonctions et
responsabilités du SCRS ou de tout autre organisme. Il y aurait
lieu d'adopter une loi visant à protéger la population
canadienne de toute marchandisation des renseignements personnels par
de
tierces parties en contrepartie d'un paiement ou d'un abonnement
à un service. L'Office de surveillance des activités en
matière de sécurité nationale et de renseignement
devrait être doté du pouvoir de rendre des
décisions exécutoires. Le poste du commissaire au
renseignement devrait être un poste à temps plein et non
à temps partiel compte tenu
de l'importance de ce portefeuille. » « Le nouveau système ne réglera le problème constitutionnel que s'il intègre toutes les activités de collecte de renseignements protégés par la Constitution au nouveau système d'autorisation. C'est là qu'est le problème. Le projet de loi C-59 ne prévoit une utilisation de ce processus d'autorisation que dans le cas d'une contravention à une loi fédérale. Sur le plan constitutionnel, le processus doit également être utilisé dans d'autres circonstances. « Certains types de collecte de renseignements
qui peuvent intéresser un Canadien relativement à la
Constitution ne contreviennent pas à une loi
fédérale. C'est le cas de certaines
métadonnées, par exemple. La solution est simple. Je
recommande d'élargir la portée de la loi ainsi :
« Les activités menées par le Centre dans la
réalisation
du volet de son mandat touchant le renseignement
étranger » ou la cybersécurité «
ne doivent pas contrevenir aux autres lois fédérales ou
entraîner la collecte d'informations pour lesquelles les
Canadiens ou une personne au Canada peut s'attendre raisonnablement
à ce qu'elles soient protégées »,
à moins d'être menées au titre d'une
autorisation ministérielle pouvant faire l'objet d'un examen du
commissaire au renseignement. » Le professeur Wark se porte entièrement à la défense du projet de loi C-59. Par contre, un de ses commentaires suffit à dissiper toute notion que les libéraux ne font que modifier la Loi C-51 pour éliminer les éléments auxquels les Canadiens s'objectent fortement : « Le projet de loi C-59 est un effort très ambitieux et vaste de modernisation du cadre de la sécurité nationale du Canada. Il ne faut pas penser que cela signifie tout simplement que l'on va rafistoler le projet de loi C-51 du gouvernement précédent. » Le ministre, les agences de renseignement, de la police et de l'espionnage s'adressent au comitéLe 30 novembre, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale a tenu sa première audience dans le cadre de son étude du projet de loi C-59, Loi concernant des questions de sécurité nationale. L'audience comprenait une déclaration préliminaire du ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, suivie des questions et réponses des membres du Comité à Goodale, et les déclarations des représentants du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, du Service canadien du renseignement de sécurité, du Centre de la sécurité des télécommunications et du ministère de la Justice.
À ce jour, après avoir évité un débat à la Chambre des communes, le gouvernement n'a pas présenté d'arguments pour expliquer pourquoi les pouvoirs prévus dans la loi sont nécessaires, sauf pour dire qu'il s'agit de la moderniser et de protéger les Canadiens. Cela s'est poursuivi au sein du comité. Goodale n'a pas présenté la raison d'être de la loi selon le gouvernement ni expliqué les diverses parties de la loi et les raisons pour lesquelles elles étaient présentées. Il a présenté une brève introduction dans laquelle il a dit que tout ce que fait le gouvernement vise à protéger les Canadiens et à défendre nos droits et libertés. « Dans tout ce que fait notre gouvernement en matière de sécurité nationale, il y a deux objectifs inséparables : protéger les Canadiens et défendre les droits et libertés », a-t-il dit. Lui et les autres députés du comité n'ont même pas mentionné dans leurs remarques les centaines de milliers de Canadiens qui se sont prononcés contre le projet de loi C-51 et ont demandé son abrogation complète. Au lieu de cela, Goodale a cherché à le cacher en présentant les actions du gouvernement comme si cela venait des Canadiens. « Le projet de loi C-59 est le fruit des consultations les plus exhaustives qui aient été menées au Canada sur la sécurité nationale. Nous avons reçu plus de 75 000 mémoires provenant d'un grand éventail d'experts et d'intervenants ainsi que de la population. Les membres du Comité y ont aussi apporté une contribution très importante, comme ils pourront le constater, je l'espère, à son contenu. » Cette tentative de surmonter la crise de légitimité à laquelle le gouvernement est confronté devant son refus d'abroger le projet de loi C-51 s'est poursuivie durant la période de questions et réponses. La première question adressée au ministre est venue de la députée libérale de Toronto-Danforth Julie Dabrusin qui a dit : « Pendant les consultations, j'ai organisé une rencontre à laquelle beaucoup de gens ont participé. L'assistance était nombreuse. Les gens étaient très préoccupés par la protection de la vie privée et des droits garantis par la Charte.[...]Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi n'abroge-t-on pas tout simplement l'ancien projet de loi C-51 adopté sous l'ancien gouvernement lors de la précédente législature ? Pourquoi a-t-on besoin d'un nouveau projet de loi ? Pourquoi ne pas abroger la précédente mesure et laisser les choses comme elles étaient ? » Goodale a répondu en déclarant « que le projet de loi C-51 n'existe plus. Son contenu a été intégré dans d'autres textes législatifs qui touchent cinq ou six lois et différents organismes et activités du gouvernement du Canada. C'est un peu maintenant comme vouloir séparer les oeufs d'une omelette, au lieu d'abroger simplement ce qui était là ». Il a ajouté que « Au sujet de la consultation dont vous avez parlé, nous avons passé au peigne fin les lois sur la sécurité au Canada, qu'elles aient été touchées ou non par le projet de loi C-51, et nous nous sommes posés la question importante suivante : 'est-ce la meilleure disposition, la bonne disposition pour atteindre, dans l'intérêt des Canadiens, les deux objectifs simultanément, soit assurer leur sécurité et protéger leurs droits et libertés ?' »
Mettre les opérations illicites à labri des contestations judiciaires
Dans ses renarques, Goodale a concentré son attention à s'adresser aux « pouvoirs de réduction de la menace du SCRS », qui permettent aux agents du SCRS de mener toutes sortes d'opérations illicites. Il a cherché à donner l'impression que les Canadiens sont principalement préoccupés par la surveillance de ces pouvoirs plutôt que par les pouvoirs eux-mêmes. En réponse aux préoccupations, il a dit que « Le SCRS doit avoir, et les Canadiens ont besoin que le SCRS ait, des pouvoirs clairement définis, sans ambiguïté, afin qu'il puisse faire son travail qui est d'assurer notre sécurité. Le projet de loi apporte cette clarté. En ayant des pouvoirs très clairs, les agents du SCRS peuvent accomplir le travail difficile qui est le leur en sachant qu'ils le font en respectant pleinement la loi et la Constitution. »
Ce « projet de loi fera en sorte que les mesures prises par le SCRS respectent la Charte des droits et libertés. Le projet de loi C-51 supposait le contraire, et même si le SCRS a très clairement indiqué qu'il n'a jamais utilisé cette option, le projet de loi C-59 éliminera toute ambiguïté à ce sujet », a-t-il dit. En réponse à des questions au cours de l'audience concernant le projet de loi C-51 et ce que Goodale affirme être les principaux problèmes qu'il a soulevés, il a dit : « Le principal problème découlant du projet de loi C-51, c'est que le libellé initial de ce qui est devenu l'article 12.1 de la Loi sur le SCRS indiquait, en raison de la manière dont il était structuré, que le SCRS pouvait s'adresser à un tribunal pour obtenir l'autorisation de violer la Charte. Tous les spécialistes du droit que j'ai entendus ont affirmé que cette disposition n'avait aucune valeur juridique. Une loi ordinaire comme la Loi sur le SCRS ne peut avoir préséance sur la Charte. C'est cette dernière qui prime. Le libellé de l'article 12.1 était toutefois structuré de manière à donner l'impression que le SCRS pouvait s'adresser à un tribunal pour obtenir l'autorisation de violer la Charte. « Le projet de loi C-59 modifie ce libellé, notamment en ajoutant une liste des activités de perturbation que le SCRS peut entreprendre avec l'autorisation d'un tribunal. Cependant, lorsqu'il s'adresse à la cour pour obtenir cette autorisation, ce n'est pas pour être autorisé à violer la Charte, mais pour s'assurer que les activités respectent cette dernière, y compris l'article 1. « Voilà ce qui différencie la structure de l'ancienne disposition et le nouveau libellé. Nous avons tenté d'indiquer nettement que la Charte prime. » L'article 1 de la Charte s'énonce ainsi : « 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. » Durant les mêmes audiences, le directeur du SCRS a expliqué que le rapport entre ces « pouvoirs de réduction de la menace » et la Charte est qu'« en ce qui concerne la réduction de la menace, on s'assure que toute éventuelle mesure dans ce qui brimerait la liberté de quelqu'un aux termes de la Charte fera l'objet d'une requête auprès de la Cour fédérale. La Cour fédérale décidera à ce moment-là si l'entorse faite à la liberté est raisonnable et proportionnelle, ce que permet la Charte. C'est la façon dont le projet de loi C-59 aborde la question du respect de la Charte en ce qui concerne le mandat de réduction de la menace. » Parmi les autres remarques qu'il a faites, Goodale a dit « Grâce à l'éventail de nouvelles dispositions que comprend le projet de loi C-59, nous donnerons au Service canadien du renseignement de sécurité, à la GRC et aux autres organismes la capacité et les outils nécessaires pour être aussi bien informés qu'il est humainement possible de l'être au sujet de ces activités et pour pouvoir agir dans le respect de la loi et de la Constitution afin de faire ce qu'ils doivent faire pour contrer ces menaces. » David Vigneault du SCRS a aussi expliqué que le projet de loi C-59 ne modifie pas les mesures de réduction de la menace que le SCRS peut prendre pour lesquelles il n'exige pas de mandat. Il a donné l'exemple que « si nous avions connaissance d'une personne qui voulait aller à l'étranger afin de se joindre à une organisation terroriste, nous n'aurions pas à obtenir de mandat afin d'intervenir auprès d'un parent ou des proches de la personne pour les informer et leur demander d'exercer une influence. Le projet de loi C-59 ne modifie aucunement la disposition pertinente ».
Définitions d'une infraction liée au terrorisme
Les intervenants ont ensuite porté leur attention à la définition de « propagande terroriste » dans la nouvelle loi et l'infraction criminelle existante de promotion du terrorisme qui était incluse dans le projet de loi C-51. En expliquant la nouvelle formulation qui interdirait « de conseiller la commission d'infractions de terrorisme », Goodale a déclaré que « Le problème à l'heure actuelle est que la définition du projet de loi C-51 étant très vaste et très vague, elle est pratiquement inapplicable, et la disposition n'a pas été utilisée. Le projet de loi C-59 propose donc une terminologie claire et courante en droit canadien. Il interdirait de conseiller à une personne la commission d'infractions de terrorisme. Cela ne nécessite pas qu'une personne en particulier soit incitée à commettre une infraction particulière. Le simple fait d'encourager les autres à poser des gestes terroristes non spécifiques se qualifiera et enclenchera cette disposition du Code criminel. » « La loi étant plus claire, il sera plus facile de l'appliquer. Des poursuites seront peut-être intentées en vertu de cette nouvelle disposition pour cette infraction, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant », a-t-il ajouté. En réponse à des préoccupations soulevées au Parlement concernant de nouvelles mesures de « reddition de comptes » et si elles forceraient les agences de sécurité et de renseignement à faire « trop de pirouettes » Goodale a dit que ce n'était pas le cas et que deux des principaux experts en matière de sécurité nationale, Craig Forcese et Kent Roach, ont déclaré que le projet de loi représente « des avancées solides -- tant du point de vue de la règle de droit que des libertés civiles -- et sans coût apparent pour la sécurité ». S'adressant à la question d'examen et de surveillance il a dit « Certaines activités de surveillance prévues dans le projet de loi auront lieu a posteriori, et quand les activités de surveillance auront lieu en temps réel, nous avons inclus des dispositions pour couvrir les situations d'urgence où il faut intervenir sans attendre. » Il a ajouté que « la reddition de comptes vise, bien sûr, à s'assurer que les droits et les libertés des Canadiens sont protégés, mais aussi à s'assurer que nos organismes fonctionnent le mieux possible pour protéger les Canadiens. La sécurité et les droits sont deux objectifs essentiels qui doivent être atteints simultanément, et non pas l'un sans l'autre ».
La criminalisation de la dissidence
Le député conservateur Dave MacKenzie a demandé au ministre d'expliquer que le projet de loi C-59 « interdit expressément les activités de défense d'une cause, de protestation et tout le reste, les changements qu'apportera le nouveau projet de loi entraîneront-ils des accusations qui n'étaient pas possibles en vertu du projet de loi C-51 ? Les probabilités de poursuites sont-elles plus élevées avec le projet de loi C-59 qu'avec le projet de loi C-51 ? »
Goodale a dit que le « problème avec le langage utilisé dans le projet de loi C-51 était que c'était très vaste. Pour reprendre l'expression des avocats devant la cour, le libellé était tellement vaste que c'était vague et impossible à appliquer. « Je vous rappelle qu'il y a eu certaines discussions durant la campagne électorale en 2015 faisant valoir que le libellé de cet article pourrait être utilisé pour inclure certaines publicités électorales, ce qui n'était évidemment pas le but de la mesure législative. « Nous avons précisé le libellé sans nuire à son efficacité, et je crois que nos changements rendront plus probables le dépôt d'accusations et les condamnations, parce que nous avons dressé un parallèle avec une structure juridique existante que les tribunaux, les avocats et les procureurs connaissent, soit l'infraction de conseiller. Ce n'est clairement pas obligé que ce soit une personne précise qui conseille à une autre de faire quelque chose de précis. Si une personne conseille de manière générale à une autre de commettre un acte terroriste, c'est une infraction de conseiller une telle commission en vertu du projet de loi, tel que nous l'avons écrit. »
Pouvoirs d'arrestation préventive
Douglas Breithaupt directeur et avocat général de la Section de la politique en matière de droit pénal du ministère de la Justice a répondu à une question du député conservateur Glen Motz au sujet de la modification de la terminologie de l'article 83.3 du Code criminel de « peut servir à prévenir » une activité terroriste à « est nécessaire à la prévention » d'un acte terroriste et de la répercussion de cette modification en termes de « notre capacité à procéder à des arrestations préventives ». Breithaupt a expliqué que le projet de loi C-59 « rétablit l'un des critères tel qu'il figurait dans l'ancien projet de loi C-51. Il y a deux critères, à savoir que l'agent de la paix ait d'abord des motifs raisonnables de croire qu'une activité terroriste est entreprise, et deuxièmement, qu'il ait des motifs raisonnables de soupçonner que l'imposition d'un engagement assorti de conditions ou son arrestation aura, comme il est écrit actuellement, « vraisemblablement pour effet d'empêcher que l'activité terroriste ne soit entreprise. »
Divulguer au lieu de communiquer
Le député du NPD Mathew Dubé a demandé au ministre de clarifier la différence entre « communiquer » et « divulguer » puisque divulguer remplace communiquer dans la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada. Le ministre a répondu que « nous ne créons aucun nouveau pouvoir concernant la collecte de renseignements. Cela concerne uniquement de l'information qui existe déjà ». À un autre moment de l'audience, Vincent Rigny, le sous-ministre délégué auprès du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile a dit : « Je pense que c'est en fait un changement très important. Comme le ministre l'a laissé entendre, en remplaçant le terme 'sharing' par 'disclosure', on perd la notion de collecte de renseignements. Il est question de divulguer l'information, et parfois, je crois que lorsqu'on utilise le terme 'sharing', cela implique qu'il y a collecte de renseignements également. Ce changement vise donc à clarifier les choses. « En outre, lorsqu'on parle de 'disclosure', il est clair que l'information est transmise d'une entité, d'un organisme, à un autre. Par conséquent, l'organisme qui divulgue l'information doit respecter certaines exigences en ce qui concerne l'information qu'elle transmet à une autre organisation. »
Les cyber-opérations
La député conservatrice Cheryl Gallant a demandé à la chef du CST, Greta Bossenmaier, si elle pouvait expliquer la nécessité d'inclure le ministre des Affaires étrangères dans la prise de décisions lorsqu'il s'agit d'autoriser des cyberopérations dans les clauses du projet de loi sur la mise sur pied du CST. Elle a répondu que pour des cyber-opérations défensives la ministre devait être consultée mais que dans des opérations « actives » (en réalité, des opérations offensives), l'approbation de la ministre ainsi que du ministre de la Défense serait requise. Elle a affirmé : « Bien entendu, le ministre des Affaires étrangères s'y intéresserait puisqu'il a la responsabilité des affaires internationales et étrangères du Canada, et, comme ces activités visent des cibles étrangères ou des menaces à l'endroit du Canada, nous incluons par conséquent le ministre des Affaires étrangères. »
Le pouvoir d'acquisition d'informations par le CST et le SCRS
Le député néodémocrate Matthew Dubé a soulevé une question au sujet d'une contradiction dans les pouvoirs accordés au CST en lien avec l'acquisition d'information disponible au public et a cité le paragraphe 23(1) : « il est précisé que les activités du Centre 'ne peuvent viser des Canadiens ou des personnes se trouvant au Canada', tandis que nous avons à l'article 24 du projet de loi 'Malgré les paragraphes 23(1) et (2), le Centre peut mener' et ce qui suit a déjà été lu. En gros, nous disons que les activités ne viseraient pas normalement des Canadiens ou des personnes se trouvant au Canada, mais ce n'est plus le cas, parce qu'il est précisé que c'est fait 'malgré' ce que prévoit l'article 23 du projet de loi. » « Acquérir, utiliser, analyser, conserver et divulguer de l'information sur l'infrastructure à des fins de recherche et de développement ou de mise à l'essai de systèmes ou pour mener des activités de cybersécurité et d'assurance de l'information dans l'infrastructure à partir de laquelle celle-ci a été acquise [...] « À mon avis, cela semble créer une situation où vous pourriez recueillir de l'information à partir de l'infrastructure ici au Canada dont se servent évidemment des Canadiens sans nécessairement avoir la même obligation qui est créée en excluant les Canadiens à l'article 23 du projet de loi. » Elle a conclu en disant : « toutes les activités du Centre, y compris toutes celles qui seront menées en vertu du paragraphe 24(1) du projet de loi, feront l'objet des mécanismes de surveillance dont le ministre a déjà parlé concernant l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et évidemment le nouveau Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ». Bossenmaier a aussi expliqué qu'avec ces nouveaux pouvoirs le CST pourrait non seulement répondre à des attaques contre les infrastructures gouvernementales et non gouvernementales, mais aussi « tenter d'empêcher une attaque dirigée contre le Canada, les Canadiens ou une infrastructure canadienne avant même qu'elle se produise ». Le député libéral Michel Picard a posé une question au ministre au sujet de comment le projet de loi C-59 pouvait surmonter les obstacles à la préservation et l'utilisation des informations recueillies en vertu de la décision du juge Noël de la Cour suprême qui avait « trouvé qu'il y avait problème face aux types d'information sur lesquelles on peut enquêter et qui peuvent être conservées et utilisés lors d'une enquête ».[1] Goodale a expliqué que le projet de loi C-59 « donne suite aux conseils et au jugement du juge Noël concernant une procédure ayant trait à la gestion des données et des ensembles de données ». Le directeur du SCRS David Vigneault a expliqué que sous les nouveaux pouvoirs « Le projet de loi C-59 énonce des catégories d'information, qui sont déterminées par le ministre. En tant que directeur, il nous dira quelles catégories d'information nous aurons le droit d'utiliser. Les femmes et les hommes du Service iront chercher cette information de façon organisée. Si cette information fait partie d'un ensemble de données canadiennes, le commissaire au renseignement devra évaluer la décision du ministre. » « Dans le cas d'information canadienne, la Cour fédérale devra déterminer si nous pouvons l'utiliser et la conserver. La façon dont nous allons utiliser cette information sera revue par le nouvel Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et par le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. « La façon dont les catégories sont déterminées par le ministre, la façon dont nous utiliserons l'information canadienne, le rôle que joueront la Cour fédérale et le commissaire au renseignement et le fait que l'utilisation subséquente de cette information sera revue par des comités de supervision, tout cela nous permettra d'utiliser des données qui sont absolument essentielles pour contrer les menaces du XXIe siècle. » Plus tard Vigneault s'est fait demander des précisions par Dubé à propos des « données non sélectionnées ». « [Est-ce] que le ministre et le nouveau commissaire vont déterminer si c'est approprié ou non de rassembler ces données et de les garder. « Comment faites-vous pour distinguer les ensembles de données ? Par exemple, le ministre ou le commissaire pourrait juger un ensemble de données approprié, parce qu'elles sont liées à quelqu'un qui ne constitue pas une menace, mais qui aurait eu une conversation avec un suspect que vous ciblez. Comment distinguez-vous ces données des autres informations concernant les collaborateurs légitimes de la personne qui, eux, peuvent être une menace ? « Pour mieux poser la question, comment faites-vous pour distinguer des autres cas les ensembles de données non sélectionnées qui touchent des gens qui n'ont rien à voir avec le suspect ? » Vigneault a expliqué qu'« il y a donc une révision quasi judiciaire faite par le commissaire au renseignement. Si les données touchent les Canadiens, c'est la Cour fédérale qui va devoir déterminer si c'est absolument nécessaire que le service conserve et utilise les données. La Cour fédérale va faire le test de protection de la vie privée, en vue de nous permettre d'utiliser les données. Le régime qui serait mis en place par le projet de loi C-59 comprend les critères nous permettant d'utiliser les données. » Puis il a ajouté que c'est l'avis du SCRS qu'il faut beaucoup d'informations sur les relations entre Canadiens pour exclure que les Canadiens soient « une menace ». « Avoir les données dans un plus grand ensemble nous permet de caractériser la menace et de dire avec qui tel individu est en contact et si cela constitue une menace ou non. Souvent, cela nous permet d'établir que ce n'est pas une menace. Le fait d'avoir cet ensemble de données fait que le SCRS n'enquête pas sur des personnes innocentes.» Dubé a répondu en demandant « Si la cour juge que vous avez le droit de collecter ces données à cause d'une cible légitime, comment faites-vous pour distinguer la cible légitime des données non sélectionnées qui seront inévitablement collectées ? Un système a-t-il été mis en place ? » Vigneault a répondu sans vraiment s'adresser à la question qu'« il y aura une séparation des données non sélectionnées » et que « Seules les personnes désignées pourront avoir accès à ces données. [...] Les données non sélectionnées seront isolées. Des personnes désignées pourront présenter des requêtes pour les utiliser. Chaque fois que ce sera fait, ces activités seront révisées pour s'assurer que nos procédures et notre mise en oeuvre satisfont à l'esprit de la loi. » Après s'être fait demander de nouveau comment ils vont discriminer l'information, Vigneault a expliqué. « Nous ne commençons pas nos enquêtes à partir des données sélectionnées. Nous les commençons à partir d'éléments liés à la menace. « Si une cible identifiée est impliquée dans des actions potentiellement terroristes ou d'espionnage, et si nous constatons que cette personne est en contact avec quelqu'un -- certaines informations, comme un numéro de téléphone, peuvent nous être utiles --, nous pouvons alors vérifier dans nos données non sélectionnées dont la rétention a été autorisée. Cela fait partie du processus que je vous ai expliqué plus tôt. » « On ne va pas à la pêche », a-t-il affirmé.
Changements à la Loi sur le système de
justice pénale
|

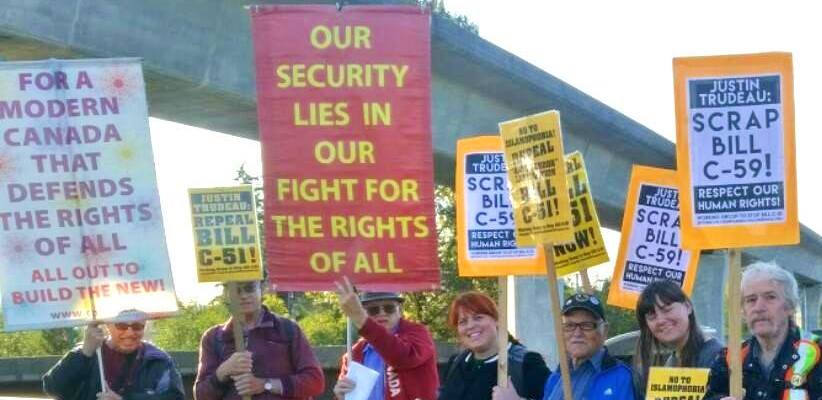


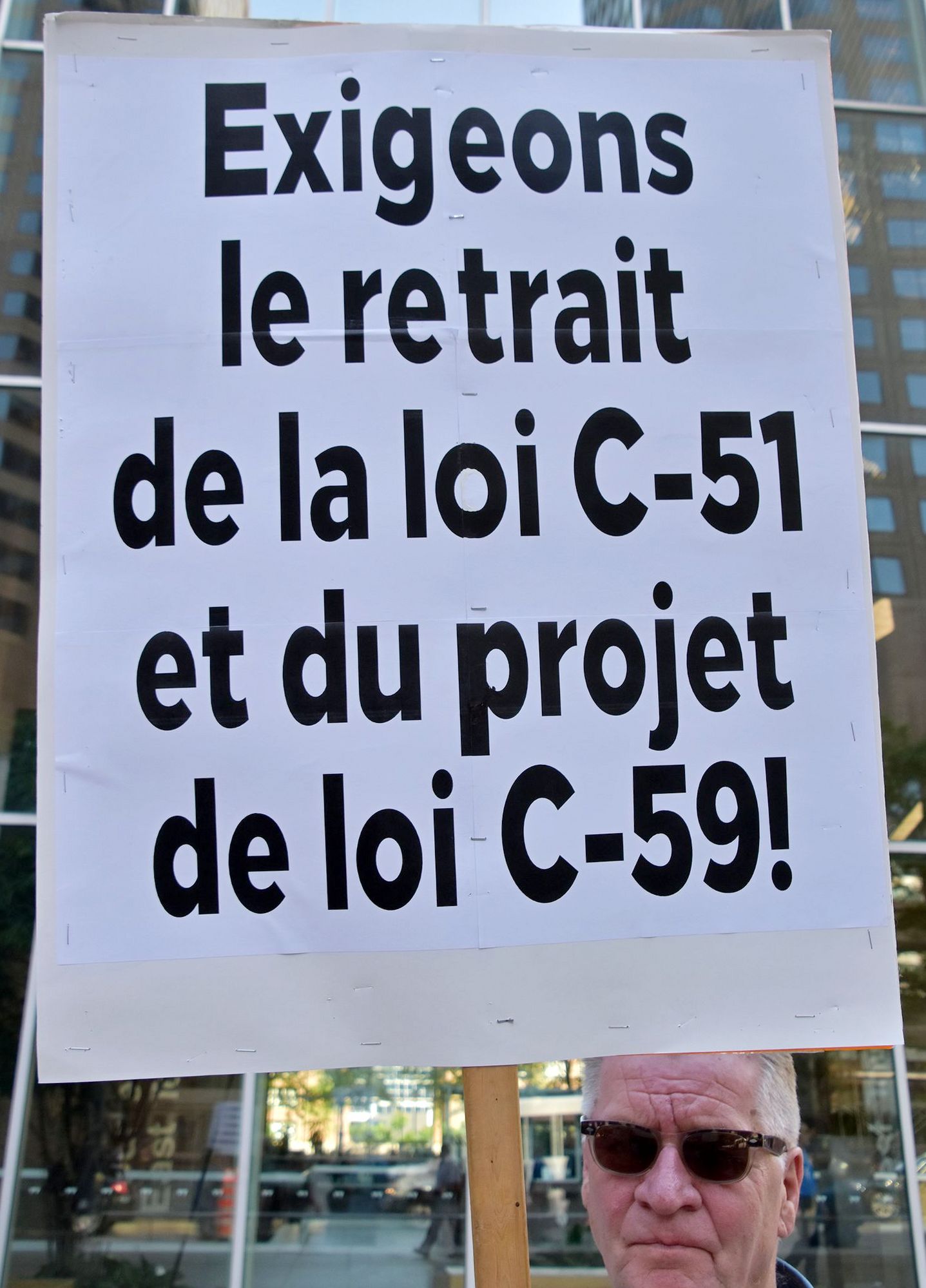

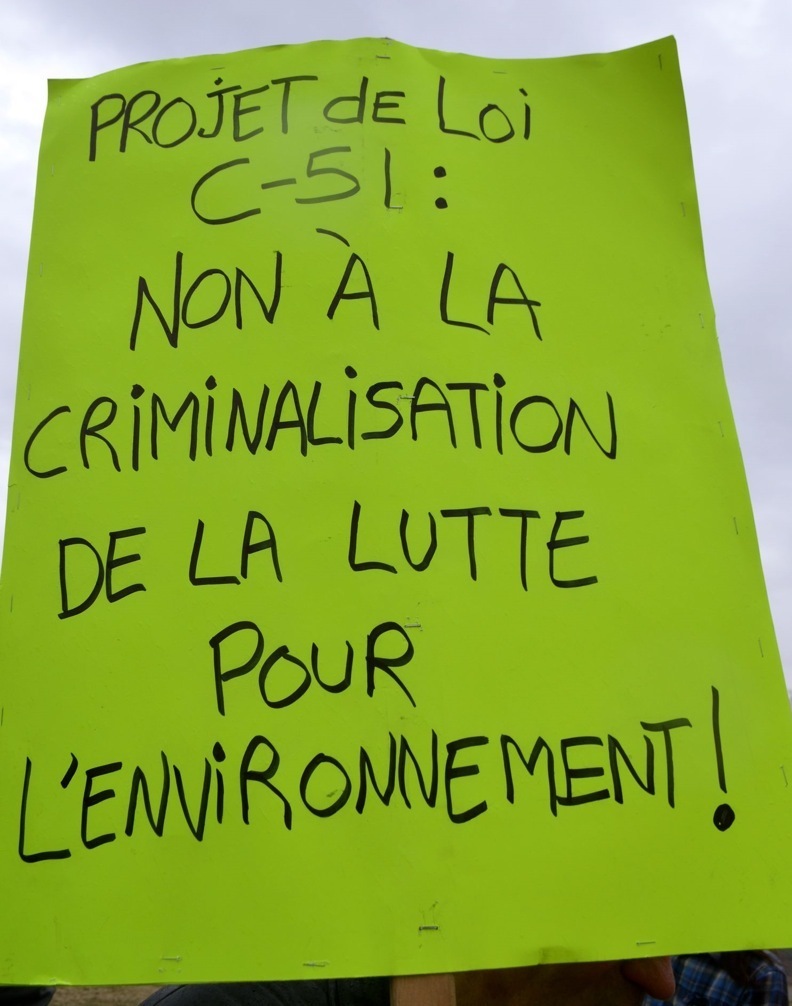
 La chef du CST, Greta
Bossenmaier, a répondu ainsi : « Notre organisme
s'occupe du renseignement électromagnétique
étranger, et nous mettons l'accent sur les cibles
étrangères et les menaces étrangères envers
le Canada. Notre mandat n'est donc pas de mettre l'accent sur les
Canadiens. Nous sommes bel et bien un organisme qui met
l'accent sur les menaces étrangères envers le
Canada. » Plus tard elle ajouta : « Je suis au
paragraphe 24(1) du projet de loi. Dans la première partie,
il est question des « activités ci-après dans la
réalisation de son mandat ». Je répète
que notre mandat a trait au renseignement
électromagnétique étranger et à la
cybersécurité.
C'est vraiment l'élément central qui lie le reste des
alinéas. »
La chef du CST, Greta
Bossenmaier, a répondu ainsi : « Notre organisme
s'occupe du renseignement électromagnétique
étranger, et nous mettons l'accent sur les cibles
étrangères et les menaces étrangères envers
le Canada. Notre mandat n'est donc pas de mettre l'accent sur les
Canadiens. Nous sommes bel et bien un organisme qui met
l'accent sur les menaces étrangères envers le
Canada. » Plus tard elle ajouta : « Je suis au
paragraphe 24(1) du projet de loi. Dans la première partie,
il est question des « activités ci-après dans la
réalisation de son mandat ». Je répète
que notre mandat a trait au renseignement
électromagnétique étranger et à la
cybersécurité.
C'est vraiment l'élément central qui lie le reste des
alinéas. »