|
Numéro 128 - 8 octobre 2016
Défendons les
droits des peuples autochtones!
Des vigiles des Soeurs par l'esprit
affirment que la lutte pour les droits et la justice est indivisible
PDF
Défendons
les
droits
des
peuples
autochtones!
• Des vigiles des Soeurs par
l'esprit affirment que la lutte pour les droits et la justice est
indivisible
• Des actions partout au pays pour
réclamer justice
• Les propos déplacés du premier
ministre sur la reconnaissance et la compréhension
• L'Association des femmes autochtones du
Canada est déçue du peu de progrès de
l'Enquête nationale
L'offensive
néolibérale contre la santé se poursuit
• Les contradictions s'aiguisent entre le
gouvernement fédéral et les provinces
-
Barbara Biley
Plébiscite du 2
octobre en Colombie
• Sur la signification du
vote - Margaret Villamizar
• La manipulation des électeurs est
exposée
• Rencontre des
délégations du Gouvernement national et des FARC-EP
• Qu'est-ce que le Canada manigance en
Colombie?
Défendons les
droits des peuples autochtones!
Des vigiles des Soeurs par l'esprit affirment que la
lutte pour les droits et la justice est indivisible
 Le 4 octobre était la dixième
journée annuelle de vigiles pour honorer la vie des femmes et
filles autochtones disparues et assassinées et exiger des
mesures immédiates de justice et de prévention. Selon de
récentes estimations de l'Association des femmes autochtones du
Canada (AFAC), le nombre de femmes autochtones disparues et
assassinées au Canada depuis 1980 pourrait maintenant se situer
aux alentours de 4000, soit trois frois plus que ce que
prétendait la GRC en 2014. Cette
année les vigiles, marches et autres événements
tenus dans une centaine de communautés à travers le
Canada avaient lieu dans le
contexte du lancement, le 3 août dernier, de l'Enquête
nationale sur les femmes autochtones assassinées et disparues
que demandent depuis longtemps de nombreuses familles. Ils ont lieu
également dans le contexte où apparaît un sentiment
de déception et
de frustration envers les libéraux de Justin Trudeau que
beaucoup perçoivent maintenant comme
un parti qui a exploité les préoccupations et
revendications des peuples autochtones et leur opposition militante au
gouvernement conservateur de Stephen Harper seulement pour se faire
élire.
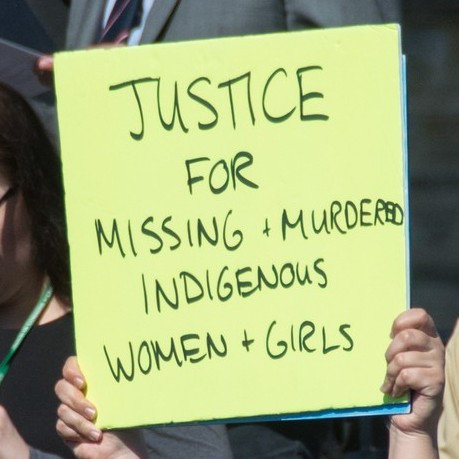 Le gouvernement Trudeau est
arrivé au pouvoir avec la promesse d'agir tout de suite pour
mettre en oeuvre l'ensemble des 94 recommandations de la
Commission de la vérité et réconciliation,
à commencer par l'adhésion à la Déclaration
de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, la promesse de «
renouveler les liens avec les
peuples autochtones et de bâtir une relation de nation à
nation sous le signe de la reconnaissance, des droits, du respect, de
la coopération et du partenariat » et celle
d'éliminer « d'entrée de jeu le plafond
de 2 % sur les programmes destinés aux
Premières Nations ». Près de deux ans
après l'élection, c'est le statu quo sur
tous ces fronts, voire il y a même de nouvelles atteintes aux
droits des autochtones sous l'enseigne du « renouvellement des
relations » avec le gouvernement fédéral.[1] Des décisions concernant le
développement des ressources sur les territoires autochtones
continuent d'être prises par le conseil des
ministres sans le consentement ou même l'avis de leurs habitants.
La relation « renouvelée » ressemble à
un rapport de subordination, à des décisions «
à prendre ou à laisser ». Le gouvernement Trudeau est
arrivé au pouvoir avec la promesse d'agir tout de suite pour
mettre en oeuvre l'ensemble des 94 recommandations de la
Commission de la vérité et réconciliation,
à commencer par l'adhésion à la Déclaration
de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, la promesse de «
renouveler les liens avec les
peuples autochtones et de bâtir une relation de nation à
nation sous le signe de la reconnaissance, des droits, du respect, de
la coopération et du partenariat » et celle
d'éliminer « d'entrée de jeu le plafond
de 2 % sur les programmes destinés aux
Premières Nations ». Près de deux ans
après l'élection, c'est le statu quo sur
tous ces fronts, voire il y a même de nouvelles atteintes aux
droits des autochtones sous l'enseigne du « renouvellement des
relations » avec le gouvernement fédéral.[1] Des décisions concernant le
développement des ressources sur les territoires autochtones
continuent d'être prises par le conseil des
ministres sans le consentement ou même l'avis de leurs habitants.
La relation « renouvelée » ressemble à
un rapport de subordination, à des décisions «
à prendre ou à laisser ».
Beaucoup de familles et d'organisations ont d'ailleurs
profité des événements du 4 octobre pour
exprimer leurs inquiétudes concernant la direction que prend
l'enquête nationale et réitérer le besoin de
s'attaquer aux causes des torts faits aux femmes autochtones en raison
de la préservation des arrangements coloniaux qui sont racistes
à la moelle et qui perpétuent l'injustice. Elles ont
souligné le besoin de
s'attaquer à la racine des torts faits aux femmes autochtones
dans l'État canadien, dans les arrangements coloniaux et dans le
système d'injustice coloniale. Un des messages des familles
était que la lutte pour la justice des femmes disparues et
assassinées et pour affirmer les droits des peuples autochtones
est indivisible. En d'autres mots, la justice et la réparation
pour les femmes autochtones et leurs familles et communautés ne
peuvent être séparées de la reconnaissance
des droits des peuples autochtones. Les familles ont souligné
que le gouvernement libéral de Justin Trudeau ne doit pas se
servir de la cause des femmes autochtones ou de l'enquête
nationale pour des séances de photos tout en continuant de
prendre des décisions unilatérales qui affectent les
peuples autochtones. Elles ont aussi rappelé les
nombreuses solutions et propositions concrètes
présentées par les femmes autochtones au fil des
années et le soutien dont ont besoin les victimes et leurs
familles et que le gouvernement n'a aucune raison légitime de ne
pas agir sur ces questions.
 À Ottawa, les
événements ont commencé par une conférence
de presse des Familles des Soeurs par l'esprit, suivie d'une vigile sur
la colline du Parlement et d'un festin pour les familles des femmes
disparues ou assassinées. On a
également rendu un émouvant hommage à Annie
Pootoogook, une artiste
inuite connue décédée dans des circonstances
suspectes à Ottawa le 19 septembre. Les parents et amis
d'Annie ont dénoncé le racisme de l'enquête de la
police qui
prétend que sa mort n'a rien de suspect alors qu'un des
officiers a été pris à afficher des commentaires
racistes à son sujet sur Internet. Le premier ministre Trudeau
et trois
de ses ministres ont également pris la parole à la
vigile. Ils sont arrivés après
que les autres orateurs aient terminé et n'ont donc tenu compte
d'aucune des questions soulevées par les familles. Beaucoup de
participants ont noté que leurs discours en l'air confirment ce
que les familles craignaient: des discours pour cacher l'absence
d'action. À Ottawa, les
événements ont commencé par une conférence
de presse des Familles des Soeurs par l'esprit, suivie d'une vigile sur
la colline du Parlement et d'un festin pour les familles des femmes
disparues ou assassinées. On a
également rendu un émouvant hommage à Annie
Pootoogook, une artiste
inuite connue décédée dans des circonstances
suspectes à Ottawa le 19 septembre. Les parents et amis
d'Annie ont dénoncé le racisme de l'enquête de la
police qui
prétend que sa mort n'a rien de suspect alors qu'un des
officiers a été pris à afficher des commentaires
racistes à son sujet sur Internet. Le premier ministre Trudeau
et trois
de ses ministres ont également pris la parole à la
vigile. Ils sont arrivés après
que les autres orateurs aient terminé et n'ont donc tenu compte
d'aucune des questions soulevées par les familles. Beaucoup de
participants ont noté que leurs discours en l'air confirment ce
que les familles craignaient: des discours pour cacher l'absence
d'action.

 À la
conférence de presse, Bridget Tolley de la première
nation algonquine Kitigan Zibi, dont la mère Gladys Tolley a
été tuée par un policier dans un délit de
fuite, a exprimé l'inquiétude partagée par
beaucoup de familles du fait que le rôle de la police soit exclu
des
termes de référence officiels de l'enquête. Elle a
rappelé que les policiers ont
blâmé sa mère en disant qu'elle était ivre
au moment de l'incident. Bridget a demandé la tenue d'une
enquête indépendante et a dit regretter que
l'enquête nationale ne se penchera pas sur les autres cas que les
familles porteront à son attention. « Ce n'est pas juste
que l'enquête transmette l'information que nous lui donnons
à ceux contre qui les
plaintes sont portées, la police, a-t-elle ajouté. Nous
avons demandé de l'aide quand les femmes ont été
portées disparues, nous avons demandé de l'aide pour les
familles, mais nos demandes sont restées sans réponse. Je
viens ici depuis 15 ans et rien n'a changé. En fait, je
crois que les choses ont empiré. Mais nous voulons la justice.
Nous
ne voulons plus être ici à chaque année. Nous ne
devrions pas être forcées de supplier pour obtenir
justice. Nos familles méritent justice, nos proches
méritent justice. » À la
conférence de presse, Bridget Tolley de la première
nation algonquine Kitigan Zibi, dont la mère Gladys Tolley a
été tuée par un policier dans un délit de
fuite, a exprimé l'inquiétude partagée par
beaucoup de familles du fait que le rôle de la police soit exclu
des
termes de référence officiels de l'enquête. Elle a
rappelé que les policiers ont
blâmé sa mère en disant qu'elle était ivre
au moment de l'incident. Bridget a demandé la tenue d'une
enquête indépendante et a dit regretter que
l'enquête nationale ne se penchera pas sur les autres cas que les
familles porteront à son attention. « Ce n'est pas juste
que l'enquête transmette l'information que nous lui donnons
à ceux contre qui les
plaintes sont portées, la police, a-t-elle ajouté. Nous
avons demandé de l'aide quand les femmes ont été
portées disparues, nous avons demandé de l'aide pour les
familles, mais nos demandes sont restées sans réponse. Je
viens ici depuis 15 ans et rien n'a changé. En fait, je
crois que les choses ont empiré. Mais nous voulons la justice.
Nous
ne voulons plus être ici à chaque année. Nous ne
devrions pas être forcées de supplier pour obtenir
justice. Nos familles méritent justice, nos proches
méritent justice. »
 Beverly Jacobs, une Mohawk
des Six Nations de la rivière Grand et ancienne
présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada
(AFAC), a parlé de la signification de la terre et du pouvoir
décisionnel concernant la terre en rapport avec l'injustice
coloniale qui se poursuit dans la vie des femmes autochtones. Sa
cousine a été
portée disparue et a été tuée en 2008.
« J'ai un message pour monsieur Trudeau. J'ai un message pour
Carolyn Bennett : vous devez répondre aux interrogations
sur les questions territoriales, a-t-elle dit. Ils doivent comprendre
le rapport direct entre nos femmes et la terre, ils doivent comprendre
que ce sont nos femmes qui sont aux
premiers rangs et qui font tout le travail. Ce sont elles qui sont
ciblées. Nos femmes sont ciblées parce que ce sont elles
qui portent la nation. Nous sommes encore un État colonial, nous
sommes encore un État policier, alors pour ce qui est de la
‘réconciliation', il faut une vraie
réconciliation. » Beverly Jacobs, une Mohawk
des Six Nations de la rivière Grand et ancienne
présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada
(AFAC), a parlé de la signification de la terre et du pouvoir
décisionnel concernant la terre en rapport avec l'injustice
coloniale qui se poursuit dans la vie des femmes autochtones. Sa
cousine a été
portée disparue et a été tuée en 2008.
« J'ai un message pour monsieur Trudeau. J'ai un message pour
Carolyn Bennett : vous devez répondre aux interrogations
sur les questions territoriales, a-t-elle dit. Ils doivent comprendre
le rapport direct entre nos femmes et la terre, ils doivent comprendre
que ce sont nos femmes qui sont aux
premiers rangs et qui font tout le travail. Ce sont elles qui sont
ciblées. Nos femmes sont ciblées parce que ce sont elles
qui portent la nation. Nous sommes encore un État colonial, nous
sommes encore un État policier, alors pour ce qui est de la
‘réconciliation', il faut une vraie
réconciliation. »
Elle a poursuivi : « Nous faisons tout le
travail. Alors que fait le gouvernement ? J'ai répondu aux
excuses de monsieur Harper concernant les écoles
résidentielles et ma réponse était : que
faites-vous pour nous aider ? Vous pouvez présenter toutes
les excuses que vous voulez, mais ce sont les actes qui comptent. Et
c'est la même chose pour Trudeau. Il est le chef du gouvernement
qui approuve les permis d'exploitation minière. Alors c'est
très important que nous comprenions ce rapport direct et les
raisons pour lesquelles nos femmes sont assassinées et
disparues. » Elle a rappelé que les familles «
ont une compréhension commune du tableau
d'ensemble des femmes autochtones disparues et assassinées, et
c'est la colonisation, c'est l'impact de la colonisation et le
traumatisme historique, il faut le reconnaître. »
 La vigile a
été ouverte par un discours et un chant honorifique de
Jocelyn Wabano-Iahtail, une membre de la nation crie d'Attawapiskat qui
vit maintenant à Ottawa et qui est bien connue pour ses
interventions à la défense de bonnes causes. Elle
a dit que le gouvernement ne peut pas parler de relations de nation
à nation pour ensuite
conclure des accords à l'insu de tout le monde et qu'elle et les
autres victimes, familles et communautés sont résolues
à prendre les choses en
main et à se représenter elles-mêmes. Elle a
réitéré que l'enquête sur les femmes
disparues et assassinées doit être holistique et
basée sur les pratiques autochtones. « Le Canada se vante
d'être le meilleur pays au monde, a-t-elle dit,
et pourtant les femmes autochtones du Canada vivent cette
brutalité. Nous demandons de ne pas être
déplacées physiquement, mentalement,
émotionnellement, spirituellement. » Jocelyn a
également pris part au dévoilement du Monument des robes
rouges pour rendre hommage à sa fille, Nitayheh, qu'elle a
perdue le 13
novembre 2001. La vigile a
été ouverte par un discours et un chant honorifique de
Jocelyn Wabano-Iahtail, une membre de la nation crie d'Attawapiskat qui
vit maintenant à Ottawa et qui est bien connue pour ses
interventions à la défense de bonnes causes. Elle
a dit que le gouvernement ne peut pas parler de relations de nation
à nation pour ensuite
conclure des accords à l'insu de tout le monde et qu'elle et les
autres victimes, familles et communautés sont résolues
à prendre les choses en
main et à se représenter elles-mêmes. Elle a
réitéré que l'enquête sur les femmes
disparues et assassinées doit être holistique et
basée sur les pratiques autochtones. « Le Canada se vante
d'être le meilleur pays au monde, a-t-elle dit,
et pourtant les femmes autochtones du Canada vivent cette
brutalité. Nous demandons de ne pas être
déplacées physiquement, mentalement,
émotionnellement, spirituellement. » Jocelyn a
également pris part au dévoilement du Monument des robes
rouges pour rendre hommage à sa fille, Nitayheh, qu'elle a
perdue le 13
novembre 2001.
Laurie Odjick, dont la fille Maisy et son amie Shannon
Alexander, de Maniwaki, Québec, ont été
portées disparues en septembre 2008, a
déploré que « le gouvernement se serve de
l'enquête nationale pour balayer de côté les
préoccupations des familles. Nous n'avons pas eu de
résolution de deuil et certaines d'entre nous n'en auront
jamais. J'aimerais demander aux gens qui siègent dans cet
immeuble derrière moi ce qu'ils feraient si c'était leur
fille ? Pensez-vous que vous auriez assez fait ? Nous donner
une enquête pour nous faire taire ? », a-t-elle
demandé.
 « Pourtant ils nous
font revivre le traumatisme en nous traînant dans ce cauchemar.
Et moi j'en ai assez. J'en ai assez d'entendre nos dirigeants dire
qu'ils sont avec nous mais quand nous allons frapper à leurs
portes, ils ne répondent pas. Ils sont là pour la
séance de photos. Et j'en ai assez, je veux la justice pour ma
fille et pour Shannon, pour
toutes ces femmes : nos soeurs, nos enfants, nos tantes, nos
grand-mères, nos proches. C'est nous qui vivons le cauchemar,
pas eux, et ils doivent le comprendre. Ils nous font des promesses
mais, vous savez, nous n'avons rien reçu jusqu'à
présent. Rien de cette enquête. Ils vont prendre plusieurs
années à préparer un rapport alors que tant de
rapports ont déjà été
présentés », a dit Laurie. « Pourtant ils nous
font revivre le traumatisme en nous traînant dans ce cauchemar.
Et moi j'en ai assez. J'en ai assez d'entendre nos dirigeants dire
qu'ils sont avec nous mais quand nous allons frapper à leurs
portes, ils ne répondent pas. Ils sont là pour la
séance de photos. Et j'en ai assez, je veux la justice pour ma
fille et pour Shannon, pour
toutes ces femmes : nos soeurs, nos enfants, nos tantes, nos
grand-mères, nos proches. C'est nous qui vivons le cauchemar,
pas eux, et ils doivent le comprendre. Ils nous font des promesses
mais, vous savez, nous n'avons rien reçu jusqu'à
présent. Rien de cette enquête. Ils vont prendre plusieurs
années à préparer un rapport alors que tant de
rapports ont déjà été
présentés », a dit Laurie.
Elle a conclu en disant : « Je me suis
toujours exprimée clairement, j'ai toujours été
méfiante à propos de l'enquête. Je soutiens les
familles qui en veulent une, des familles qui sont méfiantes
comme moi. J'ai peur que mes soeurs soient meurtries encore une fois
par de fausses promesses. Où est l'aide pour nos familles, pour
les
traitements, pour les traumatismes, pour les dépendances qui
viennent avec tout cela ? L'aide dont nous avons besoin, il n'y en
a pas, je ne la vois pas. Encore une fois, j'aimerais demander à
ceux qui sont à la Chambre des Promesses rompues derrière
moi, que feriez-vous si c'était votre fille, votre enfant ?
Que
demanderiez-vous ? Car moi je vais revenir, année
après année. Je vais continuer de dire ce que j'ai
à dire. Ma force vient de ces familles. Nous sommes ici ensemble
et nous sommes plus fortes que cette chambre derrière
moi. »
Connie Greyeyes, qui est venue de Fort St. John, en
Colombie-Britannique, pour prendre part à la vigile, a
expliqué le rapport entre les crimes contre les femmes
autochtones et les décisions du conseil des ministre sans le
consentement du peuple. Connie est bénévole à la
Women's Resource Society de Fort St. John et elle a fondé le
groupe de
soutien des femmes Warriors pour les familles des femmes autochtones
disparues et assassinées. Elle a parlé du meurtre de sa
cousine, Joyce Cardinal, en 1993. Parlant du premier ministre,
elle a dit : « Malheureusement, la personne à qui
j'aurais voulu adresser le message des gens du nord de la
Colombie-Britannique n'est pas
ici. »

« Ils doivent comprendre que nous vivons dans une
communauté où il y a beaucoup d'exploitation des
ressources, a poursuivi Connie. Et je ne crois pas que ce soit une
coïncidence qu'avec cette immense exploitation des ressources
à Fort St. John, Colombie-Britannique, il y ait toute cette
violence envers les femmes et les filles autochtones.
Comme le disait Laurie, ils ont annoncé l'enquête mais que
vont-ils faire maintenant ? Pourquoi ne contactent-ils pas les
familles, les gens qui sont aux premières lignes, qui se
battent ? Ce sont des paroles en l'air. Ça ressemble
à des paroles en l'air. Ils parlent d'honorer et
d'établir un nouveau rapport avec les peuples autochtones du
Canada. Et pourtant ce gouvernement vient d'autoriser d'autres permis
pour la construction d'un barrage dans notre région, le barrage
Site C.
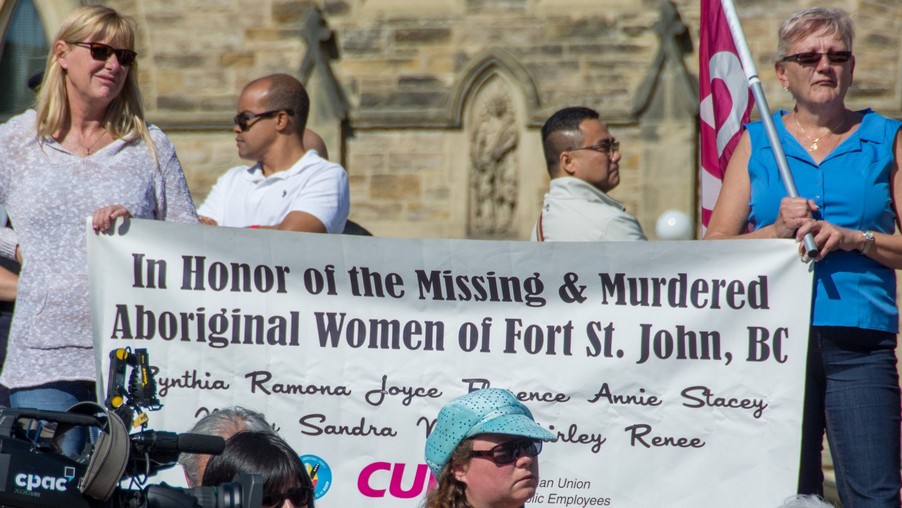
« Mon amie Helen Knott a mentionné que
leur réconciliation ressemble beaucoup à de la
colonisation. Des promesses sans lendemain, la promesse qu'ils vont
‘travailler avec nous'. Comment pouvons-nous nous attendre à ce
que la population générale nous respecte et nous traite
en égaux si le gouvernement ne le fait pas ? Nous sommes
revenues si souvent sur ces escaliers pour parler de Molly [Apsassin],
de Florence [McLeod] et de René [Gunning]. Combien
d'années encore faudra-t-il revenir ici et les supplier qu'ils
nous écoutent ? Pour obtenir justice pour nos femmes et nos
filles ? Comme le disait Laurie, nous allons continuer de venir et
d'exiger des comptes,
d'élever la voix, de leur dire que c'est assez. Nous avons
besoin de gestes, pas de séances de photos. Parce que quand vous
approuvez des projets comme le barrage Site C dans ma région,
vous approuvez la violence envers nos femmes autochtones de la
région de Peace. C'est ce que vous approuvez. Vous ne pouvez pas
blâmer le gouvernement
précédent pour ce que vous faites
aujourd'hui. »
LML salue les familles et les Soeurs par
l'esprit qui ont averti le gouvernement libéral de Justin
Trudeau qu'elles ne seront pas réduites au silence et
n'accepteront pas que les choses continuent comme si de rien
n'était. Le gouvernement libéral et les
intérêts qu'il représente ne réussiront pas
à berner les peuples autochtones sur ce que
veut dire réconciliation, reconnaissance des droits et relation
de nation à nation. LML appelle les Canadiens à
soutenir la revendication des peuples autochtones à la
reconnaissance de leurs droits et de leur souveraineté.

Note
1. Voir «
Les consultations bidons du gouvernement
fédéral », LML , 20
septembre 2016

Des actions partout au pays pour
réclamer justice

Les propos déplacés du premier ministre
sur la reconnaissance et la compréhension
Vers la fin de la vigile des Familles des Soeurs par
l'esprit sur la colline du Parlement le 4 octobre, le premier
ministre Justin Trudeau est arrivé avec son entourage de
ministres pour s'adresser à la foule. L'essentiel de ses propos
est capté dans cette phrase: « Nous avons tous
beaucoup de travail
à faire », comme s'il laissait entendre que lui fait sa
part
mais que les autres, les peuples autochtones comme le reste des
Canadiens, doivent faire la leur. Il
laisse entendre que si les gens ne renoncent pas à leurs droits
et à leur position indépendante et ne se joignent pas
à son « nous », alors ils font partie du
problème plutôt que de la solution et sont la raison pour
laquelle les choses n'avancent pas. La foule ne semble pas avoir
très apprécié les propos du premier ministre qui
n'ont d'ailleurs pas été rendus publics, ni par son
cabinet, ni par les agences et ministères.
 Le premier ministre a
commencé en contredisant les intervenantes avant lui qui avaient
exprimé leur dégoût de devoir revenir devant le
parlement chaque année comme elles le font depuis dix ans alors
que les
femmes et filles continuent de subir les mêmes torts parce que le
gouvernement fédéral ne prend pas les mesures
nécessaires pour que justice soit faite. Il a dit: « Je
dois
d'abord dire que je ne suis pas d'accord avec plusieurs des
intervenantes qui m'ont précédé. J'espère,
moi, que nous allons continuer de nous réunir sur ces escaliers
tant que le Parlement derrière moi sera là, pendant de
nombreuses années, de
nombreux siècles encore, pour nous remémorer les
merveilleuses
femmes, les soeurs, qui nous ont été enlevées,
pour
nous rappeler que nous n'avons pas été capables de les
protéger. » Continuant de faire la sourde oreille aux
demandes que justice soit faite dans les faits, pas en paroles, le
premier ministre a
ensuite dit « espérer » que dans les
années qui viennent « nous allons pouvoir le faire comme
une commémoration de choses passées et non plus comme
l'expression d'une
tragédie nationale qui perdure. » Le premier ministre a
commencé en contredisant les intervenantes avant lui qui avaient
exprimé leur dégoût de devoir revenir devant le
parlement chaque année comme elles le font depuis dix ans alors
que les
femmes et filles continuent de subir les mêmes torts parce que le
gouvernement fédéral ne prend pas les mesures
nécessaires pour que justice soit faite. Il a dit: « Je
dois
d'abord dire que je ne suis pas d'accord avec plusieurs des
intervenantes qui m'ont précédé. J'espère,
moi, que nous allons continuer de nous réunir sur ces escaliers
tant que le Parlement derrière moi sera là, pendant de
nombreuses années, de
nombreux siècles encore, pour nous remémorer les
merveilleuses
femmes, les soeurs, qui nous ont été enlevées,
pour
nous rappeler que nous n'avons pas été capables de les
protéger. » Continuant de faire la sourde oreille aux
demandes que justice soit faite dans les faits, pas en paroles, le
premier ministre a
ensuite dit « espérer » que dans les
années qui viennent « nous allons pouvoir le faire comme
une commémoration de choses passées et non plus comme
l'expression d'une
tragédie nationale qui perdure. »
Il a dit
que, dans le passé, le Parlement et ses députés
« ont échoué à défendre les valeurs
et les principes que nous devions défendre, que nous avons
spécifiquement manqué à nos devoirs envers les
femmes autochtones disparues ou assassinées et d'autres, et que
nous n'avons pas su défendre l'esprit, l'intention des rapports
originaux entre
les peuples autochtones et ceux qui sont arrivés sur ce
continent ». Il n'a pas précisé quel
était cet « esprit et intention originale » des
rapports en question mais il n'y a rien dans le passé qui
ressemble à des rapports modernes basés sur
l'élimination de l'injustice coloniale et la reconnaissance des
droits, rien qui ressemble à une union
égale entre les nations enchâssées dans une
constitution moderne. L'échec à respecter « les
rapports originaux », a-t-il dit, « n'est pas quelque
chose que nous allons pouvoir changer du jour au lendemain, ou dans une
semaine, ni même un mois ou une année. Nous allons devoir
nous engager à y travailler à tous les jours, à
réparer, à
améliorer, à bâtir la confiance brisée,
à redonner l'espoir. Ce n'est pas quelque chose qu'un premier
ministre ou un gouvernement peut faire tout seul. »
Le premier ministre a continué de parler de ces
«
rapports originaux » inventés en laissant entendre
qu'il est trop tôt pour s'attendre à ce que ces rapports
soient rétablis, son gouvernement étant au pouvoir depuis
moins d'un an, mais il a rassuré les participants que
«nous» allons «y travailler à tous les
jours». Il a encore une fois fait la sourde oreille à la
demande de justice dans les faits en disant que c'est un
«problème d'attitude» que nous avons tous en commun.
« Tous ceux et celles qui vivent
dans ce pays aujourd'hui partagent la responsabilité d'honorer
ceux et celles qui ont toujours vécu ici, qui nous ont
accueillis, qui nous ont aidés à passer les premiers
longs hivers, et qui beaucoup trop souvent ont reçu en retour la
négligence,
l'indifférence et la colère», a-t-il dit. Faisant
référence au Parlement canadien, qui est en fait le
symbole de la Loi sur les Indiens,
une
loi
raciste,
et
de
toutes
les
décisions
qui
ont mené
à la dépossession des peuples autochtones passés
et présents, Justin Trudeau a parlé d'une abstraction sur
laquelle aucun groupe d'intérêt spécial n'a de
contrôle. Il a dit: «Cet
édifice est une représentation de ce pays et continue
d'être une représentation de nos échecs à
gouverner véritablement et sincèrement pour tous ceux et
celles qui partagent ce territoire. Et je comprends l'impatience, les
frustrations. Je les partage. Nous avons tous beaucoup de travail
à faire. »
Prétendant partager les frustrations de ceux
pour qui le gouvernement ne gouverne pas « véritablement
et sincèrement », Justin Trudeau a
déclaré que « nous devons
tous » voir à ce qu'il le fasse. Il rappelle que le
gouvernement a lancé une enquête nationale et qu'il y a
« beaucoup beaucoup plus à faire pour mettre fin au cycle
de violence, de
pauvreté, de manque d'espoir qui est la réalité
pour de trop nombreux Canadiens autochtones ». On a senti
que ses
supplications que tous comprennent et pardonnent au gouvernement son
inaction ont commencé commençait à
créer l'impatience dans la foule. Il a
dit: « Je
suis ici pour dire que nous allons continuer de travailler fort et
d'essayer de travailler encore plus fort. Nous allons continuer
d'écouter et d'entendre les frustrations, la colère, les
inquiétudes, mais aussi les offres d'aide et de partenariat, la
reconnaissance que nous avons tous beaucoup à faire pour changer
la situation que nous vivons. Je suis ici comme une des nombreuses
personnes qui ont pris cet engagement. »
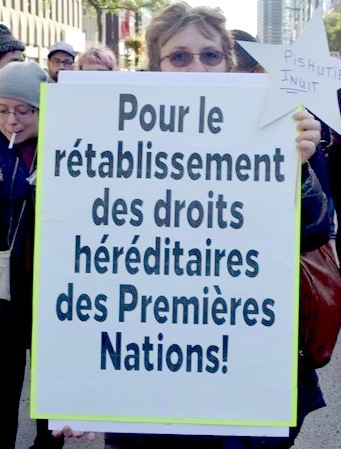 Le premier ministre et
son gouvernement semblent croire qu'il est acceptable de fouler au pied
les droits du peuple s'il y a suffisamment de sincérité
dans les voeux du gouvernement. Il a eu le front de parler du «
leadership extraordinaire » de la
ministre de la Condition féminine, de la ministre de la Justice
et Procureure générale et de la ministre des Affaires
autochtones
et du Nord qui « m'inspirent chaque jour ». Il a
déclaré qu'« il n'y a pas de relation plus
importante que celle que nous en tant que gouvernement du Canada
bâtissons, rebâtissons et réparons, avec laquelle
nous avançons, que la relation avec les Canadiens
autochtones », comme s'il pouvait changer la nature des
«nouveaux rapports» que son gouvernement impose aujourd'hui
par de belles phrases. Il part déjà d'un très
mauvais pied en se référant aux peuples
autochtones comme des « Canadiens autochtones ». Le premier ministre et
son gouvernement semblent croire qu'il est acceptable de fouler au pied
les droits du peuple s'il y a suffisamment de sincérité
dans les voeux du gouvernement. Il a eu le front de parler du «
leadership extraordinaire » de la
ministre de la Condition féminine, de la ministre de la Justice
et Procureure générale et de la ministre des Affaires
autochtones
et du Nord qui « m'inspirent chaque jour ». Il a
déclaré qu'« il n'y a pas de relation plus
importante que celle que nous en tant que gouvernement du Canada
bâtissons, rebâtissons et réparons, avec laquelle
nous avançons, que la relation avec les Canadiens
autochtones », comme s'il pouvait changer la nature des
«nouveaux rapports» que son gouvernement impose aujourd'hui
par de belles phrases. Il part déjà d'un très
mauvais pied en se référant aux peuples
autochtones comme des « Canadiens autochtones ».
« J'espère
que plus de Canadiens et de Canadiens vont vivre,
comme nous, tous les jours comme un rappel des belles âmes qui
nous ont été enlevées, des avenirs qui ne se
réaliseront pas et du travail formidable que nous allons devoir
continuer de faire », a dit le premier ministre. S'il veut que
les autres vivent comme lui, il n'a qu'à donner aux peuples
autochtones le pouvoir de prendre les décisions qui les
affectent. Mais évidemment, c'est ce qu'il ne fera pas et c'est
précisément là le problème.

L'Association des femmes autochtones du Canada est
déçue du peu de progrès de l'Enquête
nationale

À l'occasion des veilles de Soeurs par l'esprit
du 4 octobre, nous avons entendu des membres de familles
autochtones éprouvées par la disparition ou le meurtre
d'un être cher exprimer leur déception et leurs
préoccupations du fait que l'enquête nationale tarde
à commencer.
L'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) veut aussi
exprimer sa déception et sa frustration face à l'absence
de progrès substantiels de l'enquête nationale sur les
femmes et les filles autochtones disparues et assassinées depuis
son lancement, le 3 août 2016.
« Nous sommes très
inquiètes », a dit la présidente de l'AFAC,
Francyne Joe. « Le mandat de deux ans de la commission
laisse très peu de temps pour les tâches qui font l'objet
de son mandat : établir des organismes consultatifs
régionaux et
portant sur certains aspects particuliers de la question, créer
des services de consultation sensibles à la culture et
conscients de l'importance des traumatismes, mettre en marche un
important processus d'écoute des familles, des êtres chers
et des survivantes dans l'expression de leurs histoires, partout au
Canada. »
« Après 11 années au
cours desquelles nous avons fait de la recherche en profondeur,
publié des rapports volumineux et mené des campagnes de
sensibilisation pour la tenue d'une enquête nationale sur les
taux alarmants de violence envers les femmes et les filles autochtones,
nous
sommes très déçues de voir que plus de deux mois
après le début d'un mandat de deux ans, l'enquête
ne semble avoir fait aucun progrès. Les membres des familles et
les êtres chers éprouvés attendent depuis des
décennies l'occasion de se faire entendre. Nous
reconnaissons que c'est une tâche exigeante que de lancer le
processus d'une enquête nationale, mais le manque de
communication est décevant et inquiétant », a
dit la présidente Francyne Joe.
 Les membres des familles, les
êtres chers et les survivantes méritent une enquête
nationale transparente, capable de rendre la justice et d'honorer
correctement les plus de 1200 femmes et filles autochtones
disparues et assassinées au Canada. Pour que l'enquête
nationale soit transparente, il faut, entre
autres éléments d'infrastructure nécessaires
à la réussite de l'enquête, de l'information
facilement accessible sur l'emplacement des bureaux dans les
différentes régions du Canada et les coordonnées
des commissaires et de leur personnel, un guide étape par
étape de
participation à l'enquête et un site Web simple et
cohérent. Les membres des familles, les
êtres chers et les survivantes méritent une enquête
nationale transparente, capable de rendre la justice et d'honorer
correctement les plus de 1200 femmes et filles autochtones
disparues et assassinées au Canada. Pour que l'enquête
nationale soit transparente, il faut, entre
autres éléments d'infrastructure nécessaires
à la réussite de l'enquête, de l'information
facilement accessible sur l'emplacement des bureaux dans les
différentes régions du Canada et les coordonnées
des commissaires et de leur personnel, un guide étape par
étape de
participation à l'enquête et un site Web simple et
cohérent.
Le moment est venu pour la commission d'enquête
de démontrer sa compétence en s'attaquant
adéquatement aux causes systémiques qui sous-tendent les
taux élevés de violence envers les femmes et les filles
autochtones. L'immense responsabilité associée à
la
tâche énorme d'aborder l'un des pires cas de violations
des droits de la personne de toute l'histoire du Canada ne laisse place
à aucun gaspillage. C'est maintenant qu'il faut commencer cet
important travail.
L'Association des femmes autochtones du Canada entend
surveiller le progrès accompli par l'enquête nationale et
continuera d'exercer des pressions sur la commission d'enquête
pour qu'elle se montre à la hauteur des attentes
élevées des familles éprouvées.

L'offensive néolibérale
contre la santé se poursuit
Les contradictions s'aiguisent entre le gouvernement
fédéral et les provinces
- Barbara Biley -
Les
différends
intergouvernementaux
sur
le
financement
des
soins
de
santé
font
partie
de
la
lutte
intermonopoliste
pour
enrichir
des
intérêts
privés
particuliers.
Ces
conflits
ne
visent
pas
à résoudre les problèmes de la
construction d'un système moderne de soins de santé mais,
au contraire, sont un symptôme de la crise du système.
 Le gouvernement
majoritaire de Trudeau, à l'instar du gouvernement Harper, pense
qu'il a pour mandat d'agir dans l'intérêt de monopoles
particuliers dans leur poursuite d'édification d'empire et non
pas dans l'intérêt des Canadiens et de
l'édification d'une nation moderne. Un système de soins
de santé moderne et efficace qui réponde
impérativement aux besoins de tous les Canadiens exige la
restriction du droit de monopole. Les monopoles existants dans le
secteur de la santé doivent être privés de leur
droit de monopole avec lequel ils imposent leur objectif étroit
sur le secteur pour servir leurs intérêts privés.
Pour garantir le droit de l'ensemble des Canadiens à des soins
de santé complets, il faut un système de santé
moderne qui a comme objectif et mandat précis de garantir
inconditionnellement le droit de tous à des soins de
santé. Il en va de même pour le droit de tous à
l'éducation. C'est un élément crucial du projet
d'édification nationale de la classe ouvrière. Le gouvernement
majoritaire de Trudeau, à l'instar du gouvernement Harper, pense
qu'il a pour mandat d'agir dans l'intérêt de monopoles
particuliers dans leur poursuite d'édification d'empire et non
pas dans l'intérêt des Canadiens et de
l'édification d'une nation moderne. Un système de soins
de santé moderne et efficace qui réponde
impérativement aux besoins de tous les Canadiens exige la
restriction du droit de monopole. Les monopoles existants dans le
secteur de la santé doivent être privés de leur
droit de monopole avec lequel ils imposent leur objectif étroit
sur le secteur pour servir leurs intérêts privés.
Pour garantir le droit de l'ensemble des Canadiens à des soins
de santé complets, il faut un système de santé
moderne qui a comme objectif et mandat précis de garantir
inconditionnellement le droit de tous à des soins de
santé. Il en va de même pour le droit de tous à
l'éducation. C'est un élément crucial du projet
d'édification nationale de la classe ouvrière.
Les
querelles intergouvernementales sur le contrôle
des
dépenses en santé
Lorsque
la ministre de la Santé du gouvernement libéral
nouvellement élu a rencontré en janvier ses homologues
des provinces et des territoires, la question du financement
fédéral aux provinces a été soulevée
par les ministres de la Santé des provinces et des territoires.
Il s'agissait de la première réunion
fédérale-provinciale sur la santé depuis la
déclaration unilatérale du gouvernement Harper qu'il n'y
aurait aucun renouvellement de l'Accord 2004-2014 sur la santé
et qu'en 2017 les transferts fédéraux baisseraient, que
l'augmentation annuelle garantie de 6 % du financement serait
remplacée par une augmentation liée à la
croissance économique et plafonnée à 3 %. Lors de
la conférence de janvier, la ministre fédérale de
la Santé, Jane Philpott, a déclaré qu'elle ne
voulait pas que la discussion sur le financement devienne une «
distraction ». S'adressant à la presse après la
conférence, les ministres provinciaux de la Santé ont
annoncé qu'ils continueraient de soulever la question du
financement lors des prochaines rencontres.
Pendant
la
campagne
électorale
de
2015,
les
libéraux
s'étaient
engagés
à
négocier
un
nouvel
Accord
sur
la
santé
avec
les
provinces
et
les
territoires
et
semblaient
prendre
leurs distances face au diktat du gouvernement
Harper. La réduction du financement qui doit entrer en vigueur
en 2017 représenterait, selon l'estimation du directeur
parlementaire du budget, une réduction du financement de 36
milliards $ de 2014 à 2024. L'Accord sur la santé de 10
ans
qui a été négocié en 2003 comprend, en plus
de la formule de financement, des engagements concernant des normes
nationales pour les soins à domicile, les régimes
d'assurance-médicaments, les listes d'attente pour les
interventions chirurgicales et d'autres questions, engagements qui,
pour l'essentiel, n'ont pas été remplis.
Depuis
le
mois
de
janvier,
il
n'y
a
pas
eu
de
nouvelle
rencontre
des
ministres
de
la
Santé
pour
discuter
d'un
nouvel
accord
sur
la
santé.
Les premiers ministres des provinces et des territoires
ont envoyé une lettre à Trudeau à la suite de leur
rencontre à Whitehorse en juillet dans laquelle ils exigent une
rencontre avec le premier ministre spécifiquement sur les
transferts du gouvernement fédéral en santé.

Manifestation à la rencontre des
ministres de la Santé à Vancouver le 20 janvier 2016
Alors
que
l'année
2017
approche
à
grands
pas
et
avec
elle
la
baisse
du
financement
fédéral
en
santé,
les
premiers
ministres
des
provinces
et
des
territoires
ont envoyé
une deuxième lettre à Justin Trudeau le 15 septembre dans
laquelle ils exigent une rencontre avec lui avant leur réunion
sur les changements climatiques. Si cela n'était pas possible,
ils demandaient au moins un engagement de repousser d'une année
la réduction du financement de la santé. Au nom des
premiers ministres, le premier ministre du Yukon, Darrell Pasloski, a
écrit : « Dans un esprit de collaboration et pour
refléter l'importance de l'enjeu, nous croyons que la tenue de
cette rencontre devrait être confirmée avant la rencontre
des premiers ministres sur les changements climatiques et la croissance
propre. »
La
querelle
s'est
envenimée
le
29
septembre
lors
du
Sommet
de
la
santé
Canada
2020
à
Ottawa,
auquel
la
ministre
de
la
Santé
du
gouvernement
fédéral,
Jane Philpott, et
le ministre de la Santé du Québec, Gaétan
Barrette, étaient des orateurs. Le conflit entre la vision des
libéraux fédéraux des ententes avec les provinces
et les territoires et les points de certains représentants
provinciaux a été fortement et publiquement
affiché. La ministre Philpott a présenté
essentiellement le même point de vue qu'elle avait
présenté au Sommet des soins de santé Canada 2020
de 2015. Selon la presse, elle a déclaré : « Nous
savons qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans
le domaine des soins de santé qui ne nécessitent pas de
dépenser plus d'argent... Il y a beaucoup d'inefficacité,
beaucoup de compartimentation ou de fragmentation. Beaucoup d'experts,
à travers le pays, savent que nous pouvons construire des
systèmes plus efficaces. Nous nous tournons vers l'innovation et
nous sommes impatients de construire de meilleurs modèles de
soins. »
Le
ministre
de
la
santé
du
Québec,
Gaétan
Barrette,
a
parlé
après
Jane
Philpott
et
a
soutenu
que
la
question
des
transferts
fédéraux
aux
provinces
et
aux territoires
est une préoccupation immédiate. Il a
déclaré : « Il faut financer tout d'abord les
services qui sont actuellement fournis et nécessaires avant de
parler de nouveaux programmes. » La Presse canadienne rapporte
que le ministre Barrette a déclaré aux journalistes lors
d'un point de presse après les discours que « c'est le
piège vers lequel le gouvernement fédéral nous
pousse. Nous ne parlons pas des vraies choses qui sont primordiales —
le financement. » Il a ajouté : « Parler de
conditions est leur façon de ne pas parler du financement, et
nous sommes tous pris au piège. »
Ce
«
parler
des
conditions
»
est
la
volonté
du
gouvernement
fédéral
d'arrimer
des
conditions
au
financement
fédéral
des
soins
de
santé.
Cette
possibilité
a
provoqué
des
discussions entre les premiers
ministres sur ce que chacun accepterait en termes des conditions. En
grande partie, l'accrochage sur les « conditions » est une
lutte entre les deux ordres de gouvernement au sujet de l'utilisation
et du contrôle des fonds publics.
Comment
les
décisions sont prises
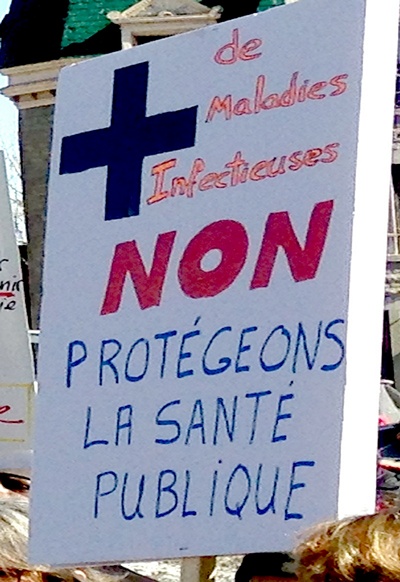 Le gouvernement
Trudeau suit le mode de fonctionnement du gouvernement Harper qui
était de faire des annonces de politique gouvernementale aux
médias ou lors d'événements publics sans passer
par le parlement, sans rencontres avec les premiers ministres
provinciaux ou les ministres compétents. Quant aux Canadiens,
ils sont complètement exclus de la discussion et sont la cible
de la désinformation intéressée et des campagnes
de relations publiques conçues pour créer de l'appui
à ce que les libéraux ont déjà
décidé ou à ce que les monopoles ont
décidé qu'ils voulaient que les libéraux
instaurent. Un plan est établi, puis par des consultations, les
gens sont invités à donner leur avis sur un ordre du jour
prédéterminé. Les libéraux agissent de la
même manière avec les consultations sur la réforme
électorale ou celles sur Postes Canada et ils recrutent les
médias et des groupes de réflexion monopolisés
pour marginaliser les Canadiens et exclure leur réflexion sur la
façon de résoudre les problèmes. Le gouvernement
Trudeau suit le mode de fonctionnement du gouvernement Harper qui
était de faire des annonces de politique gouvernementale aux
médias ou lors d'événements publics sans passer
par le parlement, sans rencontres avec les premiers ministres
provinciaux ou les ministres compétents. Quant aux Canadiens,
ils sont complètement exclus de la discussion et sont la cible
de la désinformation intéressée et des campagnes
de relations publiques conçues pour créer de l'appui
à ce que les libéraux ont déjà
décidé ou à ce que les monopoles ont
décidé qu'ils voulaient que les libéraux
instaurent. Un plan est établi, puis par des consultations, les
gens sont invités à donner leur avis sur un ordre du jour
prédéterminé. Les libéraux agissent de la
même manière avec les consultations sur la réforme
électorale ou celles sur Postes Canada et ils recrutent les
médias et des groupes de réflexion monopolisés
pour marginaliser les Canadiens et exclure leur réflexion sur la
façon de résoudre les problèmes.
Sur
la
question
des
soins
de
santé,
les
Canadiens
se
sont
déclarés
depuis
longtemps
en
faveur
d'un
système
public,
intégral
et
universellement
accessible
comme
étant
une
composante
essentielle d'un Canada moderne. Cette
conception de la santé et de l'éducation comme un droit
est attaquée et s'accompagne de l'érosion constante des
soins de santé publics et de l'éducation publique par la
privatisation, les compressions dans les services et d'autres
méthodes de « prestation de services » par les
partenariats public-privé qui transforment de plus en plus les
soins de santé et d'éducation en un moyen
d'enrichissement au service d'une poignée de
privilégiés.
Note
1. Qu'est-ce
que Canada 2020 ?
Canada 2020 est parrainé par toute une
gamme d'entreprises qui vont des banques aux monopoles de
l'énergie et pharmaceutiques. En 2006, le Bluesky Strategy
Group, qui se décrit comme la « firme d'affaires publiques
d'avant-garde du Canada », a créé un «
groupe de réflexion progressiste » appelé
Canada 2020. Le Groupe Bluesky Strategy se décrit comme une
« firme-conseil et de gestion dans le domaine des affaires
publiques, des communications stratégiques, des relations
gouvernementales et des relations avec les médias »
qui travaille pour les gouvernements et les industries, dont les
entrepreneurs militaires, les entreprises
du secteur agro-alimentaire, de l'éducation et de la
santé, et aide ses clients à obtenir ce qu'ils veulent du
gouvernement.
On lit ce qui suit par exemple sur le site web de
Bluesky sous la catégorie « Clients, soins de santé
et pharma » : « L'expansion de l'industrie des
soins de santé fournit l'occasion à nos clients
d'utiliser leurs techniques uniques et variées pour entrer en
relation avec les intervenants. L'équipe créative et
expérimentée de Bluesky
Strategy aide nos clients du domaine de la santé à
concevoir et lancer des stratégies nationales, à
développer et mener des campagnes médiatiques pour faire
connaître les questions d'intérêt pour les
consommateurs, à naviguer à travers le processus
parlementaire et elle aide les entreprises et les secteurs à
développer des relations avec les décideurs
clés. Nous conseillons et aidons nos clients à
éduquer et à informer ceux qui élaborent les
politiques de même que les représentants élus en
développant des arguments clairs autour de questions
complexes. » (blueskystrategygroup.com)
Les cofondateurs de Canada 2020 comprennent Tim
Barber et Susan Smith du groupe Bluesky ainsi que Thomas Pitfield qui
est aussi le président de Canada 2020.
-Thomas Pitfield a été consultant
auprès du Conseil commercial Canada-Chine et de IBM. Il a
été stratège numérique en chef de la
campagne d'élection fédérale du Premier ministre
Justin Trudeau, de même que de sa campagne à la chefferie
du Parti libéral du Canada. Il est un ami de longue date de
Justin Trudeau et le mari d'Anne Gainey,
la présidente du Parti libéral et le fils de Michael
Pitfield qui a été greffier du Conseil privé dans
le gouvernement de Pierre Trudeau.
- Susan Smith a été «
conseillère principale aux communications auprès de
plusieurs autres firmes nationales de relations publiques à
Ottawa et Calgary. Elle a été également
conseillère aux communications auprès du ministre
fédéral des Transports et du ministre du
Développement des ressources humaines ».
- Tim Barber « a travaillé au Bureau des
relations fédérales-provinciales, au Bureau du Conseil
privé, au Bureau du vice-premier ministre et du ministre du
Commerce international... Son travail dans les domaines de
l'approvisionnement dans les domaines de l'aérospatiale et de la
défense, de l'énergie, de la santé et du transport
assure le lien
entre nos clients et les processus de réflexion et de
décision au gouvernement. Quel que soit le dossier, Tim est le
stratège doté de la vision de prévoir, appliquer
et lier les pensées, les idées et les partenariats qui
livrent des résultats aux clients de Bluesky... Il a
travaillé de nombreuses années dans le service public,
occupant des positions au Bureau
du Conseil privé et des Relations
fédérales-provinciales, à Emploi et Immigration,
au Sénat canadien, au Groupe de travail sur le commerce
électronique d'Industrie Canada et aux bureaux du ministre du
Commerce international et du vice-premier ministre.
Qu'est-ce que le Sommet de
la santé Canada 2020 ?
Le Sommet de la santé Canada 2020 : Un
nouvel Accord sur la santé pour tous les Canadiens, était
la deuxième conférence du groupe Canada 2020 sur le
sujet. La première a eu lieu en décembre 2015 sous
le thème : « Sommet des soins de santé
Canada 2020 : Créer un système de soins de
santé
canadien durable ». Parmi les commanditaires de
l'événement de 2016 il y a l'Association canadienne
des producteurs de pétrole, Enbridge, les banques TD et CIBC,
les monopoles du Web Google et Facebook, plusieurs entreprises
pharmaceutiques comme la Pharmaceutical Research and Manufacturers of
America, le plus important
groupe de lobby pharmaceutique aux États-Unis.
L'événement était coparrainé par
l'Association médicale canadienne.

Plébiscite du 2 octobre en Colombie
Sur la signification du vote
- Margaret Villamizar -

Marches pour la paix le 5 octobre 2016
La défaite, le 2 octobre, du
plébiscite sur l'accord de paix a donné lieu à
toutes sortes de spéculations et d'assertions à l'effet
que le peuple colombien aurait opté pour la guerre ou encore
qu'il serait incapable, aux prises avec de grandes questions, de se
prendre en main. Ces conclusions ne sont pas fondées et
ne peuvent servir qu'à freiner la discussion et la
réflexion sur la signification de ces développements.
Dès le départ, les cercles dirigeants ont
fait tout en leur possible pour que le plébiscite soit
centré sur les Forces armées révolutionnaires de
Colombie-Armée populaire (FARC-EP) et non sur la
nécessité de
solutions sociales et politiques plutôt que militaires pour
mettre fin à la guerre. La campagne du Non, dirigée par
l'ex-président devenu sénateur, Alvaro Uribe Velez, a
assailli le peuple d'allégations à
l'effet que les FARC-EP s'en tiraient à bon compte, que leur
démobilisation était plutôt bien compensée,
qu'on leur remettait les rênes du pouvoir politique, etc. Cette
désinformation assourdissante visait à forcer le peuple
à voter en vertu de l'opinion qu'il se fait des FARC-EP et non
en
vertu d'une réflexion sur la véritable signification du
plébiscite en
soi et de ses perspectives de paix.
La campagne du Oui s'est aussi faite sur la question
de la pacification des FARC-EP. À vrai dire, par les deux
campagnes, le Oui dirigé par le gouvernement et le Non, les
cercles dirigeants colombiens et les impérialistes
qui les appuient étaient unis sur la question de rendre
responsables de la guerre ses victimes, en particulier ceux qui ont
refusé leur sort et ont résisté aux attaques. Les
dirigeants des deux campagnes ont tenté d'imposer leurs
idées préconçues et leurs propres
intérêts au peuple afin d'imposer au plébiscite un
cadre des plus restreints. Aussi a-t-on fait
obstruction à la pleine expression de la position
indépendante de la classe ouvrière colombienne, de la
paysannerie et du peuple qui réclamaient la paix, la
réconciliation nationale, leurs droits et que cesse le
terrorisme d'État.
Il est important de noter que les FARC-EP
elles-mêmes ne pouvaient pas mener campagne dans les
différentes régions de la Colombie mais devaient agir
uniquement par le biais des médias en ligne. Sans oublier que la
faible participation électorale ainsi que l'important vote pour
le Non, en particulier à Medellin et Antioquia, la base d'Uribe,
ont
joué un rôle important dans la défaite du Oui.
La campagne du Non

Marche pour la paix à Medellin le 7 octobre 2016
Le camp du Non dirigé par Uribe et son Parti du
centre démocratique a mené une campagne de mensonges et
de désinformation pour dépeindre la loi d'amnistie comme
une mesure permettant aux guérilléros de s'en sortir
à bon
compte, et a appelé le peuple à voter contre l'«
impunité ». Uribe, qui prône depuis longtemps
l'anéantissement militaire du FARC-EP plutôt qu'une
solution politique à la guerre, est lui-même
accusé d'avoir créé des escouades de la mort
paramilitaires alors qu'il était gouverneur d'Antioquia
de 1995 à 1997. En fait, il est de ceux qui pourraient
être appelés à comparaître devant un tribunal
spécial pour la paix et être
condamné à la prison en vertu du système de
justice transitoire intégré aux accords de paix et qui a
l'autorité de mener enquête sur les dirigeants
étatiques et militaires ainsi que sur les dirigeants
d'entreprise et autres civils soupçonnés d'avoir
participé ou ayant participé à des crimes de
guerre et à des crimes contre l'humanité. Le frère
d'Uribe est
déjà derrière les barreaux et est accusé
d'avoir organisé sa propre escouade de la mort, et Uribe craint
sans doute qu'il sera le prochain. Cette raison suffirait à
expliquer les efforts qu'il a déployés pour
empêcher le peuple de décider dans un climat de calme et
rationnel.
Faisant preuve de mauvaise conscience, Uribe
prétend
maintenant être en
faveur de la paix, mais en vertu de conditions différentes de
celles négociées par l'équipe de Santos. Uribe
prétend vouloir une « paix avec justice ».
Cela ne manque pas d'ironie qu'un ancien président accusé
d'avoir eu des liens directs avec des escouades de la mort
paramilitaires, sans parler des hauts responsables de l'État qui
ont commis des atrocités sous sa présidence, puisse
maintenant prétendre être le champion de la justice et
l'ennemi de l'impunité. Au cours de la présidence
d'Uribe, les jeunes
des milieux pauvres étaient systématiquement
assassinés par les membres de l'armée
déguisés en « guérilléros », y
compris
des officiers hauts placés, afin
d'obtenir des récompenses financières et autres en vertu
de la soi-disant politique de Sécurité
démocratique d'Uribe.
Afin de tenter d'empêcher l'adoption de l'Accord
de paix, Uribe a immédiatement pris la tête de la campagne
du Non et l'a manipulée dans le but de semer le doute chez les
Colombiens au sujet de l'Accord de paix en prétendant que
celui-ci était le produit d'un ordre du jour caché conclu
entre le gouvernement et les FARC-EP. Pour ce faire, il a
mobilisé les secteurs religieux conservateurs pour qu'ils votent
Non en raison du volet égalité entre les sexes contenu
dans l'accord. Uribe a présenté ce volet comme
étant une tentative de détruire la famille
traditionnelle, les rapports entre hommes et femmes et les
identités. Dans des
départements près des frontières
vénézuéliennes, on disait aux gens
que les problèmes vécus au Venezuela dus au «
castro-chavismo » s'infiltreraient en Colombie si l'accord
de paix était accepté. Ces efforts
désespérés d'Uribe et des intérêts
qu'il représente, tels les grands entrepreneurs, les
propriétaires fonciers et les sections de l'armée
alliées aux impérialistes étasuniens, visaient
à tuer l'Accord de paix et à
se protéger de ses conséquences. Ainsi Uribe s'est
présenté sous un nouveau jour, en tant que dirigeant
politique légitime, alors que la veille il était un capo
discrédité de la « para-politique » qui
a causé tant de dommage en Colombie.
Il faut aussi tenir compte du fait que pendant le
déroulement même du plébiscite les assassinats et
les menaces contre les activistes politiques et autres par les groupes
paramilitaires se sont poursuivis et se sont même
intensifiés dans certaines régions de la Colombie, sans
doute pour refroidir l'enthousiasme du peuple dans sa quête de
paix et de
réconciliation.
Le rôle des États-Unis
Au
moment-même
de
la
signature,
le
26
septembre,
de
l'Accord
de
paix,
le
département
d'État
des
États-Unis
a
annoncé
qu'il
ne
retirerait
pas
les
FARC-EP de sa liste
d'organisations terroristes, même si l'Union européenne,
de son côté, avait annoncé qu'elle les avait les
retirées de la sienne. C'est ainsi que les États-Unis ont
contribué, à la veille du plébiscite, à
faire en sorte que le vote porte sur les opinions des gens au sujet des
FARC-EP plutôt que sur l'accord lui-même, ce que celui-ci
proposait pour le pays et s'il allait en effet contribuer à la
paix dans la région.
Le
fait
de
maintenir
les
FARC-EP
sur
la
liste
d'organisations
terroristes
n'est
pas
sans
importance,
puisque
des
lois
«
antiterroristes
»
adoptées
au
lendemain
du 11 septembre autorisent la
violation totale des droits, y compris la capacité de voyager ou
de chercher refuge à l'étranger, non seulement les droits
de personnes accusées d'être membres d'un groupe
terroriste, mais de personnes jugées coupables par association.
Cela en soi explique les milliers de prisonniers politiques dans les
prisons colombiennes.
Les
États-Unis
avaient
d'abord
annoncé
leur
appui
à
la
paix
en
Colombie
sous
la
forme
de
Paz
Colombia
(Paix
Colombie),
une
nouvelle
version
du
détesté Plan Colombia initié
par Bill Clinton, qui a mené à une plus grande
militarisation du conflit colombien due à une stratégie
contre-insurrectionnelle sous couvert de « guerre à la
drogue ». Le nouveau plan des États-Unis, financé
à coups de centaines de millions de dollars au nom de la «
sécurité » et de « la lutte contre les
stupéfiants » ainsi que d'autres projets, a le même
objectif, soit de faciliter l'ingérence des États-Unis
dans les affaires internes de la Colombie dans la nouvelle situation.
Suite
à
l'échec
du
plébiscite,
le
secrétaire
d'État
adjoint
des
États-Unis,
John
Kirby,
a
émis
une
déclaration
sur
les
résultats
où
il
a
dit
que
les États-Unis « appuient la proposition du
président Santos en faveur d'un effort uni en soutien à
un vaste dialogue comme prochaine étape vers une paix juste et
durable ». La déclaration laisse clairement entendre que
les États-Unis veulent Alvaro Uribe comme acteur clé de
toutes futures négociations : « Le président
Santos, le dirigeant des FARC-EP, Rodrigo Londono, et le chef de
l'opposition, Alvaro Uribe, ont tous deux indiqué leur
engagement
envers la paix et leur désir de travailler ensemble, de
manière inclusive, pour y arriver ». Il ne fait aucun
doute que les États-Unis veulent voir Uribe et les
intérêts qu'il représente à la table avec
Santos pour veiller à ce que les résultats, quels qu'ils
soient, soient favorables aux plans des États-Unis pour l'avenir
de la Colombie.
Le
rôle
de la campagne du gouvernement pour le Oui
Le
gouvernement
Santos a affirmé son rôle dirigeant dans la
campagne du Oui bien avant que le plébiscite ne soit
formellement annoncé, et il a nommé l'ancien
président et ancien secrétaire général de
l'Organisation des États américains dominée par
les États-Unis, Cesar Gaviria, à la tête de
l'équipe de campagne. Cette section des cercles dirigeants est
l'alliée d'Obama, Trudeau et d'autres et représente la
« troisième voie » en Colombie. Pour elle, un
prérequis pour la paix était le désarmement et la
démobilisation des guérillas, sans quoi, en vertu d'une
logique intéressée, il ne pourrait y avoir la
stabilité nécessaire à l'accroissement
d'investissements étrangers – un appel au contrôle accru
des ressources et des terres du pays, lui-même un facteur qui,
dès le début, a grandement contribué à la
guerre.
Lorsqu'il
était
président,
Gaviria
a
commandé
des
frappes
sur
les
quartiers
généraux
des
FARC-EP,
un
coup
dur
aux
pourparlers
de
paix
qui
devaient
débuter
sous peu. Pour ce qui
est de Santos, celui-ci était ministre de la Défense du
gouvernement d'Uribe et il a, lui aussi, commandé le
bombardement de campements du FARC-EP dans le but de tuer les membres
de
son secrétariat. C'est dans ce contexte qu'un incident
tristement célèbre s'est produit lorsque le bombardement
du campement, avec l'aide des États-Unis, à
proximité de la frontière colombienne en Équateur,
a tué non seulement un dirigeant et un certain nombre de membres
des FARC-EP mais aussi de jeunes civils qui visitaient le camp à
ce
moment précis.
Plusieurs
autres
qui
se
sont
inscrits
en
faveur
de
la
campagne
du
Oui
n'ont
pas
eu
les
mêmes
ressources
ou
la
même
couverture
médiatique
que le groupe de Santos qui a eu l'appui
médiatique du groupe El Tiempo – une entreprise de la famille
Santos –ainsi que d'autres grands réseaux médiatiques.
Reste à déterminer jusqu'à quel point la classe
ouvrière, les syndicats et d'autres représentants des
forces favorables à la paix ont réussi à prendre
l'initiative.
On
peut
tout
de
même
en
déduire
que
la
campagne
du
Oui
du
gouvernement
a
agi
de
mauvaise
foi
et
a
tout
fait
pour que peuple ne se
place pas à la tête de la campagne du Oui.
Le
vote
favorable
Il
faut
tout de même noter qu'en dépit de toutes ces
activités, six millions de Colombiens ont tout de même
voté en faveur de l'accord et pour l'intégration des
FARC-EP
à la vie civile, illustrant clairement le désir d'une
résolution politique du conflit. Il s'agit aussi d'un
démenti des prétentions du gouvernement des
États-Unis, du Canada et d'autres à l'effet que la
résistance du peuple à la violence militaire et
paramilitaire est du terrorisme, et que le terrorisme d'État –
que ce soit en Colombie ou contre d'autres pays – serait «
favorable à la paix ». De telles déformations de la
vérité ne font que contribuer davantage à la
violence et visent à justifier la violation des droits d'une
grande partie de la population en l'accusant de terrorisme ou
d'être sympathique aux terroristes.
 Tout
indique
que
les Colombiens se mobilisent pour empêcher les forces
pro-guerre de détruire cette possibilité de mettre fin
à plus de soixante ans de violence en Colombie et de replonger
le pays dans un état de guerre. Le 5 octobre, des dizaines de
milliers de personnes – en particulier des étudiants – sont
descendus dans la rue pour une Marche pour la Paix. Des actions
semblables ont eu lieu dans d'autres villes du pays ainsi que dans
d'autres pays, tel qu'à New York. À la défense de
l'Accord de paix de la Havane, Marcha Patriotica lance l'appel à
une Journée nationale de mobilisation pour la paix le 14 octobre. Tout
indique
que
les Colombiens se mobilisent pour empêcher les forces
pro-guerre de détruire cette possibilité de mettre fin
à plus de soixante ans de violence en Colombie et de replonger
le pays dans un état de guerre. Le 5 octobre, des dizaines de
milliers de personnes – en particulier des étudiants – sont
descendus dans la rue pour une Marche pour la Paix. Des actions
semblables ont eu lieu dans d'autres villes du pays ainsi que dans
d'autres pays, tel qu'à New York. À la défense de
l'Accord de paix de la Havane, Marcha Patriotica lance l'appel à
une Journée nationale de mobilisation pour la paix le 14 octobre.
Les
Canadiens
peuvent
aussi
contribuer
au
processus
de
paix
en
Colombie
en
exigeant
que
le
Canada
retire
les
FARC-EP
de
sa
liste
d'organisations
terroristes,
puisque celle-ci ne fait que contribuer à
légitimer la violence militaire et paramilitaire ainsi que
l'ingérence militaire des États-Unis dans les affaires
internes de la Colombie, facteurs qui n'ont fait que contribuer
à prolonger la guerre et ses conséquences
désastreuses.
Les
appels
à une Assemblée constituante se multiplient
Un
des
résultats du plébiscite et de l'impasse qu'il a
créée est la demande croissante d'une Assemblée
constituante qui permettrait au peuple lui-même de décider
de la marche à suivre et de déterminer les changements
qui doivent être faits à la constitution du pays.
Jusqu'à
la
toute
fin
des
négociations
à
La
Havane,
les
FARC-EP
ont
demandé
qu'une
assemblée
constituante
soit
établie
une
fois
un
accord
final
de
paix conclu pour que le peuple colombien
dispose d'un processus sérieux qui permette aux gens de tous les
secteurs de la société de prendre part à
l'établissement de l'ordre du jour et à l'inclusion des
termes de l'accord dans la loi fondamentale du pays.
 Les FARC-EP
étaient
d'avis que cela empêcherait que la situation
ne tourne à une lutte entre les factions de l'élite au
pouvoir comme cela se passe dans une campagne électorale, ce qui
ne ferait que détourner l'attention des enjeux pour l'avenir du
pays. Le gouvernement n'a jamais accepté cette option parce
qu'il était partisan d'un vote qui se tiendrait une fois
l'accord signé et ne ferait qu'entériner l'accord. Le
gouvernement s'en tenait à cette position même si le
président possédait les pleins pouvoirs de mettre en
oeuvre l'accord de paix sans avoir à obtenir l'approbation du
Congrès ou du peuple colombien par un vote. À la fin, les
FARC-EP ont accepté de se conformer au verdict que donnerait le
Tribunal constitutionnel, conscientes que selon la constitution
colombienne la paix est « un droit et un devoir obligatoire
» et non quelque chose qui peut être mis en péril
juridiquement par un vote négatif dans un plébiscite.
Bien que la tenue d'un vote ait été
considérée comme une façon de conférer une
légitimité politique à ce qui avait
été conclu (ou rejeté), le Tribunal
constitutionnel a déclaré qu'il n'y aurait une loi
d'amnistie que dans le cas d'un vote en faveur du Oui au
plébiscite. Les FARC-EP
étaient
d'avis que cela empêcherait que la situation
ne tourne à une lutte entre les factions de l'élite au
pouvoir comme cela se passe dans une campagne électorale, ce qui
ne ferait que détourner l'attention des enjeux pour l'avenir du
pays. Le gouvernement n'a jamais accepté cette option parce
qu'il était partisan d'un vote qui se tiendrait une fois
l'accord signé et ne ferait qu'entériner l'accord. Le
gouvernement s'en tenait à cette position même si le
président possédait les pleins pouvoirs de mettre en
oeuvre l'accord de paix sans avoir à obtenir l'approbation du
Congrès ou du peuple colombien par un vote. À la fin, les
FARC-EP ont accepté de se conformer au verdict que donnerait le
Tribunal constitutionnel, conscientes que selon la constitution
colombienne la paix est « un droit et un devoir obligatoire
» et non quelque chose qui peut être mis en péril
juridiquement par un vote négatif dans un plébiscite.
Bien que la tenue d'un vote ait été
considérée comme une façon de conférer une
légitimité politique à ce qui avait
été conclu (ou rejeté), le Tribunal
constitutionnel a déclaré qu'il n'y aurait une loi
d'amnistie que dans le cas d'un vote en faveur du Oui au
plébiscite.
La
plus
grande
partie
des
forces
progressistes
du
pays
se
sont
jointes
aux
FARC-EP
pour
appeler
à
une
assemblée
constituante
et
continuent
de
le
faire afin de consolider les gains accomplis par le
processus de paix, ce qui demeure la question à l'ordre du jour.
La
responsabilité
de
s'assurer
que
la
guerre
a
pris
fin
et
d'ouvrir
la
voie
à
une
paix
stable
et
durable
repose
plus
que
jamais sur
les épaules du peuple colombien et des autres peuples
épris de paix et de leurs mouvements antiguerre
organisés. Toute illusion à l'effet qu'on mettra fin
à l'impasse et qu'on bâtira la paix en s'appuyant sur
l'élite dominante du pays ou des États-Unis sous
Obama
ou
Clinton
doit être rejetée. Les Canadiens doivent
se tenir aux côtés du peuple colombien et demander qu'on
mette fin au recours à la force pour régler les conflits
politiques et sociaux et à la préparation de la guerre au
nom de la « paix » et de la « justice ».
Les résultats

Marches pour la paix dans les rues de la Colombie le 5 octobre 2016
Le « Non » l'a emporté au
référendum du 2 octobre dans lequel les Colombiens
étaient appelés à approuver l'Accord de paix
conclu entre le gouvernement de la Colombie et les Forces armées
révolutionnaires de Colombie-Armée populaire (FARC-EP).
L'accord a
été rejeté à 50,21 %
contre 49,78 %, une marge d'à peine 54 000
voix.
Le compte final
Non : 6 431 376
Oui : 6 377 482
Bulletins annulés : 170 946
Bulletins non marqués : 86 243
Le résultat aura pris beaucoup de gens par
surprise puisque les sondages dans les médias prédisaient
depuis longtemps une victoire facile du Oui.
La participation
Les bureaux de vote se sont ouverts à 8
heures et ont fermé leurs portes à 16 heures, ce qui
est la pratique normative pour les élections en Colombie.
Seulement 37 % des électeurs inscrits se sont
prévalus de leur droit de vote, ce qui représente un taux
d'abstention de 63 %, un taux plus élevé que
celui atteint dans toute élection générale
en 22 ans. Par contre, le seuil
établi par la Cour constitutionnel pour l'acceptation du
résultat d'un référendum, soit de 4,5
millions de voix pour le Oui, a facilement été atteint.
Seulement 18,4 % des électeurs
inscrits ont voté Non, ce qui représente un très
faible pourcentage des électeurs ayant droit de vote. Beaucoup
d'entre ces derniers n'étaient pas inscrits. La situation est
empirée par le fait que le Registre civil national n'a pas fait
de campagne pour inscrire les électeurs non inscrits, ni
corrigé les
renseignements des citoyens qui ont déménagé
depuis la dernière élection. Par exemple, ceux qui
étaient en âge de voter pour la première fois et
ceux qui étaient à l'extérieur du pays et qui ne
s'étaient pas déjà inscrits à un consulat
colombien dans une élection antérieure ont
été exclus.
Le taux de participation était
particulièrement faible sur la côte atlantique, notamment
dans les départements de La Guajira, Atlantico et Bolivar,
où le Oui a inscrit des majorités importantes. Ces
régions ont été frappées par l'ouragan
Matthew le jour du scrutin. La Mission d'observation électorale
colombienne rapporte que jusqu'à quatre
millions de personnes pourraient avoir été privées
de la possibilité de voter à cause des conditions
météorologiques dans ces régions. Dans la ville de
Santa Marta et dans six autres municipalités, le Conseil de
gestion de risques a déclaré un état de
catastrophe naturel touchant des dizaines de milliers de
résidents.
La mission d'observation a noté que
seulement 61 % des bureaux de vote avaient le personnel
requis pour accepter les votes lorsque les bureaux ont ouvert leurs
portes.
Les tendances
régionales

Grandes manifestations pour la paix à Medellin le 7 octobre 2016
Les régions qui ont été le plus
touchées par le conflit armé ont voté en faveur de
l'accord de paix de façon décisive. La majorité
des électeurs de la capitale, Bogota, et de deux autres grandes
villes, Cali et Barranquilla, ont voté oui.
Dans la deuxième plus grande ville du pays,
Medellin, comme dans plusieurs autres capitales de département,
la majorité a voté Non. Le département d'Antioquia
et sa capitale, Medellin, sont la base de l'ex-président
proguerre Alvaro Uribe Velez, dont le parti Centre démocrate
était le meneur de la campagne pour le Non à
l'échelle nationale.
On rapporte également que l'ancien bras droit du caïd de la
drogue Pablo Escobar a mené la campagne pour le Non à
Medellin. Le bourreau d'Escobar a avoué avoir commis des
centaines
d'assassinats et d'en avoir ordonné des milliers d'autres pour
le Cartel de Medellin. Il a aussi admis avoir participé
à l'assassinat systématique des membres du parti de
l'Union patriotique, crimes pour lesquels il a purgé
une peine de prison de 22 ans.
Le vote à
l'étranger
Sur les 82 721 Colombiens qui ont voté
à l'étranger, soit un peu moins de 14 %
des 600 000 électeurs inscrits à
l'étranger, 54,0 % ont voté pour le Oui
contre 45,97 % pour le Non. Le Non l'a emporté
seulement parmi les Colombiens vivant aux États-Unis, au
Paraguay et dans
les Émirats arabes unis. Le cinquième plus grand groupe
d'électeurs vivant à l'étranger se trouve au
Canada, après les États-Unis, le Venezuela, l'Espagne et
l'Équateur.
Les conséquences
Le cessez-le-feu bilatéral est maintenu, tel que
l'ont confirmé le gouvernement et les FARC-EP. Par contre,
le 5 octobre le président Santos a annoncé que le
gouvernement ne respectera le cessez-le-feu que jusqu'au 31
octobre. C'est le cessez-le-feu bilatéral qui avait
créé les conditions de la paix en Colombie sur la base du
dialogue et de l'adoption de solutions sociales et politiques aux
problèmes à l'origine du conflit.
La pire conséquence, par contre, est que la
victoire du Non empêche le président Santos de faire
adopter rapidement la
Loi de l'amnistie contenue dans l'accord de paix par le Congrès
colombien. La Cour constitutionnelle du pays, qui a autorisé le
plébiscite du 2 octobre, a établi que la loi de
l'amnistie serait soumise au Congrès seulement si le Oui
l'emportait.
Les FARC-EP ont dit à différentes
occasions que leur déplacement vers les zones de «
normalisation » temporaires et le désarmement
dépendaient du passage de la loi de l'amnistie. La
défaite du référendum laisse le pays à la
croisée des chemins.
Le président de la
Colombie reçoit le
Prix Nobel de la paix
Le 7 octobre, le président de la Colombie Juan
Manuel Santos a reçu le Prix Nobel de la paix. La
présidente du Comité Nobel norvégien, Kaci
Kullmann Five, a expliqué de la façon suivante les
raisons du choix du président Santos pour le prix cette
année:
« Le président Santos a lancé les
négociations qui ont mené à l'accord de paix
conclu entre le gouvernement colombien et les guérilléros
des FARC-EP et il a cherché constamment à faire
progresser le processus de paix, sachant très bien que l'accord
est controversé. Il a joué un rôle clé pour
faire en sorte que les électeurs colombiens expriment leur
opinion sur l'accord par voie de référendum. Le
résultat du vote n'est pas ce que le président Santos
espérait. Par une faible majorité, les quelque 13
millions de Colombiens qui sont allés voter ont dit non à
cet accord.
« Ce résultat a créé une grande incertitude
en ce qui concerne l'avenir de la Colombie. Il existe un réel
danger que le processus de paix s'arrête et que la guerre civile
reprenne. Il est donc d'autant plus important que les parties,
dirigées par le président Santos et le chef de la
guérilla Rodrigo Londoño, continuent de respecter le
cessez-le-feu. »
Elle a ajouté: « Le prix est aussi un hommage au peuple
colombien qui, malgré les grandes difficultés et les
abus, n'a pas abandonné son espoir d'une paix juste, de
même qu'un hommage à toutes les parties qui ont
contribué à ce processus de paix. Une grande partie de
cet hommage revient aux représentants des victimes innombrables
de la guerre civile. »
Kullman n'a pas répondu aux questions des médias
présents sur le fait que le dirigeant des FARC-EP, Rodrigo
Londoño, aussi appelé Timochenko, n'ait pas lui aussi
reçu le prix. Timochenko a répondu à l'annonce de
la remise du prix en écrivant sur Twitter que « le seul
prix que nous recherchons c'est la paix fondée sur la justice
sociale pour la Colombie, sans paramilitarisme, et sans
représailles ou mensonges ».

La manipulation des électeurs est exposée
Depuis la défaite du plébiscite, on
apprend peu à peu l'ampleur des
mesures orchestrées pour manipuler le vote par le biais d'un
ciblage
sophistiqué de différentes sections du peuple colombien
et pour
détruire l'opinion publique en faveur d'une résolution
pacifique du
conflit.
Juan Carlos Vélez, ancien candidat à la
mairie de Medellin et
gérant et homme de main de la campagne du Non menée par
le Parti du
centre démocratique de l'ancien président colombien
Alvaro Uribe, a
expliqué comment la campagne du Non avait permis de
découvrir « la
puissance virale des réseaux sociaux ». À
titre d'exemple, il a
expliqué que pendant un arrêt de campagne à
Apartado, à Antioqua, un
conseiller municipal lui a remis une photo du président Santos
accompagné de Timochenko, le dirigeant des FARC, avec le
message : «
Pourquoi donner de l'argent aux guérillas alors que le pays est
dans le
trou ? J'en ai fait un statut sur ma page Facebook et
samedi dernier [1er octobre] il a eu 130 000 partages et a
ainsi
été vu par six
millions de personnes », a-t-il dit.
 Il a aussi
révélé que des «
stratèges » du Panama et du Brésil ont
suggéré une stratégie pour la campagne du Non qui
consistait à ne pas expliquer les accords et à concentrer
sur les messages qui soulèvent
l'indignation des gens
— une indication claire à l'effet que le but visé
était de faire sortir
le vote par le biais de l'incitation plutôt que de
l'information. Il a aussi
révélé que des «
stratèges » du Panama et du Brésil ont
suggéré une stratégie pour la campagne du Non qui
consistait à ne pas expliquer les accords et à concentrer
sur les messages qui soulèvent
l'indignation des gens
— une indication claire à l'effet que le but visé
était de faire sortir
le vote par le biais de l'incitation plutôt que de
l'information.
Il a aussi expliqué comment la segmentation et
le micro-ciblage de
la population ont été utilisés. Pour les
publicités radiodiffusées à
l'intention des « couches moyennes et supérieures de la
société, nous
avons mis l'accent sur Non à l'impunité et à
l'éligibilité (pour ce qui
est des amnisties et des tribunaux alternatifs en vertu du
système de
justice alternatif) et aux réformes fiscales. Pour ce qui est
des
réseaux radiophoniques « à l'intention des couches
inférieures, nous
avons mis l'accent sur les subventions » (pour aider les
guérillas à
réintégrer la vie civile). Nous avons mis l'accent sur ce
qui convenait
le mieux à chaque segment de la population dans chaque
région. Sur la
côte, nous avons passé le message fait sur mesure que si
le référendum
passait nous deviendrions comme le Venezuela. (Ici Velez utilise le
terme « la Costa » qui veut dire « la
côte », mais il s'agit plus
probablement des régions frontalières entre la Colombie
et le Venezuela
— note de la rédaction).
Velez a révélé que le camp du Non
avait reçu des subventions de «
principalement 30 compagnies et 30 individus », et
parmi les cinq
principales compagnies se trouvent l'Organisation Ardila Lulla,
Bolivar, Grupo Uribe, Codiscos et Corbeta.[1]
Il n'est pas clair si les 30
individus ont aussi des participations majoritaires dans ces 30
compagnies et si au moyen de leur fortune individuelle et de leur
contrôle sur diverses sections de l'économie ils ont, eux
aussi,
influencé le résultat du vote.
Lorsqu'on a demandé à Velez pourquoi la
campagne du Non avait ainsi
déformé la vérité, il a simplement
répondu que la campagne du Oui avait
fait de même.
Ces révélations n'ont pas sitôt
été faites que le parti du Centre
démocratique a émis un communiqué dans lequel il
réfute les
déclarations de son propre gérant de campagne, en
particulier les
propos au sujet de l'ingérence de stratèges
étrangers. Ils ont
simplement affirmé que pour leur campagne ils n'avaient pas
« embauché
des stratèges
étrangers », propos nébuleux qui ne cherchent
qu'à dissimuler le rôle
joué par divers experts dans l'« art obscur »
de la manipulation
électorale pour atteindre un résultat précis, la
victoire du Non.[2]
C'est ainsi que le parti du Centre démocratique
explique sa
campagne sale : « Les porte-parole de partis, les membres du
congrès et
les entreprises ont développé une stratégie de
communication directe
avec les Colombiens. Ainsi, ils ont expliqué de façon
raisonnable les
conséquences de l'accord de La Havane », peut-on lire
dans
le communiqué.
Et plus loin : « Le camp du Non n'a pas eu
recours aux mensonges et
aux messages déformés. » Le parti aurait mis
de l'avant des arguments
qui permettraient aux gens de « voter selon leur conscience
devant
l'immense tort qui attendait le pays advenant une acceptation des
accords et le fait que ceux-ci auraient fait partie
intégrante de la constitution ».
Aussi, Edgar Castano, le président de la
Confédération évangéliste
de la Colombie, a déclaré qu'au nombre de ses
congrégations qui
représentent 10 millions de membres, il est possible
que 4 millions
aient voté et il est presque certain que la moitié de ces
votes ont été
pour le Non. Selon Castano, ces membres croient, tout comme
lui, que l'accord tel qu'il est formulé menace leur conception
de la
famille. Il va à l'encontre de certains principes
défendus par les
évangélistes, a-t-il dit. Il a donné l'exemple de
l'égalité accordée
aux groupes LGTBI et aux femmes. Au lendemain du plébiscite,
Castano a
été parmi les quatorze représentants
d'églises chrétiennes à être
accueillis
le 6 octobre lors d'une réunion organisée par le
président colombien
Juan Manuel Santos. Les seuls autres groupes à se réunir
ainsi avec lui
suite au plébiscite sont les représentants de compagnies.
Note
1. De tels experts ont aussi été
invités au
Canada par les partis politiques pour développer les
stratégies les
plus efficaces qui permettraient de remporter la victoire aux
dernières
élections fédérales. Ces stratégies
consistent à tout mettre en oeuvre
pour diviser le vote au moyen de techniques sophistiquées et
de puissantes bases de données sur l'électorat que les
partis se sont
constituées à partir de la liste d'électeurs
d'Élections Canada. Les
conservateurs avaient embauché le stratège politique
australien, Lynton
Crosby, lors des élections fédérales de 2015
dans l'intention de
manipuler le vote, tandis que les libéraux semblent avoir
trouvé leurs
propres experts.
2. L'Organisation Ardila Lulle est dirigée
par Carlos Arturo Ardila Lulle qui dispose d'une valeur nette
estimée à
plus de 2 milliards $ÉU. Le conglomérat
contrôle entre autres les ondes
radiophoniques colombiennes ainsi que le monopole de la
télévision,
Radio Cadena National (RCN) TV.
Codiscos — une étiquette de disque de Medellin.
Le Groupe Uribe — Il existe un certain nombre de
groupes Uribe. Il
n'y a pas de lien connu entre ce groupe et l'ancien président
colombien
Alvaro Uribe.
Corbeta — une grande chaîne de distribution en
Colombie.
(La Republica, BBC Mundo)

Rencontre des
délégations du Gouvernement national et des FARC-EP

Nous,
les
délégations
du
Gouvernement
National
et
les
FARC-EP,
après
nous
être réunis à La Havane avec les
pays garants et avec le Chef de la Mission spéciale des Nations
Unies en Colombie, Jean Arnault, nous voulons informer l'opinion
publique que :
1.
Après
presque
4
ans
d'intenses
conversations,
nous
avons
conclu
le
24 août dernier l'Accord Définitif pour la Fin du
conflit Armé et pour la Construction d'une Paix Stable et
Durable par lequel nous sommes engagés. Nous considérons
qu'il contient les réformes et les mesures nécessaires
pour asseoir les bases de la paix et garantir la fin du conflit
armé.
Nous
reconnaissons,
cependant,
que
ceux
qui
ont
participé
au
Plébiscite
du
2 octobre dernier se sont prononcés
majoritairement en faveur du « non » même si
ça a été à une étroite
majorité. Dans la cadre des possibilités que la
Constitution Politique octroie au président, il est
approprié que nous continuions à écouter
rapidement et efficacement les différents secteurs de la
société pour comprendre leurs préoccupations et
définir rapidement une sortie par les voies indiquées
dans la sentence C-379 de 2016 de la Cour Constitutionnelle. Les
propositions d'ajustement et de précisions qui résultent
de ce processus seront discutées entre le Gouvernement National
et les FARC-EP pour donner des garanties à tous.
2.
Nous
réaffirmons
l'engagement
pris
par
le
Président
de
la
République
et le Commandant des FARC-EP de maintenir le
Cessez-le-feu et l’Arrêt des Hostilités Bilatéral
et Définitif décrété le 29 août
dernier et le contrôle et la vérification de la part du
mécanisme tripartite ainsi que les garanties de
sécurité et de protection des communautés sur
leurs territoires selon ce qui est défini dans le Protocole par
les parties.
Pour
rendre
ce
Cessez-le-feu
fiable,
nous
avons
mis
au
point
un protocole
destiné à prévenir tout incident dans les zones de
pré-regroupement dans les quadrants définis et à
assurer un climat de sécurité et de tranquillité
avec l'application totale de toutes les règles qui
régissent le Cessez-le-feu et l'Arrêt des
Hostilités Bilatéral et Définitif.
Le
Mécanisme
Tripartite
de
Contrôle
et
de
Vérification
avec
la
participation
du Gouvernement et des FARC-EP et la coordination
de la mission des Nations Unies sera chargé de contrôler
et de vérifier la mise en œuvre du protocole, en particulier la
respect des règles qui régissent le Cessez-le-feu.
3.
Avec
cette
proposition,
nous
demandons
au
Secrétaire
Général
des
Nations
Unies et, par son
intermédiaire au Conseil de Sécurité, qu'il
autorise la Mission des Nations Unies en Colombie à exercer les
fonctions de contrôle, de vérification, de
résolution des différends, de recommandations, de
rapports et de coordination du Mécanisme de Contrôle et de
Vérification prévues dans la Résolution 2261
(2016) en ce qui concerne ce Protocole.
De
même,
nous
invitons
les
pays
qui
contribuent
à
la
Mission
avec des observateurs non armés à continuer de
déployer leurs hommes et leurs femmes qui continueront à
avoir toutes les garanties de sécurité nécessaires.
4.
Parallèlement,
nous
continuerons
à
avancer
dans
la
mise
en
marche
de mesures humanitaires destinées à construire
la confiance comme la recherche de personnes considérées
comme disparues, les plans pilotes de déminage humanitaire, le
remplacement volontaire de cultures à usage illégal, les
engagements concernant la sortie des mineurs des campements et sur la
situation des personnes privées de liberté.
5.
Nous,
les
délégations,
remercions
le
Comité
International
de
la
Croix
Rouge pour son soutien permanent, le Chili et
le Venezuela pour leur accompagnement et surtout Cuba et la
Norvège pour leur travail intense et plein d'abnégation
concernant la construction des accords de paix pour la Colombie, pour
leur contribution constante à la recherche de solutions dans les
moments difficiles et leur disposition à continuer à
soutenir le processus de paix.
(La Havana, Cuba, 7 octobre 2016)

Qu'est-ce que le Canada manigance en Colombie?

Marches pour la paix, le 5 octobre 2016 (Z.
Camargo)
Le plan pour que le Canada et le Mexique opèrent
dans l'intérêt de l'impérialisme américain
en Colombie a été formulé par le
secrétaire d'État américain John Kerry lors du
Sommet des dirigeants nord-américains en juin dernier. Kerry a
déclaré publiquement que les trois chefs d'État
ont travaillé ensemble sur la façon dont ils
interviendraient en Colombie, au moment même où se
tenaient les négociations de paix. « [Nous] avons
discuté de notre appui au processus de paix colombien, de nos
efforts, tous ensemble, pour mettre fin à la longue guerre
civile dans la région », a-t-il dit.
Depuis, le gouvernement canadien a fait une
série d'annonces indiquant qu'il met en oeuvre toutes les
décisions adoptées lors du Sommet en ce qui a trait au
rôle qu'il pourrait jouer en Colombie dans le cadre de ce que les
États-Unis appellent le Plan de paix, qui est la suite de la
version militaire, le Plan Colombie, mise en oeuvre
depuis 2000.
Le bureau du ministre de la Défense Harjit
Sajjan a récemment confirmé que la Colombie est l'un des
pays où les libéraux envisagent de déployer des
soldats canadiens dans ce qu'il appelle les opérations de paix.
Le gouvernement canadien s'ingère dans les affaires internes
d'autres pays avec la plus grande arrogance, comme si c'était
son
droit et que la seule chose à décider est qui
bénéficiera de cette ingérence.
Lorsqu'on a interrogé l'ambassadeur de la
Colombie au Canada
Nicolas Lloreda à propos de la participation possible du Canada,
vraisemblablement dans une mission d'observation internationale pour
surveiller le cessez-le-feu et d'autres dispositions des accords de
paix à mesure qu'ils prennent effet, il a déclaré
que toute décision serait prise par l'ONU. «
Nous avons une excellente relation avec le Canada sous tous les
aspects, a-t-il dit. Mais nous avons décidé qu'à
ce moment-ci la meilleure chose à faire est de passer par
l'Organisation des Nations unies et qu'il revient à l'ONU de
décider qui a la capacité et quel pays apporte vraiment
quelque chose de positif à la table. »
Cela donne une idée de comment le Canada cherche
à s'imposer en Colombie par divers moyens formels et informels.
Que l'ambassadeur de Colombie ait indiqué publiquement que ce
serait l'ONU qui déciderait, pas son gouvernement, dans les
questions liées au maintien de la paix après le conflit,
révèle que le Canada incite probablement la
Colombie à agir en dehors du processus qui a été
créé pour superviser l'accord bilatéral entre le
gouvernement et les Forces armées révolutionnaires de
Colombie - Armée populaire (FARC-EP). Un problème est que
ce sont principalement des pays de la Communauté des
États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) qui
se sont vus confier ce
rôle. Le Canada ne dispose pas d'un représentation au sein
de la CELAC, ni de l'Union des nations sud-américaines (UNASUR),
qui ont tous deux été mises en place comme une
alternative à l'Organisation des États américains
(OÉA) dominée par les États-Unis et qui est
notoire pour son ingérence dans les affaires des pays de
l'Amérique latine et
des Caraïbes, et dont le Canada est membre.
 Entre-temps, le 20
septembre, le gouvernement a promis un montant supplémentaire
de 33,8 millions $ pour des « efforts de
déminage et de reconstruction », soit un jour
après que le ministre des Affaires étrangères,
Stéphane Dion, ait engagé 25 M $ à des
fins de projets de médiation de conflits, de
négociation et de reconstruction menés par l'ONU en
Colombie. Puis le 26 septembre, alors qu'il était à
Carthagène, en Colombie, pour assister à la signature de
l'accord de paix entre le gouvernement colombien et les FARC-EP, le
ministre Dion a annoncé un autre 21 millions $
répartis sur trois ans pour « consolider la
paix ». Il a dit que c'est pour appuyer l'allocation
de 57,4 millions $ à des « initiatives d'aide au
développement pour aider les populations touchées par le
conflit » faites en juillet par la ministre du
Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude
Bibeau. Entre-temps, le 20
septembre, le gouvernement a promis un montant supplémentaire
de 33,8 millions $ pour des « efforts de
déminage et de reconstruction », soit un jour
après que le ministre des Affaires étrangères,
Stéphane Dion, ait engagé 25 M $ à des
fins de projets de médiation de conflits, de
négociation et de reconstruction menés par l'ONU en
Colombie. Puis le 26 septembre, alors qu'il était à
Carthagène, en Colombie, pour assister à la signature de
l'accord de paix entre le gouvernement colombien et les FARC-EP, le
ministre Dion a annoncé un autre 21 millions $
répartis sur trois ans pour « consolider la
paix ». Il a dit que c'est pour appuyer l'allocation
de 57,4 millions $ à des « initiatives d'aide au
développement pour aider les populations touchées par le
conflit » faites en juillet par la ministre du
Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude
Bibeau.
Dion a tweeté que sa visite en Colombie a
également inclus une « conversation franche avec des
femmes colombiennes pour en apprendre davantage sur leur rôle
dans les négociations de paix et la consolidation de la
paix » et une visite à un centre où les
anciens « enfants soldats » reçoivent une
formation en vue de la réinsertion
dans la vie civile .
Prenant la parole à une réunion sur les
initiatives de déminage pour la Colombie organisée par
les États-Unis et la Norvège, en marge de la 71e
Assemblée générale de l'ONU, Dion a
énuméré un certain nombre de projets de
déminage auxquels le Canada participe. Il a dit que le Canada
serait « un partenaire actif au sein de l'Initiative
mondiale de déminage de la Colombie lancée l'an dernier
par la Norvège et les États-Unis, puisqu'il a
récemment consacré 12,5 millions $ »
à la détection et à la neutralisation des mines
terrestres dans 10 municipalités par l'intermédiaire
de HALO Trust.
Il a également dit que le Canada
contribuerait 1,3 million $ à l'OÉA «
pour le soutien logistique des opérations de
déminage » et que certains parties de sa contribution
de 20 millions $ au Fonds fiduciaire multipartenaires des
Nations unies pour le post-conflit en Colombie porteront sur le
déminage.
Pendant ce temps, le compte twitter de l'ambassade du
Canada en Colombie a récemment été inondé
de photos et tweets à propos de différents projets que le
Canada finance et d'une visite dans ce pays en septembre dernier par le
Comité permanent des affaires étrangères et du
développement international. Parmi les projets mentionnés
il y a
un certain nombre d'initiatives de « consolidation de la
paix » avec les enfants et les femmes, des projets de
recherche et un PSOP [Programme pour la stabilisation et les
opérations de paix] pour « aider à réformer
les forces policières en milieu rural et urbain en appui aux
accords de paix ».
Également, il y a la collaboration du Canada
avec une mission de l'OÉA en appui au processus de paix (MAPP)
récemment approuvée par le gouvernement colombien pour
« surveiller les défis, les risques et les menaces
à la paix en Colombie ». La mission est d'avoir une
présence active et permanente dans les territoires que les
FARC-EP
sont censées quitter et où l'ELN et d'autres
organisations armées ont une présence afin de «
surveiller les conditions de sécurité et les impacts sur
les communautés ». Elle devra également
« suivre l'évolution des conflits sociaux qui
représentent des défis à la consolidation de la
paix et continuera de s'engager dans les tâches liées aux
droits
des dirigeants sociaux, des défenseurs des droits de l'homme,
des paysans se rappropriant leurs terres et de ceux visés par
des dédommagements collectifs, dont les peuples indigènes
et afro-colombiens ».

Peut-on douter des vraies raisons de cette intrusion de
l'OÉA pour «superviser» ce qui se passe dans les
zones où les FARC-EP et d'autres groupes
d'insurgés ont opéré pendant des années ?
Peut-on douter du rôle attribué au
Canada par les États-Unis dans le cadre de son programme peu
crédible de « Paix en
Colombie », qui fait suite à 16 années
d'incitation à la guerre avec le Plan Colombie?
Toute contribution à la paix en Colombie, en
particulier dans les « zones et les populations les plus
touchées par le conflit », qui sont où le
Canada dit qu'il veut être engagé, va exiger une stricte
neutralité en faveur de la paix. Comment le Canada, qui a mis
l'une des parties engagées dans le conflit sur sa liste du
terrorisme et qui
travaille main dans la main avec les États-Unis, un protagoniste
direct dans la guerre dès le début, peut-il être
considéré crédible à cet
égard ? D'autant plus que le Canada a ses
intérêts économiques dans ce pays riche en
ressources, en particulier dans les mines et autres industries
extractives. Tout comme en Syrie, où la «
contribution » du
Canada à la réalisation d'un règlement politique
consiste à travailler avec les forces anti-gouvernementales
syriennes tout en faisant partie de la coalition des États-Unis
qui mènent une guerre pour un changement de régime dans
le pays, il serait naïf de s'attendre à ce que l'engagement
du Canada en Colombie soit un facteur véritable pour la paix,
le dialogue et les solutions politiques.
Alors, il faut poser la question : Qu'est-ce que
le Canada manigance en Colombie ?

Lisez Le
Marxiste-Léniniste
Site web: www.pccml.ca
Courriel: redaction@cpcml.ca
|



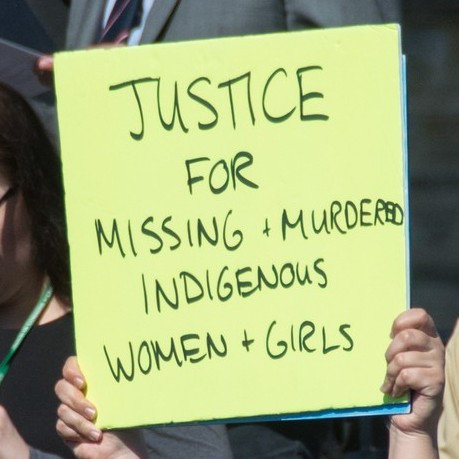 Le gouvernement Trudeau est
arrivé au pouvoir avec la promesse d'agir tout de suite pour
mettre en oeuvre l'ensemble des 94 recommandations de la
Commission de la vérité et réconciliation,
à commencer par l'adhésion à la Déclaration
de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, la promesse de «
renouveler les liens avec les
peuples autochtones et de bâtir une relation de nation à
nation sous le signe de la reconnaissance, des droits, du respect, de
la coopération et du partenariat » et celle
d'éliminer « d'entrée de jeu le plafond
de 2 % sur les programmes destinés aux
Premières Nations ». Près de deux ans
après l'élection, c'est le statu quo sur
tous ces fronts, voire il y a même de nouvelles atteintes aux
droits des autochtones sous l'enseigne du « renouvellement des
relations » avec le gouvernement fédéral.[
Le gouvernement Trudeau est
arrivé au pouvoir avec la promesse d'agir tout de suite pour
mettre en oeuvre l'ensemble des 94 recommandations de la
Commission de la vérité et réconciliation,
à commencer par l'adhésion à la Déclaration
de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, la promesse de «
renouveler les liens avec les
peuples autochtones et de bâtir une relation de nation à
nation sous le signe de la reconnaissance, des droits, du respect, de
la coopération et du partenariat » et celle
d'éliminer « d'entrée de jeu le plafond
de 2 % sur les programmes destinés aux
Premières Nations ». Près de deux ans
après l'élection, c'est le statu quo sur
tous ces fronts, voire il y a même de nouvelles atteintes aux
droits des autochtones sous l'enseigne du « renouvellement des
relations » avec le gouvernement fédéral.[ À Ottawa, les
événements ont commencé par une conférence
de presse des Familles des Soeurs par l'esprit, suivie d'une vigile sur
la colline du Parlement et d'un festin pour les familles des femmes
disparues ou assassinées. On a
également rendu un émouvant hommage à Annie
Pootoogook, une artiste
inuite connue décédée dans des circonstances
suspectes à Ottawa le 19 septembre. Les parents et amis
d'Annie ont dénoncé le racisme de l'enquête de la
police qui
prétend que sa mort n'a rien de suspect alors qu'un des
officiers a été pris à afficher des commentaires
racistes à son sujet sur Internet. Le premier ministre Trudeau
et trois
de ses ministres ont également pris la parole à la
vigile. Ils sont arrivés après
que les autres orateurs aient terminé et n'ont donc tenu compte
d'aucune des questions soulevées par les familles. Beaucoup de
participants ont noté que leurs discours en l'air confirment ce
que les familles craignaient: des discours pour cacher l'absence
d'action.
À Ottawa, les
événements ont commencé par une conférence
de presse des Familles des Soeurs par l'esprit, suivie d'une vigile sur
la colline du Parlement et d'un festin pour les familles des femmes
disparues ou assassinées. On a
également rendu un émouvant hommage à Annie
Pootoogook, une artiste
inuite connue décédée dans des circonstances
suspectes à Ottawa le 19 septembre. Les parents et amis
d'Annie ont dénoncé le racisme de l'enquête de la
police qui
prétend que sa mort n'a rien de suspect alors qu'un des
officiers a été pris à afficher des commentaires
racistes à son sujet sur Internet. Le premier ministre Trudeau
et trois
de ses ministres ont également pris la parole à la
vigile. Ils sont arrivés après
que les autres orateurs aient terminé et n'ont donc tenu compte
d'aucune des questions soulevées par les familles. Beaucoup de
participants ont noté que leurs discours en l'air confirment ce
que les familles craignaient: des discours pour cacher l'absence
d'action.
 À la
conférence de presse, Bridget Tolley de la première
nation algonquine Kitigan Zibi, dont la mère Gladys Tolley a
été tuée par un policier dans un délit de
fuite, a exprimé l'inquiétude partagée par
beaucoup de familles du fait que le rôle de la police soit exclu
des
termes de référence officiels de l'enquête. Elle a
rappelé que les policiers ont
blâmé sa mère en disant qu'elle était ivre
au moment de l'incident. Bridget a demandé la tenue d'une
enquête indépendante et a dit regretter que
l'enquête nationale ne se penchera pas sur les autres cas que les
familles porteront à son attention. « Ce n'est pas juste
que l'enquête transmette l'information que nous lui donnons
à ceux contre qui les
plaintes sont portées, la police, a-t-elle ajouté. Nous
avons demandé de l'aide quand les femmes ont été
portées disparues, nous avons demandé de l'aide pour les
familles, mais nos demandes sont restées sans réponse. Je
viens ici depuis 15 ans et rien n'a changé. En fait, je
crois que les choses ont empiré. Mais nous voulons la justice.
Nous
ne voulons plus être ici à chaque année. Nous ne
devrions pas être forcées de supplier pour obtenir
justice. Nos familles méritent justice, nos proches
méritent justice. »
À la
conférence de presse, Bridget Tolley de la première
nation algonquine Kitigan Zibi, dont la mère Gladys Tolley a
été tuée par un policier dans un délit de
fuite, a exprimé l'inquiétude partagée par
beaucoup de familles du fait que le rôle de la police soit exclu
des
termes de référence officiels de l'enquête. Elle a
rappelé que les policiers ont
blâmé sa mère en disant qu'elle était ivre
au moment de l'incident. Bridget a demandé la tenue d'une
enquête indépendante et a dit regretter que
l'enquête nationale ne se penchera pas sur les autres cas que les
familles porteront à son attention. « Ce n'est pas juste
que l'enquête transmette l'information que nous lui donnons
à ceux contre qui les
plaintes sont portées, la police, a-t-elle ajouté. Nous
avons demandé de l'aide quand les femmes ont été
portées disparues, nous avons demandé de l'aide pour les
familles, mais nos demandes sont restées sans réponse. Je
viens ici depuis 15 ans et rien n'a changé. En fait, je
crois que les choses ont empiré. Mais nous voulons la justice.
Nous
ne voulons plus être ici à chaque année. Nous ne
devrions pas être forcées de supplier pour obtenir
justice. Nos familles méritent justice, nos proches
méritent justice. » Beverly Jacobs, une Mohawk
des Six Nations de la rivière Grand et ancienne
présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada
(AFAC), a parlé de la signification de la terre et du pouvoir
décisionnel concernant la terre en rapport avec l'injustice
coloniale qui se poursuit dans la vie des femmes autochtones. Sa
cousine a été
portée disparue et a été tuée en 2008.
« J'ai un message pour monsieur Trudeau. J'ai un message pour
Carolyn Bennett : vous devez répondre aux interrogations
sur les questions territoriales, a-t-elle dit. Ils doivent comprendre
le rapport direct entre nos femmes et la terre, ils doivent comprendre
que ce sont nos femmes qui sont aux
premiers rangs et qui font tout le travail. Ce sont elles qui sont
ciblées. Nos femmes sont ciblées parce que ce sont elles
qui portent la nation. Nous sommes encore un État colonial, nous
sommes encore un État policier, alors pour ce qui est de la
‘réconciliation', il faut une vraie
réconciliation. »
Beverly Jacobs, une Mohawk
des Six Nations de la rivière Grand et ancienne
présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada
(AFAC), a parlé de la signification de la terre et du pouvoir
décisionnel concernant la terre en rapport avec l'injustice
coloniale qui se poursuit dans la vie des femmes autochtones. Sa
cousine a été
portée disparue et a été tuée en 2008.
« J'ai un message pour monsieur Trudeau. J'ai un message pour
Carolyn Bennett : vous devez répondre aux interrogations
sur les questions territoriales, a-t-elle dit. Ils doivent comprendre
le rapport direct entre nos femmes et la terre, ils doivent comprendre
que ce sont nos femmes qui sont aux
premiers rangs et qui font tout le travail. Ce sont elles qui sont
ciblées. Nos femmes sont ciblées parce que ce sont elles
qui portent la nation. Nous sommes encore un État colonial, nous
sommes encore un État policier, alors pour ce qui est de la
‘réconciliation', il faut une vraie
réconciliation. » La vigile a
été ouverte par un discours et un chant honorifique de
Jocelyn Wabano-Iahtail, une membre de la nation crie d'Attawapiskat qui
vit maintenant à Ottawa et qui est bien connue pour ses
interventions à la défense de bonnes causes. Elle
a dit que le gouvernement ne peut pas parler de relations de nation
à nation pour ensuite
conclure des accords à l'insu de tout le monde et qu'elle et les
autres victimes, familles et communautés sont résolues
à prendre les choses en
main et à se représenter elles-mêmes. Elle a
réitéré que l'enquête sur les femmes
disparues et assassinées doit être holistique et
basée sur les pratiques autochtones. « Le Canada se vante
d'être le meilleur pays au monde, a-t-elle dit,
et pourtant les femmes autochtones du Canada vivent cette
brutalité. Nous demandons de ne pas être
déplacées physiquement, mentalement,
émotionnellement, spirituellement. » Jocelyn a
également pris part au dévoilement du Monument des robes
rouges pour rendre hommage à sa fille, Nitayheh, qu'elle a
perdue le 13
novembre 2001.
La vigile a
été ouverte par un discours et un chant honorifique de
Jocelyn Wabano-Iahtail, une membre de la nation crie d'Attawapiskat qui
vit maintenant à Ottawa et qui est bien connue pour ses
interventions à la défense de bonnes causes. Elle
a dit que le gouvernement ne peut pas parler de relations de nation
à nation pour ensuite
conclure des accords à l'insu de tout le monde et qu'elle et les
autres victimes, familles et communautés sont résolues
à prendre les choses en
main et à se représenter elles-mêmes. Elle a
réitéré que l'enquête sur les femmes
disparues et assassinées doit être holistique et
basée sur les pratiques autochtones. « Le Canada se vante
d'être le meilleur pays au monde, a-t-elle dit,
et pourtant les femmes autochtones du Canada vivent cette
brutalité. Nous demandons de ne pas être
déplacées physiquement, mentalement,
émotionnellement, spirituellement. » Jocelyn a
également pris part au dévoilement du Monument des robes
rouges pour rendre hommage à sa fille, Nitayheh, qu'elle a
perdue le 13
novembre 2001. « Pourtant ils nous
font revivre le traumatisme en nous traînant dans ce cauchemar.
Et moi j'en ai assez. J'en ai assez d'entendre nos dirigeants dire
qu'ils sont avec nous mais quand nous allons frapper à leurs
portes, ils ne répondent pas. Ils sont là pour la
séance de photos. Et j'en ai assez, je veux la justice pour ma
fille et pour Shannon, pour
toutes ces femmes : nos soeurs, nos enfants, nos tantes, nos
grand-mères, nos proches. C'est nous qui vivons le cauchemar,
pas eux, et ils doivent le comprendre. Ils nous font des promesses
mais, vous savez, nous n'avons rien reçu jusqu'à
présent. Rien de cette enquête. Ils vont prendre plusieurs
années à préparer un rapport alors que tant de
rapports ont déjà été
présentés », a dit Laurie.
« Pourtant ils nous
font revivre le traumatisme en nous traînant dans ce cauchemar.
Et moi j'en ai assez. J'en ai assez d'entendre nos dirigeants dire
qu'ils sont avec nous mais quand nous allons frapper à leurs
portes, ils ne répondent pas. Ils sont là pour la
séance de photos. Et j'en ai assez, je veux la justice pour ma
fille et pour Shannon, pour
toutes ces femmes : nos soeurs, nos enfants, nos tantes, nos
grand-mères, nos proches. C'est nous qui vivons le cauchemar,
pas eux, et ils doivent le comprendre. Ils nous font des promesses
mais, vous savez, nous n'avons rien reçu jusqu'à
présent. Rien de cette enquête. Ils vont prendre plusieurs
années à préparer un rapport alors que tant de
rapports ont déjà été
présentés », a dit Laurie.
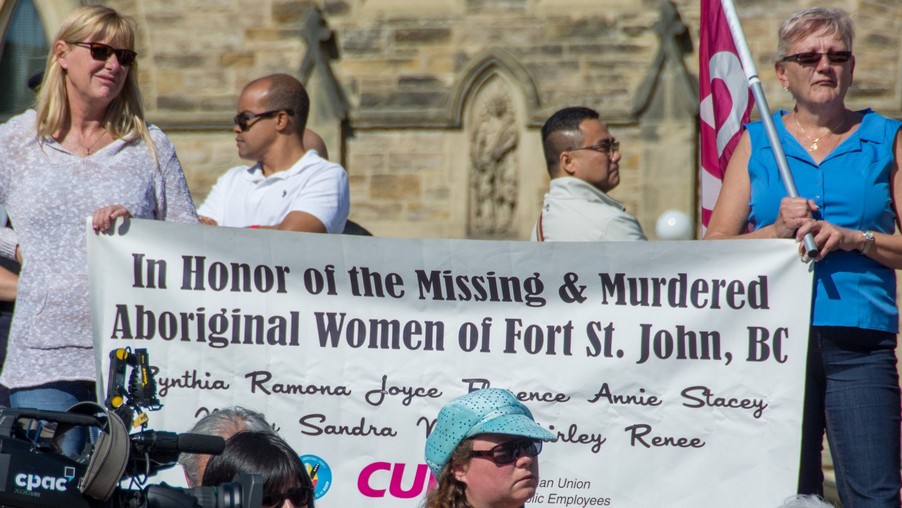








 Le premier ministre a
commencé en contredisant les intervenantes avant lui qui avaient
exprimé leur dégoût de devoir revenir devant le
parlement chaque année comme elles le font depuis dix ans alors
que les
femmes et filles continuent de subir les mêmes torts parce que le
gouvernement fédéral ne prend pas les mesures
nécessaires pour que justice soit faite. Il a dit: « Je
dois
d'abord dire que je ne suis pas d'accord avec plusieurs des
intervenantes qui m'ont précédé. J'espère,
moi, que nous allons continuer de nous réunir sur ces escaliers
tant que le Parlement derrière moi sera là, pendant de
nombreuses années, de
nombreux siècles encore, pour nous remémorer les
merveilleuses
femmes, les soeurs, qui nous ont été enlevées,
pour
nous rappeler que nous n'avons pas été capables de les
protéger. » Continuant de faire la sourde oreille aux
demandes que justice soit faite dans les faits, pas en paroles, le
premier ministre a
ensuite dit « espérer » que dans les
années qui viennent « nous allons pouvoir le faire comme
une commémoration de choses passées et non plus comme
l'expression d'une
tragédie nationale qui perdure. »
Le premier ministre a
commencé en contredisant les intervenantes avant lui qui avaient
exprimé leur dégoût de devoir revenir devant le
parlement chaque année comme elles le font depuis dix ans alors
que les
femmes et filles continuent de subir les mêmes torts parce que le
gouvernement fédéral ne prend pas les mesures
nécessaires pour que justice soit faite. Il a dit: « Je
dois
d'abord dire que je ne suis pas d'accord avec plusieurs des
intervenantes qui m'ont précédé. J'espère,
moi, que nous allons continuer de nous réunir sur ces escaliers
tant que le Parlement derrière moi sera là, pendant de
nombreuses années, de
nombreux siècles encore, pour nous remémorer les
merveilleuses
femmes, les soeurs, qui nous ont été enlevées,
pour
nous rappeler que nous n'avons pas été capables de les
protéger. » Continuant de faire la sourde oreille aux
demandes que justice soit faite dans les faits, pas en paroles, le
premier ministre a
ensuite dit « espérer » que dans les
années qui viennent « nous allons pouvoir le faire comme
une commémoration de choses passées et non plus comme
l'expression d'une
tragédie nationale qui perdure. »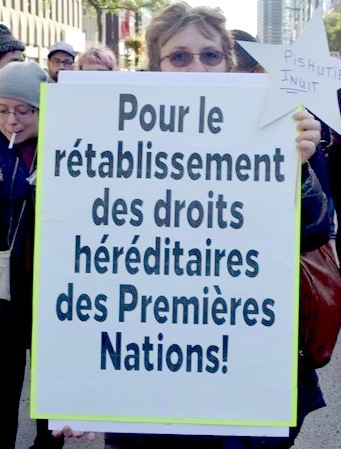 Le premier ministre et
son gouvernement semblent croire qu'il est acceptable de fouler au pied
les droits du peuple s'il y a suffisamment de sincérité
dans les voeux du gouvernement. Il a eu le front de parler du «
leadership extraordinaire » de la
ministre de la Condition féminine, de la ministre de la Justice
et Procureure générale et de la ministre des Affaires
autochtones
et du Nord qui « m'inspirent chaque jour ». Il a
déclaré qu'« il n'y a pas de relation plus
importante que celle que nous en tant que gouvernement du Canada
bâtissons, rebâtissons et réparons, avec laquelle
nous avançons, que la relation avec les Canadiens
autochtones », comme s'il pouvait changer la nature des
«nouveaux rapports» que son gouvernement impose aujourd'hui
par de belles phrases. Il part déjà d'un très
mauvais pied en se référant aux peuples
autochtones comme des « Canadiens autochtones ».
Le premier ministre et
son gouvernement semblent croire qu'il est acceptable de fouler au pied
les droits du peuple s'il y a suffisamment de sincérité
dans les voeux du gouvernement. Il a eu le front de parler du «
leadership extraordinaire » de la
ministre de la Condition féminine, de la ministre de la Justice
et Procureure générale et de la ministre des Affaires
autochtones
et du Nord qui « m'inspirent chaque jour ». Il a
déclaré qu'« il n'y a pas de relation plus
importante que celle que nous en tant que gouvernement du Canada
bâtissons, rebâtissons et réparons, avec laquelle
nous avançons, que la relation avec les Canadiens
autochtones », comme s'il pouvait changer la nature des
«nouveaux rapports» que son gouvernement impose aujourd'hui
par de belles phrases. Il part déjà d'un très
mauvais pied en se référant aux peuples
autochtones comme des « Canadiens autochtones ». 
 Les membres des familles, les
êtres chers et les survivantes méritent une enquête
nationale transparente, capable de rendre la justice et d'honorer
correctement les plus de 1200 femmes et filles autochtones
disparues et assassinées au Canada. Pour que l'enquête
nationale soit transparente, il faut, entre
autres éléments d'infrastructure nécessaires
à la réussite de l'enquête, de l'information
facilement accessible sur l'emplacement des bureaux dans les
différentes régions du Canada et les coordonnées
des commissaires et de leur personnel, un guide étape par
étape de
participation à l'enquête et un site Web simple et
cohérent.
Les membres des familles, les
êtres chers et les survivantes méritent une enquête
nationale transparente, capable de rendre la justice et d'honorer
correctement les plus de 1200 femmes et filles autochtones
disparues et assassinées au Canada. Pour que l'enquête
nationale soit transparente, il faut, entre
autres éléments d'infrastructure nécessaires
à la réussite de l'enquête, de l'information
facilement accessible sur l'emplacement des bureaux dans les
différentes régions du Canada et les coordonnées
des commissaires et de leur personnel, un guide étape par
étape de
participation à l'enquête et un site Web simple et
cohérent.

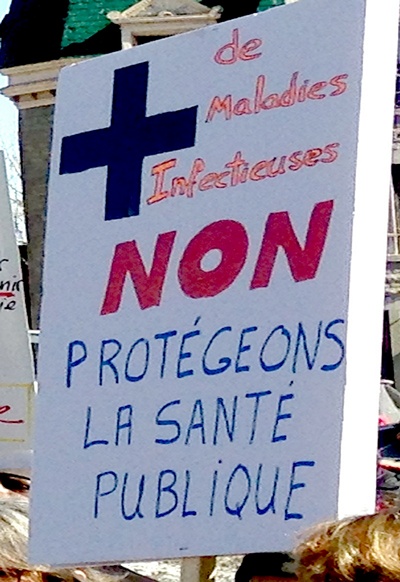







 Il a aussi
révélé que des «
stratèges » du Panama et du Brésil ont
suggéré une stratégie pour la campagne du Non qui
consistait à ne pas expliquer les accords et à concentrer
sur les messages qui soulèvent
l'indignation des gens
— une indication claire à l'effet que le but visé
était de faire sortir
le vote par le biais de l'incitation plutôt que de
l'information.
Il a aussi
révélé que des «
stratèges » du Panama et du Brésil ont
suggéré une stratégie pour la campagne du Non qui
consistait à ne pas expliquer les accords et à concentrer
sur les messages qui soulèvent
l'indignation des gens
— une indication claire à l'effet que le but visé
était de faire sortir
le vote par le biais de l'incitation plutôt que de
l'information.

 Entre-temps, le 20
septembre, le gouvernement a promis un montant supplémentaire
de 33,8 millions $ pour des « efforts de
déminage et de reconstruction », soit un jour
après que le ministre des Affaires étrangères,
Stéphane Dion, ait engagé 25 M $ à des
fins de projets de médiation de conflits, de
négociation et de reconstruction menés par l'ONU en
Colombie. Puis le 26 septembre, alors qu'il était à
Carthagène, en Colombie, pour assister à la signature de
l'accord de paix entre le gouvernement colombien et les FARC-EP, le
ministre Dion a annoncé un autre 21 millions $
répartis sur trois ans pour « consolider la
paix ». Il a dit que c'est pour appuyer l'allocation
de 57,4 millions $ à des « initiatives d'aide au
développement pour aider les populations touchées par le
conflit » faites en juillet par la ministre du
Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude
Bibeau.
Entre-temps, le 20
septembre, le gouvernement a promis un montant supplémentaire
de 33,8 millions $ pour des « efforts de
déminage et de reconstruction », soit un jour
après que le ministre des Affaires étrangères,
Stéphane Dion, ait engagé 25 M $ à des
fins de projets de médiation de conflits, de
négociation et de reconstruction menés par l'ONU en
Colombie. Puis le 26 septembre, alors qu'il était à
Carthagène, en Colombie, pour assister à la signature de
l'accord de paix entre le gouvernement colombien et les FARC-EP, le
ministre Dion a annoncé un autre 21 millions $
répartis sur trois ans pour « consolider la
paix ». Il a dit que c'est pour appuyer l'allocation
de 57,4 millions $ à des « initiatives d'aide au
développement pour aider les populations touchées par le
conflit » faites en juillet par la ministre du
Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude
Bibeau.