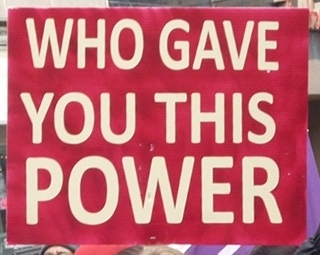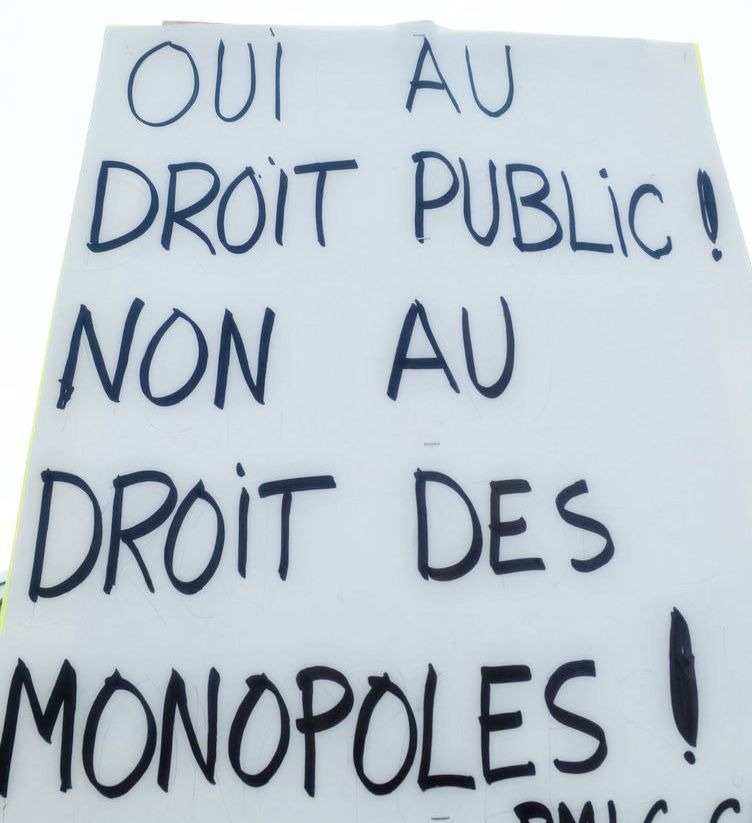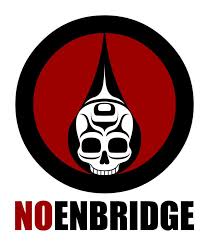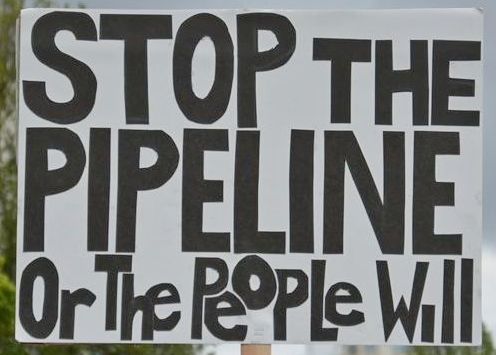|
Numéro 108 - 10 août 2016
Les jugements au sujet des
oléoducs Northern
Gateway et
Trans Mountain
À qui doit appartenir la
souveraineté
dans une nation moderne?
- Peggy Morton -
PDF

Rassemblement devant
l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique lors
de
la Journée d'action contre les oléoducs, 7 octobre 2013. (J.
Castro)
Les
jugements
au
sujet
des oléoducs Northern Gateway et Trans Mountain
• À qui doit appartenir la
souveraineté dans une nation moderne?
- Peggy Morton
• La Cour confirme le droit de monopole et nie
l'intérêt public - Peggy Askin
À titre
d'information
• La Cour fédérale renverse
l'approbation de l'oléoduc Northern Gateway
• Les «consultations approfondies»
du gouvernement fédéral sur
l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain
Les jugements au sujet de Northern
Gateway et Trans Mountain
À qui doit appartenir la souveraineté
dans une nation moderne?
- Peggy Morton -
Le 23 juin 2016, la Cour d'appel
fédérale a annnulé l'approbation de
l'oléoduc Northern Gateway dans un jugement sur la contestation
judiciaire des nations autochtones de l'autorisation
fédérale accordée en juin 2014. Toutefois, la
décision majoritaire de la Cour sur l'obligation du gouvernement
de consulter les peuples
autochtones ne laisse aucun doute que les arrangements
constitutionnelles actuels violent le principe des relations de nation
à nation. Dans ce jugement, la Cour affirme que la
souveraineté est exercée par la Couronne et la Couronne,
en affirmant sa souveraineté sur les nations autochtones, nie
leur souveraineté et les prive de leurs droits.

La Cour a conclu que le critère d'examen
approprié était celui du caractère raisonnable. Le
ministère public doit s'engager dans un véritable
processus de consultation avec les peuples autochtones. Les deux
parties doivent agir de bonne foi et être raisonnables, à
déclaré la Cour.
« Les deux parties sont tenues de faire preuve de
bonne foi dans le processus de consultation », lit-on dans
le jugement. De plus, la Cour affirme : « Par ailleurs, les
demandeurs autochtones ne doivent pas contrecarrer les efforts
déployés de bonne foi par la Couronne et ne doivent pas
non plus défendre des positions
déraisonnables pour empêcher le gouvernement de prendre
des décisions ou d'agir dans des cas où, malgré
une véritable consultation, on ne parvient pas à
s'entendre : Nation haïda , au
paragraphe 42. » [1]
La Couronne représentée par le gouverneur
en conseil (le Cabinet) possède de vastes pouvoirs
discrétionnaires pour décider ce qui est dans
l'intérêt national et affirmer son droit souverain de le
faire. Littéralement, le Cabinet peut déclarer tout ce
qu'il veut comme étant d'intérêt national. Le
consentement des nations
autochtones n'est pas nécessaire, car elles ne
sont pas considérées comme souveraines, et lorsque
l'accord est conclu, elles doivent se soumettre à la
décision prise par la Couronne, le Cabinet souverain. Les
gouvernés, les nations autochtones et les Canadiens, sont
privés de leur souveraineté et de leur droit de
décider. Ceux qui ne se soumettent pas à la
souveraineté de la Couronne représentée
par le gouverneur en conseil et, au contraire, décident
d'affirmer leur droit souverain de décider sont alors
diffamés comme étant «
déraisonnables » et ne partageant pas les valeurs
canadiennes définies par la Couronne et le Cabinet.
Le pouvoir absolu au nom de l'« unification des
divers intérêts »
La Cour d'appel fédérale cite des
références pour faire valoir que le pouvoir du Cabinet
est un moyen d'unifier les divers intérêts au Canada et de
satisfaire ces intérêts.

« Dans l'arrêt Odynsky, [2] la Cour a décrit comme suit la
nature pratique du gouverneur en conseil (au paragraphe 77) :
Selon le paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation
, L.R.C., ch. I-23, le gouverneur en conseil est le ' gouverneur
général du Canada agissant sur l'avis
ou sur l'avis et avec le consentement du Conseil privé de la
Reine pour le Canada ou conjointement avec celui-ci. Voir
également la Loi constitutionnelle de 1867,
articles 11 et 13. Tous les ministres fédéraux,
et non seulement le ministre de la Citoyenneté sont membres en
exercice du Conseil privé de la Reine pour le
Canada'. Ils siègent au sein d'un organisme connu sous le nom de
Cabinet. Le Cabinet est ' dans une mesure hors du commun, l'organe
supérieur de coordination des intérêts provinciaux,
régionaux, religieux, raciaux et autres propres à
l'ensemble de la nation' et par convention, cet organisme tente
d'assurer la représentation des divers groupes
géographiques, linguistiques, religieux et ethniques
[...] » [3]
« En l'espèce, en confiant le pouvoir
décisionnel au gouverneur en conseil, le législateur a
impliqué le pouvoir décisionnel du Cabinet, une
entité au sein de laquelle la politique générale
de l'État est débattue de multiples points de vue
représentant les divers intérêts des groupes qui
composent le gouvernement. Et en définissant de façon
large
ce qui peut être inséré dans le rapport sur lequel
le gouverneur en conseil se fondera pour prendre sa décision,
c'est-à-dire carrément tout ce qui a des
conséquences sur l'intérêt public, le
législateur est présumé avoir voulu que la
décision en cause en l'espèce repose sur le fondement le
plus large possible, un fondement qui peut comprendre les
considérations d'intérêt public les plus larges
possible. »
Décrire le Cabinet comme « une
entité au sein de laquelle la politique générale
de l'État est débattue de multiples points de
vue » et qui représente les divers
intérêts des groupes qui composent le gouvernement est une
conclusion qui convient à ceux qui ne partagent pas les
problèmes ou les aspirations des autochtones qui tous les jours
luttent pour la survie ou ceux de la classe ouvrière, qui
résiste à l'offensive néolibérale
antisociale et de tous ceux qui organisent et luttent pour
défendre les droits de tous.

Dans les « intérêts
divers » cités, sont ignorées les classes, les
préoccupations de la classe ouvrière et la contradiction
constante à laquelle fait face la classe ouvrière dans
les rapports sociaux qu'elle entretient avec ceux qui possèdent
et contrôlent les forces productives socialisés.
Aujourd'hui, le Parti libéral, le Parti
conservateur et les autres partis du système de gouvernance des
partis cartellisés définissent l'intérêt
public comme étant tout ce qui rend les monopoles plus
compétitifs au niveau international. L'autorité publique
dans toutes ses institutions, en particulier le gouvernement et le
Cabinet, a été directement
usurpée par les monopoles privés.
Aucun gouvernement de droit moderne ne peut être
qualifié de démocratique s'il ne garantit pas que les
citoyens sont en mesure de participer directement aux décisions
sur l'orientation de l'économie et toutes les questions qui les
concernent. Les gens doivent pouvoir participer directement, pas par
l'entremise de représentants de partis
politiques qu'ils n'ont pas choisis, pas élus et qu'il ne
peuvent tenir responsables. Rien dans le jugement de la Cour d'appel
fédérale n'est digne d'une démocratie moderne,
digne d'un Canada moderne. La Cour ne fournit pas aux citoyens du
Canada, du Québec et aux nations autochtones les moyens
d'exercer le contrôle sur leur vie et d'exercer
leur droit de décider mais s'appuie au contraire sur une
constitution et des règles de droit qui confient l'exercice de
la souveraineté à la Couronne et son gouverneur en
conseil.
La Cour d'appel confirme une forme de pouvoir
arbitraire et absolu d'une Couronne souveraine et de son gouverneur en
conseil (Cabinet). Ceux qui ne se soumettent pas au pouvoir souverain
du Cabinet peuvent être diffamés, criminalisés et
déclarés anti-canadiens parce qu'ils ne partagent pas les
valeurs définies par les libéraux et les autres
partis cartellisés.
Face à ce pouvoir archaïque et
antidémocratique, il faut de nouveaux arrangements
constitutionnels pour priver le Cabinet et son gouverneur en conseil de
la souveraineté et ainsi :
- investir le peuple du pouvoir souverain ;
- mettre fin à l'injustice coloniale ;
- établir des relations de nation à nation avec les
peuples
autochtones ;
- reconnaître le droit du Québec à
l'autodétermination ; et
- établir des mécanismes d'équilibre dans les
rapports sociaux, les rapports de production entre la classe
ouvrière et ceux qui possèdent et contrôlent les
forces productives socialisées qui reconnaissent et garantissent
les droits de la classe ouvrière, notamment le
droit fondamental d'éliminer les privilèges de classe par
la résolution de la contradiction des rapports sociaux
archaïques et la création de rapports de production
socialisés modernes en accord avec les forces productives
modernes socialisées.
Notes
1. Nation haïda c. Colombie-Britannique
(Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3
RCS 511.
2. Ligue des droits de la personne de B'Nai
Brith Canada c. Odynsky , 2010 CAF 307.
3. Norman Ward, Dawson's « The Government of
Canada » 6e éd., Toronto, Presses de
l'Université de Toronto, 1987, pages 203
et 204 ; Richard French, « The Privy Council
Office : Support for Cabinet Decision Making » dans
Richard Schultz, Orest M.
Kruhlak et John C. Terry, dir., « The Canadian Political
Process », 3e éd., Toronto, Holt Rinehart et
Winston of Canada, 1979, aux pages 363 et 394.

La Cour confirme le droit de monopole et
nie l'intérêt public
- Peggy Askin -
Le jugement de 100 pages de la Cour d'appel
fédérale renversant l'approbation de l'oléoduc
Northern Gateway s'applique à détailler les pouvoirs
arbitraires
ou discrétionnaires considérables du « gouverneur
en conseil », qui est le premier ministre et le Cabinet.
La décision fait référence
à l'autorité donnée au « gouverneur en
conseil » par le Parlement dans la Loi sur l'Office
national de l'énergie . La Loi déclare que «
celui-ci [l'intérêt public] englobe les
intérêts de tous les Canadiens et Canadiennes et consiste
en un équilibre entre les intérêts
économiques, environnementaux et
sociaux qui change en fonction de l'évolution des valeurs et des
préférences de la société ». La
Cour commente :
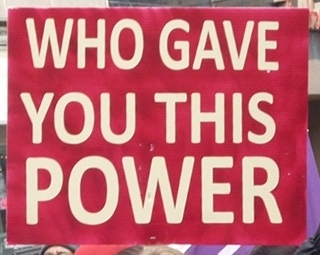
« Mais, en l'espèce (l'approbation de
l'oléoduc Northern Gateway), la décision
discrétionnaire du gouverneur en conseil était
fondée sur des considérations de politique et
d'intérêt public très larges appréciés
en
fonction
de
critères
polycentriques, subjectifs ou vagues et
était influencée par ses opinions sur les
considérations d'ordre
économique, culturel et environnemental et par
l'intérêt public général.»
(notre souligné)
« Les retombées économiques
associées à la construction et à l'exploitation
d'un système de transport qui permettra d'exploiter les
ressources pétrolières de l'Alberta et de les rendre plus
facilement accessibles partout dans le monde l'emportent-t-elles sur
les effets néfastes, réels ou possibles, y compris les
effets sur l'environnement et, plus
particulièrement, sur les éléments
mentionnés sous la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale (2012 ) ? Dans quelle mesure les conditions
auxquelles Northern Gateway doit satisfaire, dont plusieurs concernent
des questions techniques qui ne peuvent être
évaluées et soupesées que par des experts,
allègent ces
inquiétudes ? Et compte tenu de l'ensemble de ces
considérations, disposait-on de suffisamment de renseignements
de haute qualité pour que le gouverneur en conseil puisse
soupeser l'ensemble des considérations et évaluer
correctement l'affaire ? C'est le genre de questions que le
régime législatif en cause en l'espèce envoie au
gouverneur en conseil. Selon la jurisprudence susmentionnée qui
nous lie, nous devons accorder au gouverneur en conseil, quant à
ces questions, la marge d'appréciation la plus large
possible. »
À quoi ce jargon juridique se
résume-t-il ? L'intérêt public est tout ce que
le gouvernement déclare être l'intérêt
public. Sous la mondialisation néolibérale, on a
déclaré que l'intérêt public est de rendre
les monopoles de l'Amérique du Nord compétitifs
internationalement, spécifiquement les monopoles de
l'énergie et des oléoducs faisant
affaire au Canada.
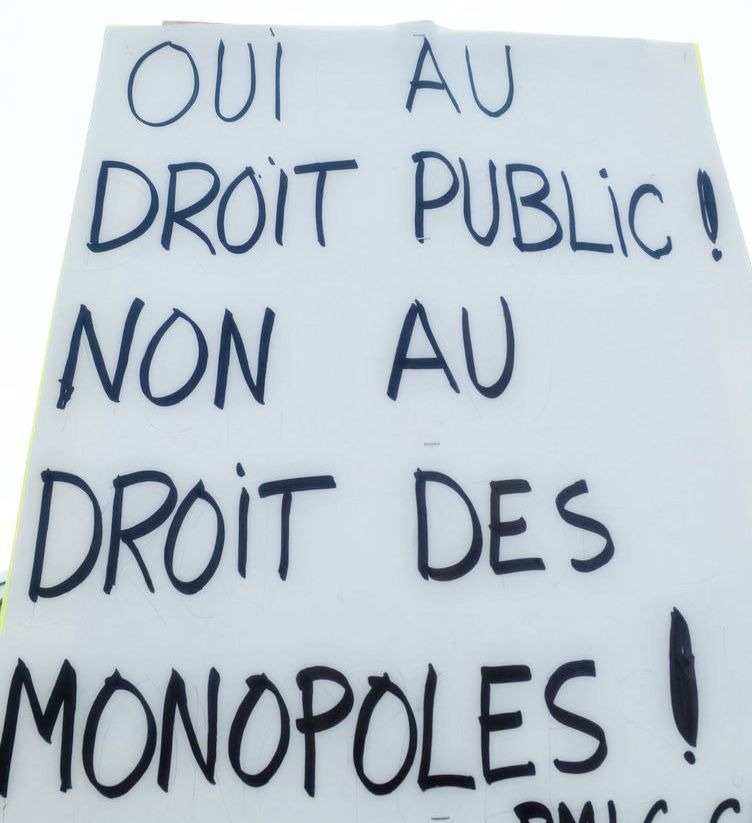
Les problèmes auxquels sont confrontés les
producteurs réels, la classe ouvrière et
l'économie socialisée ne sont pas
considérés comme pertinents dans la détermination
de ce qui est dans l'intérêt public. On prétend que
les intérêts des monopoles et les problèmes de
l'économie sont la même chose, ce qui n'est pas le cas.
Par exemple, le
chômage élevé est un cauchemar pour les
travailleurs, alors que ce sont les monopoles qui jettent les
travailleurs à la rue et pour qui un chômage
élevé est une « occasion » pour abaisser
les salaires et les conditions de vie et de travail des autres
travailleurs. Le processus « d'approbation »
basé sur ce qui est dans l'intérêt public est
réduit à dire oui ou non aux décisions
prises par ces mêmes monopoles. En fait, tout ce qui a trait
à la recherche d'alternatives réelles à la
direction actuelle de l'économie est exclu des questions qui
sont prises en considération pour décider ce qui est dans
l'intérêt public. On répète à
satiété que le problème c'est le prix du
pétrole et que la
solution est l'exportation via les oléoducs du bitume non
transformé parce que les entreprises vont pouvoir obtenir un
prix plus élevé. En quoi le prix du pétrole
peut-il être le problème ? Le problème, c'est
la direction de l'économie qui est subordonnée aux
objectifs de l'oligarchie financière internationale et à
la prise de décision faite sur
une base supranationale. L'alternative réside dans
l'édification nationale, pas l'édification d'empire. Un
contrôle public sur le secteur de l'énergie peut
être établi. Le Canada pourrait déterminer le prix
de son pétrole, arrêter l'importation de pétrole et
servir son propre marché interne. Le pétrole et les
autres ressources d'énergie doivent être reconnus
comme des ressources stratégiques et la base du
développement d'un secteur manufacturier vibrant. L'ineptie
égoïste à l'effet que le choix est entre le
bénéfice économique et les effets néfastes
sur l'environnement doit être traitée avec le
mépris qu'elle mérite. Les Canadiens et les
Premières Nations doivent exercer l'autorité
décisionnelle et ne pas
permettre aux monopoles de l'usurper à leurs propres fins.
La décision de la Cour d'appel
fédérale est une défense du droit de monopole au
sein du système impérialiste d'États dominé
par les États-Unis. Ce n'est pas vrai qu'en prolongeant la
« consultation » dans le cadre de cette
définition, comme le fait maintenant Trudeau dans le cas de
l'oléoduc Trans Mountain, que les Canadiens ont
maintenant leur mot à dire et que les droits des nations
autochtones sont reconnus.
Une définition moderne des droits comprend le
droit de décider, dont le droit de décider de la
direction de l'économie, et les droits des nations autochtones
et des Métis de vivre et d'être sur leurs terres
ancestrales. Ces droits doivent être enchâssés dans
une constitution moderne et garantis. Le renouveau démocratique
signifie que c'est le
peuple qui doit être souverain, pas le « gouverneur en
conseil » par le biais duquel les monopoles exercent leur
diktat.

À titre d'information
La Cour fédérale renverse l'approbation
de
l'oléoduc Northern Gateway
Le 23 juin, la Cour fédérale d'appel
du Canada a rendu sa décision sur les contestations judiciaires
des nations autochtones et des organismes canadiens au projet
d'oléoduc Northern Gateway. [1]
Dans une décision partagée de deux à une, le
tribunal a annulé l'approbation que le gouvernement
Harper avait donnée à l'oléoduc. La
décision précise que le gouvernement n'a pas soutenu
« l'honneur de la Couronne » et n'a pas assumé
ses
responsabilités constitutionnelles de consulter et d'accommoder
les peuples autochtones auxquels la Cour se réfère
souvent comme des « groupes autochtones ».
L'oléoduc proposé par Northern
Gateway expédierait le bitume de l'Alberta vers Kitimat, en
Colombie-Britannique, puis vers les marchés étrangers par
navires-citernes.
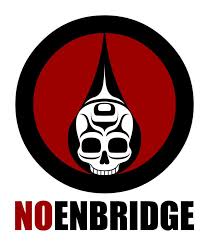
Les médias ont essentiellement décrit la
décision comme une « annulation de
l'oléoduc », mais c'est loin d'être le cas. Le
tribunal a déclaré que le processus d'examen conjoint,
soit une audience réunissant à la fois l'Office national
de l'énergie (ONE) et l'Agence canadienne d'évaluation
environnementale (ACEE), a satisfait à la norme
de « caractère raisonnable » et que le Canada a
agi de bonne foi dans ses consultations avec les nations autochtones.
Cependant, « le gouverneur en conseil » (le Cabinet)
n'a pas rempli ses obligations à la Phase IV, soit les
consultations qui ont lieu avec les nations autochtones après
que l'ONÉ ait approuvé un projet mais avant que le
gouvernement émette des certificats d'approbation.
On lit dans la décision : « Les
faiblesses — plus qu'une simple poignée et plus que de simples
imperfections — ont laissé des sujets entiers liés
à des questions centrales aux Premières Nations
concernées, des sujets affectant leur moyens de subsistance et
de
bien-être parfois totalement ignorés. Plusieurs impacts du
projet [...] n'ont pas été
divulgués, discutés et
considérés. »[2]
En outre, il est dit : « Il aurait suffi de
peu de temps et de peu d'efforts d'organisation pour le Canada afin
d'entamer un dialogue véritable sur ces sujets de
première importance pour les peuples autochtones. Mais cela ne
s'est pas produit. »
L'allusion est évidente : la consultation
« significative » n'aurait pas modifié la
décision finale et son approbation mais elle aurait pu donner
lieu à conditions supplémentaires devant être
satisfaites par Enbridge et Northern Gateway. La Cour rejette
explicitement la position des Haisla et d'autres nations que la
consultation
significative exige un dialogue à deux voies, alors que le
processus de la Commission d'examen conjoint a été un
processus quasi-judiciaire dans laquelle la Couronne et les nations
autochtones n'avaient pas d'échanges directs entre elles. La
décision de la Cour suggère qu'un échange direct
est nécessaire seulement après que l'ONÉ et l'ACEE
aient
rendu leur décision.
Dans le sillage de la décision, le gouvernement
Trudeau a mis en attente la demande d'Enbridge pour une prolongation de
la date limite de 2016 pour le début de la construction de
l'oléoduc. La Cour, dans sa décision, n'exige pas que le
gouvernement relance le processus d'approbation de Northern Gateway et
il pourrait simplement
décider de reprendre la phase IV à une date
ultérieure. Les consultations de la phase IV de l'oléoduc
Trans Mountain, qui a reçu l'approbation de l'ONÉ
le 19 mai dernier, sont maintenant en cours. La décision de
la Cour d'appel est un modèle pour le gouvernement Trudeau quant
à la façon de procéder avec ces consultations
d'une manière
qui va résister à une contestation judiciaire.
Dans son jugement, la Cour rejette tous les arguments
sauf un qui ont été présentés par les
nations autochtones. Toutes les objections au processus d'examen
conjoint, dont son non respect de l'obligation du Canada de
consultation et d'accommodement en ce qui a trait aux droits et aux
titres autochtones, le fait que les intervenants ont été
privés d'informations cruciales, et les objections en vertu du
droit de participer à l'établissement des conditions et
de la portée de l'examen, sont rejetées . « Du
point de vue du droit, la Couronne a toute latitude pour définir
la structure du processus de consultation et pour s'acquitter de son
obligation de consulter », déclare la Cour.
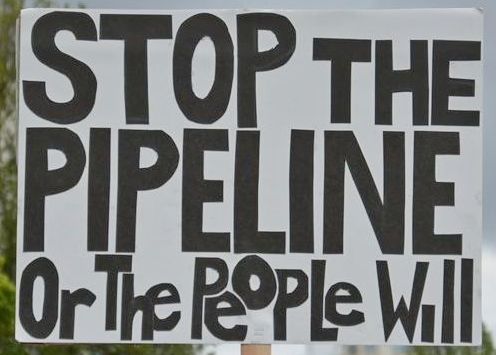
La Cour entérine également que
l'ONÉ et la législation habilitante n'aient pas
établi les critères sur lesquels un examen rigoureux
pourrait être fondé pour déterminer ce qui est dans
l'intérêt public, en réitérant que ces
décisions relèvent des pouvoirs discrétionnaires
ou arbitraires du Cabinet. Elle rejette l'argument selon lequel les
audiences ont
été une fraude parce que le gouvernement Harper a
annoncé sa décision avant même le début des
audiences.
Les juges sont d'accord avec l'affirmation du
gouvernement selon laquelle il n'est pas tenu de communiquer son
évaluation de la solidité de la revendication et de
l'ampleur de la consultation parce que les tribunaux ont
déjà établi que cette information est «
visée par la relation confidentielle entre un avocat et son
client ». Le
gouvernement doit seulement fournir une description de son
évaluation.
La Cour affirme que le Canada est obligé de
tenir une « consultation approfondie » avec les
Premières nations touchées, ce qui est
considéré comme le plus haut niveau de consultation
possible, mais n'a pas besoin du consentement. Cependant, cette «
consultation approfondie » peut être effectuée
une fois le processus de prise de
décision complété, à l'exception de
l'approbation finale par le Cabinet.
La Cour écrit : « Comme nous l'avons
expliqué ci-dessus, l'obligation de consulter est une obligation
procédurale qui découle de l'honneur de la Couronne. Le
fil conducteur du côté de la Couronne doit être '
l'intention de tenir compte réellement des préoccupations
[des Autochtones] ' à mesure qu'elles sont exprimées
[...] dans le cadre
d'un véritable processus de consultation » [3] [...] La ' question décisive
dans toutes les situations consiste à déterminer ce qui
est nécessaire pour préserver l'honneur de la Couronne
pour concilier les intérêts de la Couronne et ceux des
Autochtones ' [4]
[...].
« À notre avis, il n'était pas
compatible avec l'obligation de consultation et l'obligation de
négociation honorable que le Canada se contente d'affirmer que
les répercussions du projet seraient atténuées
sans d'abord discuter de la nature et de la portée des droits
qui seraient touchés. Pour que les demandeurs/appelants
Premières nations puissent
se consulter et évaluer les répercussions du projet sur
leurs droits, un dialogue respectueux sur les droits revendiqués
doit d'abord avoir eu lieu. Une fois que l'obligation de consulter est
reconnue, une omission de consulter ne peut être justifiée
en passant directement à l'étape des accommodements. Le
fait de procéder ainsi est incompatible avec le
principe de négociation honorable et de
réconciliation. »
Un « dialogue respectueux » n'a rien
à voir avec la reconnaissance des droits et leur garantie,
encore moins avec la nécessité constitutionnelle moderne
voulant que le Canada établisse des relations de nation à
nation avec les nations autochtones. Les peuples autochtones ne sont
pas des peuples conquis et ils n'ont jamais abandonné
leurs droits en tant que peuples indépendants qui ont le droit
de décider des questions qui affectent leur territoire. Le
gouvernement canadien ne devrait pas et ne peut pas les priver de leurs
droits.
Si l'obligation de consultation est réduite
à un accommodement après que les décisions aient
été prises, qu'en est-il alors du droit de décider
ou de l'affirmation de l'indépendance ? Pour mettre un
terme à l'injustice coloniale, des relations de nation à
nation doivent être établies de façon
concrète, de sorte que les nations autochtones
puissent s'épanouir.
Notes
1. La nation Gitxaala, la nation
Gitga'at, la nation Haisla, la nation
Kitasoo Xai'Xais, la nation Heiltsuk, la bande de Nadleh Whut'en, ainsi
qu'UNIFOR, ForestEthics, Living Oceans Society, Raincoast Conservation
Foundation et la Fédération des naturalistes de la
Colombie-Britannique ont intenté une poursuite contre Sa
Majesté
la Reine, le procureur général du Canada, le ministre de
l'Environnement et Northern Gateway Pipelines inc.
2. La Cour a pris note des questions très
précises formulées par les premières nations
Haisla, Kitaso et Heiltsuk y compris le temps de réponse en cas
de déversement, la récupération des
déversements et l'étude scientifique sur la façon
dont le bitume se comporte dans l'eau. Il n'y avait en fait aucune
consultation, si ce n'est la collecte de l'information qui a
été résumée, souvent de façon
erronée, et envoyée au Cabinet. Des erreurs dans le
résumé n'ont jamais été corrigées.
Le représentant du gouvernement a reconnu qu'un
déversement de pétrole pourrait avoir un effet
catastrophique sur les intérêts des Gitxaala et sur
l'industrie du hareng dont
les Heiltsuk dépendent. Pourtant, aucune réponse n'a
jamais été reçue à des questions
spécifiques concernant le rapport du groupe d'experts sur la
sécurité des navires-citernes au Canada et le rapport sur
les questions de navigation. Des questions spécifiques sur
l'impact d'un déversement de bitume, le temps de réponse
en cas de déversement et la
récupération du bitume déversé n'ont
reçu aucune réponse. N'ayant aucune autorité de
faire quoi que ce soit sinon recueillir de l'information, les
représentants du gouvernement à la table ne pouvaient que
répondre : « Si c'est possible d'avoir plus de
réponses, nous allons essayer de les obtenir. »
3. Nation Haïda c. Colombie-Britannique
(Ministre des Forêts), 2004 CSC 7, 3
RCS 511, au paragraphe 42.
4. Nation Haïda , au
paragraphe 45

Les «consultations approfondies» du
gouvernement fédéral sur l'expansion
de l'oléoduc Trans Mountain

Manifestation
à Burnaby Mountain le 13 septembre 2014 (S. Collis)
Depuis soixante ans, l'oléoduc de Trans Mountain
de Kinder Morgan est le seul à transporter des produits
pétroliers vers son terminal de la côte ouest à
Burnaby, en Colombie-Britannique. En décembre 2013, Trans
Mountain a soumis un projet auprès de l'Office national de
l'Énergie (ONÉ) visant à prolonger de façon
significative
son réseau, ce qui devrait tripler sa capacité. Le projet
a suscité une vive opposition de la part des Premières
Nations, des gouvernements municipaux et des communautés vivant
le long de la route de l'oléoduc et tout particulièrement
dans les basses terres du fleuve Fraser où est situé le
terminal de l'oléoduc de même que le port à partir
duquel le
pétrole serait expédié outre-mer. Pas une goutte
de cette nouvelle capacité ne sera raffinée en
Colombie-Britannique. Le trafic des pétroliers dans le port de
Vancouver serait accru de 600 %.
L'Office national de l'Énergie a publié
son rapport suite à cette requête le 19
mai 2016. On y lit : « L'Office national de
l'Énergie (ONÉ) conclut que le projet d'agrandissement du
réseau de Trans Mountain (le projet) est dans
l'intérêt public du Canada et recommande au gouverneur en
conseil d'approuver le projet sous
réserve de 157 conditions ».
En évaluant si le projet est dans
l'intérêt public, l'Office a conclu qu'il comporterait de
nombreux avantages pour le Canada. Ceux-ci seraient
considérables et comprendraient, entre autres :
- un accès accru aux divers marchés pour
le pétrole canadien ; - la création de milliers
d'emplois dans le domaine de la construction et de centaines d'emplois
à long terme, qui seraient directement reliés au projet,
et ce, partout au Canada ; - le renforcement de la capacité
des entreprises, des collectivités et des résidents
locaux et
autochtones ; - des avantages considérables dus aux
dépenses directes engagées relativement aux
matériaux pour les pipelines au Canada. - des revenus importants
pour les gouvernements.
Les Libéraux de Justin Trudeau avaient pourtant
soutenu en 2015 que le processus de révision entrepris par
le gouvernement Harper était déficient. Ils
s'étaient engagés à « restaurer la confiance
dans les évaluations environnementales ». Le 27
janvier, ils ont créé un Comité ministériel
pour mener des « consultations plus
approfondies ». Malgré tout, ils n'ont rien fait pour
retenir le rapport de l'ONÉ qui recommande le projet et a
été publié seulement deux jours après
l'annonce de la formation du Comité ministériel.
Le communiqué de presse émis le 27
janvier par le comité avait créé quelque espoir
dans certains milieux. Catherine McKenna, la ministre de
l'Environnement et du Changement climatique, et Jim Carr, le ministre
des Ressources naturelles, avaient annoncé une «
démarche provisoire qui comprend des principes et des mesures
pour les
grands projets ». On avait réitéré
l'engagement à l'effet que « le gouvernement introduira de
nouveaux processus d'évaluation environnementale afin de
rétablir la confiance du public dans ceux-ci. Il sollicitera et
prendra en compte les vues des citoyens. La prise de décision
reposera sur des données scientifiques probantes. Les peuples
autochtones seront davantage impliqués dans l'examen et la
surveillance des grands projets d'exploitation des ressources. Le
processus aura une transparence accrue ».
Les « plans et principes » de cette
« approche provisoire » devaient s'appliquer à
deux projets spécifiques, soit l'expansion de Trans Mountain et
l'oléoduc Énergie Est. Pour ce qui est du projet
d'expansion de Trans Mountain, le plan devait être le
suivant :
« ...le gouvernement du Canada entend :
- mener des consultations plus approfondies
auprès des peuples autochtones et débloquer des fonds
pour encourager la participation aux consultations ; -
évaluer les émissions de gaz à effet de serre en
amont imputables au projet et rendre cette information publique ;
- nommer un porte-parole ministériel qui sollicitera les points
de
vue des populations susceptibles d'être touchées par le
projet, y compris les communautés autochtones, et qui rendra
compte au ministre des Ressources naturelles. »
Le gouvernement a annoncé en même temps
que le délai prescrit pour la décision du gouverneur en
conseil sur le projet Trans Mountain était prolongé
jusqu'en décembre 2016. Le 16 mai, le ministre Carr
annonçait que le Comité ministériel du projet
d'agrandissement du réseau de Trans Mountain serait
composé de Kim Baird
(présidente), Tony Penikett et Annette Trimbee.
Ce comité a été chargé d'
« entrer en relation avec les collectivités et les
groupements autochtones locaux, en même temps que
d'étudier les observations qui seront formulées en ligne,
au sujet du projet et des questions qui s'y rattachent. Il commencera
son travail en juin pour le conclure en novembre par un rapport au
ministre Carr, qui sera
rendu public. »
Des assemblées publiques sont prévues en
août à Vancouver, Burnaby et Victoria (voir l'horaire). Des
assemblées ont
déjà eu lieu en juillet dans plusieurs villes de
l'Alberta et de la Colombie-Britannique. L'approche provisoire repose
sur les cinq principes énoncés en janvier :
1. Aucun promoteur n'aura à retourner au
point de départ - l'examen des projets se poursuivra dans le
cadre législatif actuel et en conformité avec les
traités, sous les auspices des autorités responsables et
des organismes de réglementation du Nord ;
2. Les décisions se fonderont sur des
données scientifiques, le savoir traditionnel des Autochtones et
d'autres données pertinentes ;
3. Les vues du public et des populations
concernées seront recueillies et prises en compte ;
4. Les peuples autochtones seront consultés
sérieusement et, s'il y a lieu, il sera tenu compte des
répercussions eu égard à leurs droits et
intérêts ;
5. Les émissions de gaz à effet de
serre directes et en amont attribuables aux projets à l'examen
seront évaluées.
Restaurer la confiance

Le vernis de légitimité de ce processus
est très mince. Dès le début, la
légitimité de la démarche a été
ternie par le fait que Trudeau a déjà annoncé
qu'il appuyait l'extension de Trans Mountain, d'autant plus que
l'ONÉ avait déjà émis, avant le
début des présentes consultations, son rapport qui
recommande l'approbation du projet. Les
assemblées qui se sont tenues jusqu'à présent ne
sont pas différentes de celles organisées par le
gouvernement Harper, avec des restrictions sur qui peut intervenir, un
manque d'information publique sur les heures et les lieux des
assemblées et peu d'efforts pour faire participer le public.
Plusieurs personnes ont aussi parlé d'un conflit
d'intérêt
puisque le président du Comité est lié depuis
longtemps à Kinder Morgan.
Il n'est donc pas surprenant que les Libéraux
reconnaissent que la confiance du public est ébranlée,
d'autant plus qu'en 2015 des manifestants de Burnaby Mountain ont
été arrêtés alors qu'ils revendiquaient que
Kinder Morgan cesse d'abattre des arbres et de mener des
activités de forage dans un secteur protégé de
Burnaby Mountain. Il
y a eu un tollé général lorsqu'en
janvier 2016 le public n'a pas été autorisé
à participer aux audiences de l'ONÉ, ne serait-ce
qu'à titre d'observateur. Tout avait été mis en
place pour empêcher la participation du public dans la
démarche de l'ONÉ et le public n'a eu, à toutes
fins pratiques, aucune influence sur la décision de l'office. La
majorité des contributions aux audiences de l'ONÉ ont
soulevé de sérieuses préoccupations
environnementales et d'autres sortes mais celles-ci n'ont pas
pesé lourd dans la balance puisque l'ONÉ a conclu que le
projet était dans « l'intérêt
public ».
Tout indique que les « consultations
approfondies » entreprises par le Comité
ministériel n'offriront rien de substantiellement
différent de ce qui a été fait jusqu'à
maintenant.

Lisez Le
Marxiste-Léniniste
Site web: www.pccml.ca
Courriel: redaction@cpcml.ca
|