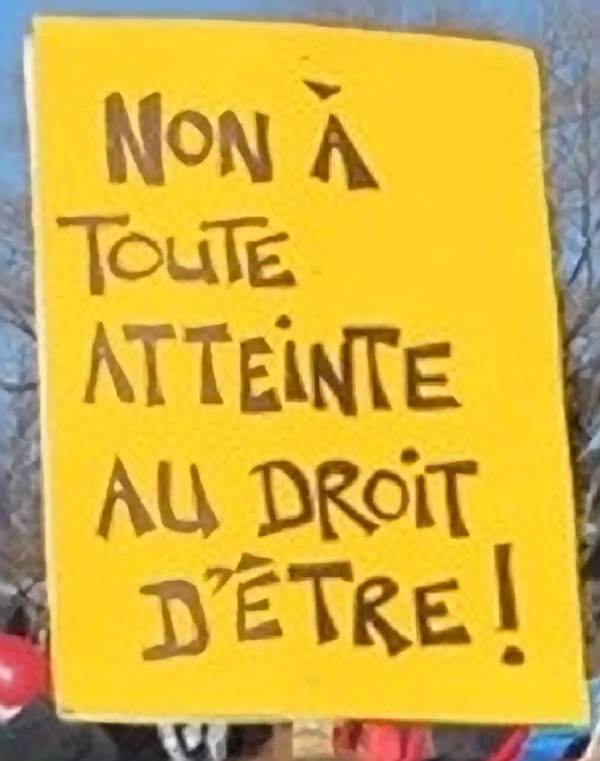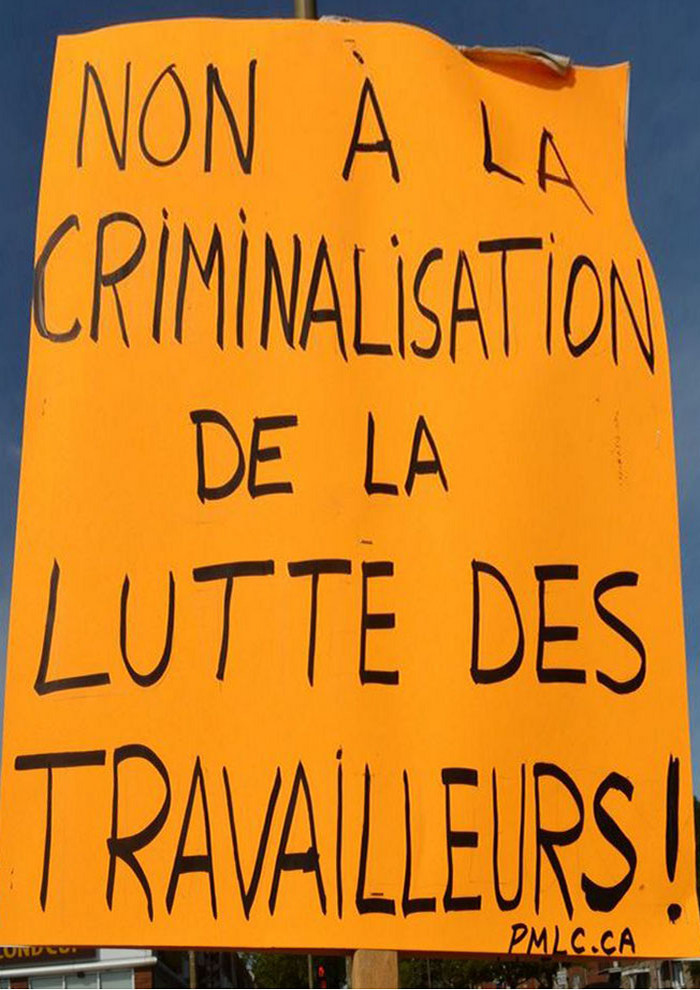|
|
Numéro 49 - 9 décembre 2017 Supplément Les droits : une définition moderne
LML
reproduit ici cet important article de Hardial Bains originalement
publié dans Le Marxiste-Léniniste les 11, 12 et 13 décembre 1992. * * *
Par définition, un droit se rapportant aux êtres humains est quelque chose qui apparaît à une étape donnée de l'évolution des humains et de la société. Les droits apparaissent historiquement ; ils sont une expression concentrée de l'ensemble des qualités de l'individu et de la société humaine à une époque donnée. On ne saurait concevoir un droit qui transcende le développement historique et les conditions des êtres humains et de la société humaine. Aussi les droits sont-ils une expression de la nature de la société. Ici l'attitude formaliste ne ferait qu'obscurcir l'étude des conditions dans lesquelles les droits existent. La lutte pour les droits humains aujourd'hui révèle que la société est suffisamment avancée pour que ces droits trouvent leur expression et que les êtres humains sont désireux de combler le manque. Or, certaines conditions continuent de poser un obstacle à leur épanouissement et les êtres humains s'efforcent de changer ces conditions. Les droits des êtres humains ne s'expriment pas uniquement par le fait qu'ils sont accordés par tel ou tel pouvoir économique ou politique, par telle ou telle institution sociale ou culturelle. Ces droits doivent être examinés tels qu'ils existent dans une société donnée et dans des conditions internationales données, afin que l'on puisse déterminer dans quelle mesure la société doit progresser. Évidemment, les droits humains, comme tous les autres droits, doivent être garantis, mais cela n'est pas possible s'il n'existe pas préalablement des conditions favorables à leur épanouissement. Par exemple, on ne saurait parler de droits humains si le droit à un moyen d'existence n'est pas réalisé par la société ou si cette société est constamment menacée par une autre. Pour déterminer la mesure dans laquelle existent les droits humains dans une société donnée, il faut tenir compte du degré de développement social et économique de la société, des rapports entre les États et de l'ensemble des conditions nationales et internationales. Par définition un droit ne peut être accordé ou retiré. À une étape donnée du développement de la société, le droit est ; il est reconnu du fait de l'existence de la société comme telle. Différents États, notamment les plus puissants, comme les États-Unis, ne veulent pas garantir les droits humains. D'abord ils créent de la confusion au sujet de la définition des droits humains, leur attachant une condition autre que celle d'appartenir aux êtres humains, soit une condition de nature politique, idéologique, religieuse, culturelle ou morale. Armés de leur définition, ils s'ingèrent dans ces droits et légifèrent à leur sujet sans s'occuper des conditions existantes de la société. Ces États ne reconnaissent pas les droits humains en les garantissant par la loi ; ils garantissent plutôt ce qui profite aux plus puissants du point de vue économique et politique. Le cas de Ross Perot qui en raison de sa richesse jouit d'un plus grand droit d'élire et d'être élu que la presque totalité des autres citoyens américains, fait mentir les prétentions démocratiques de l'État américain.[1] L'intervention des privilèges et de la richesse dans le processus politique porte atteinte au droit de tous les citoyens d'être égaux devant le processus politique et de participer en tant qu'égaux à l'administration de leurs affaires. Lorsque l'être humain vient au monde, il ou elle est une personne définie par l'étape du développement de la société à laquelle il ou elle appartient. Des droits humains lui sont reconnus dans la mesure où la société les favorise. Il est possible de déterminer le sort de cette personne en examinant la société à laquelle elle appartient. II y a très peu ou pas d'État aujourd'hui qui commence par l'étude des droits tels qu'ils sont, tels qu'ils existent dans la société. Il y a des États qui interdisent la reconnaissance des droits, bien qu'il n'y ait aucun obstacle à leur existence du point de vue du développement social. C'est le cas du Koweït où n'existe même pas le suffrage universel. Pourquoi n'y a-t-il pas de suffrage universel au Koweït ? Pour quelle raison nie-t-on aux Koweïtiens le droit au suffrage universel ? L'obstacle est-il le pouvoir et les privilèges de l'émir ? L'étude des conditions dans d'autres pays démontre qu'il existe des obstacles bien précis à la pratique du suffrage universel. Dans la plupart des pays dont la société est divisée entre riches et pauvres, le suffrage universel n'a qu'une valeur nominale. Ce sont les plus riches qui décident du genre de gouvernement, de sa composition et de sa politique. Y a-t-il une raison pour laquelle les droits tels qu'ils existent sont niés aux citoyens du monde aujourd'hui ? Quelle est-elle ? Pourquoi nie-t-on aux êtres humains les droits tels qu'ils existent ? Pourquoi n'y a-t-il aucune société au monde aujourd'hui où les droits humains existent entièrement ? Les droits tels qu'ils existent est une abstraction, une définition du caractère de la société qui affirme que ses membres peuvent faire des réclamations à la société en raison du fait qu'ils sont des êtres humains. Cependant, le membre individuel de la société ne peut jouir de ce droit, ne peut faire de réclamation à la société, s'il n'existe pas les conditions préalables. La condition première, décisive, est que l'ensemble du collectif, la société comme telle, doit lutter pour l'intérêt général de la société et pour l'intérêt individuel de chacun de ses membres. Ce qui appartient d'abord à l'individu, les droits tels qu'ils existent, appartient alors aux conditions. Les droits tels qu'ils existent ne peuvent pas devenir une réalité à moins que ces conditions existent. Depuis la Renaissance jusqu'à la révolution démocratique du XVIIIe siècle, la société était la condition de l'expression de ce droit. Par la suite, cependant, cette même société est devenue l'obstacle à l'expression du droit et c'est le collectif au sein de la société qui est devenu la condition. La société d'aujourd'hui est passée par de grandes transformations. De la liberté de l'entreprise à la naissance des monopoles et des oligopoles, la société bourgeoise n'accepte plus l'expression de ce droit. Elle agit comme la vieille société qu'elle a renversée, la société féodale qui avait concentré les privilèges et le pouvoir entre les mains de la noblesse qui s'en servait pour priver le reste de la population de ses droits. La société moderne ressemble à cette vieille société à plusieurs égards. Si la société n'est plus la condition de l'expression des droits tels qu'ils existent, quelle est cette condition ? On ne saurait dire que les droits tels qu'ils existent trouvent leur expression dans la destruction de la société. On pourrait dire que leur expression se trouve dans la destruction du caractère bourgeois de la société. Mais il y a plus. Si dans la société féodale la libre entreprise était l'arme contre l'absolutisme et l'aristocratie, dans la société moderne il y a autre chose, propre à cette société, qui sert de base à l'expression des droits tels qu'ils existent. C'est le collectif ou, en termes politiques, la cellule de base par laquelle l'individu lutte pour l'expression de ses droits tels qu'ils existent. En termes économiques, les travailleurs s'unissent dans des associations, des syndicats et des organisations, comme peuvent le faire tous les autres individus. Le collectif est la condition qui élimine ce caractère de la société qui fait obstacle à l'expression des droits tels qu'ils existent pour tous.
Le problème tel qu'il existe à l'échelle mondialeAujourd'hui, qu'il s'agisse du Canada, de l'Inde ou d'un autre pays, le problème des droits se pose de manière spécifique. De cette considération, on peut dire qu'il se pose partout de la même façon. Il n'est pas rare que soit contesté le droit d'un gouvernement de faire telle ou telle chose. Tout en étant conscients de ce que l'individu doit ou ne doit pas faire, aujourd'hui les citoyens se préoccupent surtout de ce que l'État peut ou ne peut pas faire. L'État a-t-il le droit de réprimer ceux qui s'insurgent contre lui ? Voilà qui est devenu une des questions les plus cruciales. Le peuple a-t-il le droit de renverser un gouvernement ou un État qui l'opprime ? On admet généralement que s'il n'y a pas d'autre recours contre l'oppression, la force est la seule voie. Mais à l'époque moderne, les nations les plus puissantes se servent de cet argument à leurs fins. Le problème tel qu'il existe dans le monde est que les conditions existantes à différents endroits dans le monde expriment la condition qui est faite à certaines classes ou couches de la société. Ces conditions révèlent une tendance non refrénée à l'enrichissement des riches et à l'appauvrissement des pauvres. Les riches ont-ils le droit de devenir plus riches et les pauvres ont-ils le droit de ne pas être appauvris ? Comment faut-il aborder ces problèmes qui existent ? Un employeur a-t-il le droit de fermer une usine si elle ne lui rapporte plus suffisamment de profits ? Les travailleurs ont-ils le droit de ne pas être mis à pied ? Les conditions indiquent que le développement économique a engendré des superstructures économiques et politiques qui rendent impossible l'expression des droits tels qu'ils existent. À sa place se trouve l'expression des problèmes tels qu'ils existent. La définition d'un droit qui part du droit tel qu'il existe est consumée dans les problèmes tels qu'ils existent. Qu'en pensent les spécialistes des droits ? Certains droits assument un caractère général et universel, comme le suffrage universel. Le suffrage universel existe au Canada. Tous ceux qui ont dix-huit ans révolus ont le droit légal d'élire et d'être élu. Or il existe un mécontentement collectif devant l'incapacité de l'ensemble des citoyens de jouir de ce droit. L'électorat ne jouit pas des fruits de ce suffrage universel autant que ceux qui jouissent du droit d'être élus, surtout s'ils appartiennent à l'exécutif. L'électorat a-t-il le droit de changer les mécanismes qui donnent aux élus le mandat de faire ce qu'ils veulent ? Le gouvernement a-t-il le droit de retirer ou d'accorder ce droit à l'électorat ? Tels sont les problèmes tels qu'ils existent. Et il y en a beaucoup d'autres. Dans ces conditions, comment les droits sont-ils définis ? Il doit y avoir une définition moderne, puisque les conditions qui existent aujourd'hui au pays et à l'échelle internationale ne sont pas les mêmes qu'avant. En général on peut dire que ce sont les conditions de la concentration à outrance du capital et de la production. Il existe un déploiement massif des forces productives qui, une fois orientées, peut donner des résultats qu'on n'aurait jamais pu s'imaginer auparavant. L'exploration de l'espace en est un exemple. Des exemples semblables peuvent être tirés de toutes les facettes de la vie.
Les solutions s'offrent lorsqu'on s'efforce de
|