|
|
Numéro 26 - 30 juin 2018 Supplément Conférence à
Montréal à l'occasion
La
conception
des
droits
dans les constitutions du Canada de 1840 à
1867 La conception des droits dans les constitutions du Canada de 1840 à 1867 Conférence à Montréal à
l'occasion du 180e anniversaire des rébellions
de 1837-1838
|
|
|
Nous ne venons pas à cette conférence en tant qu'historiens, ce que nous ne prétendons pas être, bien qu'il y ait des historiens parmi nous. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas notre propre historiographie. Nous avons notre historiographie et elle est partisane. Nous regardons l'histoire à partir du présent, nous allons dans le passé pour pouvoir mieux préparer un avenir pour tous. En partant du présent, en partant de ce qui se révèle en ce moment et de ce que le présent demande, nous retournons dans le passé seulement pour enrichir la révélation du présent et pour être mieux en mesure de nous attaquer au présent.
Tout le monde est invité à contribuer à cette discussion mais soyons clairs sur une chose : le but de la discussion n'est pas de donner une autre interprétation de telle ou telle notion, telle ou telle période de la préhistoire de la société humaine. Le but de la discussion est de contribuer au développement de la théorie politique moderne, surtout la théorie politique moderne qui est basée sur notre propre pensée, celle que nous créons nous-mêmes.
Nous entendons souvent dire que l'histoire a un préjugé de genre ou de race, qu'elle établit une supériorité culturelle ou qu'il y a l'histoire noire, l'histoire autochtone, etc. À l'occasion du 150e anniversaire du Canada, il y a une autre interprétation qui vient sous les thèmes de « L'Autre 150 ».
En ce qui concerne l'histoire basée sur le genre, il est vrai que les femmes et les hommes jouent un rôle différent dans toutes les sociétés, dans les sociétés de classes comme dans les sociétés sans classes. Cela est dû à leurs rôles objectivement différents dans la production et la reproduction de la vie. Par contre, le rapport entre les hommes et les femmes, les rôles qu'ils jouent dans la vie sociale, n'ont pas d'incidence sur la théorie politique appliquée. Ces rapports sont le produit d'autre chose. La politique est l'expression concentrée de l'économie, mais la théorie politique, si elle veut être fidèle à elle-même, ne se préoccupe pas de la différence des rôles entre hommes et femmes. On peut dire que la théorie politique est aveugle au genre. Elle est aussi aveugle à la couleur de la peau et aveugle à l'origine ethnique, à la langue, à la religion, à la richesse et aux capacités.
 La théorie politique
fait partie de la superstructure d'une base
économique donnée. Avant l'apparition de la
société de classes, le
processus de production était
social et l'expropriation de la production était sociale
également.
Cette base économique est par la suite niée et s'ensuit
la société de
classes. La théorie politique est liée à la forme
du processus de
production et à la forme de la propriété des
moyens de production.
La théorie politique
fait partie de la superstructure d'une base
économique donnée. Avant l'apparition de la
société de classes, le
processus de production était
social et l'expropriation de la production était sociale
également.
Cette base économique est par la suite niée et s'ensuit
la société de
classes. La théorie politique est liée à la forme
du processus de
production et à la forme de la propriété des
moyens de production.
L'oppression des femmes commence avec l'apparition de la société de classes, en même temps que l'exploitation de l'être humain par l'être humain. Parmi les exploités il y a des hommes et des femmes, bien que l'exploitation des femmes soit pire puisqu'elles subissent aussi la discrimination du fait qu'elles sont femmes. La théorie politique ne reconnaît que les rapports que les êtres humains établissent entre eux, lesquels rapports déterminent le caractère de la société à chaque période donnée.
On dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et c'est vrai. Beaucoup de facteurs ont contribué à l'interprétation des différents événements historiques, y compris le préjugé et le parti pris, même les nôtres. Mais le préjugé et le parti pris ne sont pas la même chose. Si l'on examine le problème du point de vue du but visé, il est possible de comprendre les différentes interprétations basées sur le préjugé. Notre fidélité est envers une cause qui favorise ceux qui veulent investir le peuple du pouvoir souverain afin d'ouvrir la voie au progrès de la société. C'est un parti pris envers une cause précise.
Par exemple, les Britanniques voyaient les choses par le prisme de leur pouvoir d'État et de leur but visé, qui était de maintenir ce pouvoir. Ils ont déclaré qu'au Canada il y avait deux factions en guerre l'une contre l'autre, deux supposées « races », les Anglais et les Français, et que les institutions britanniques favorisaient l'unité des factions en guerre. À ce jour, la politique basée sur l'identité vise une seule et même chose : diviser le peuple et l'empêcher d'acquérir une conception du monde qui lui sert à s'orienter et à intervenir de manière à résoudre les crises en sa faveur.
On ne peut pas parler des événements de 1837-1838 sans parler du pouvoir d'État, et lorsque nous parlons du pouvoir d'État, nous devons reconnaître que l'État sert à priver le peuple d'une conception du monde. C'est ce qu'ont fait les Britanniques lorsqu'ils ont supprimé la République du Québec naissante en 1837-1838, ce qui a mené à l' Acte d'Union adopté par le parlement britannique en 1840 et proclamé au Canada en 1841. L' Acte d'Union a donné une importante partie du territoire et de la population du Bas-Canada au Haut-Canada et leur a accordé tous deux une représentation égale à l'Assemblée législative du Canada Uni. (Le Bas-Canada avait une population de 650 000 habitants et le Haut-Canada seulement 400 000.) Il fusionnait aussi leur dette, de sorte que le Bas-Canada, qui avait une dette d'à peine 370 000 $, devait maintenant accepter la moitié de l'énorme dette de 5 millions $ que le Haut-Canada venait de contracter dans son projet d'empire. C'est ainsi qu'ils ont créé un « équilibre » entre deux soi-disant factions en guerre. Cet « équilibre » n'a pas créé l'harmonie, puisqu'il n'y avait aucune équivalence malgré la redistribution brutale du territoire, de la population et de la dette. L'Assemblée a été paralysée en conséquence et c'est ce qui a mené à la proclamation royale de 1867. L'important à retenir est que le pouvoir d'État privait ainsi le peuple d'une perspective favorable et ce blocage est demeuré depuis. Les efforts d'organisation du peuple continuent d'être sapés par les institutions dites démocratiques qui sont issues de cet arrangement.
 L'assemblée des Six Comtés les 23
et 24 octobre 1837 a réuni
quelque 6000 patriotes à Saint-Charles, dans le
Bas-Canada, en défi à
la proclamation interdisant les assemblées publiques.
L'assemblée des Six Comtés les 23
et 24 octobre 1837 a réuni
quelque 6000 patriotes à Saint-Charles, dans le
Bas-Canada, en défi à
la proclamation interdisant les assemblées publiques.
Le blocage qui empêche de reconnaître et de défendre les intérêts généraux, c'est-à-dire l'ensemble des rapports sociaux, touche tout le peuple et l'ensemble des collectifs et touche toutes les sphères d'activité. Cela comprend tous les rapports entre les humains. Non seulement les rapports, mais aussi les règles et les objectifs qui régissent ces rapports et donc toutes les questions relatives à la guerre et à la paix, à la pauvreté, à l'environnement, etc.
Il est important de reconnaître que selon la bourgeoisie, les institutions qui ont vu le jour aux XIXe et XXe siècles n'ont pas besoin d'être renouvelées pour affirmer les droits aujourd'hui. Elle ne voit pas la nécessité de créer de nouvelles formes de pouvoir parce que le contenu qu'elle défend, les droits basés sur le privilège, demeure le même. En 1837-1838, les Britanniques ont réprimé la forme républicaine préconisée par les Patriotes du Bas-Canada, qui était révolutionnaire à l'époque, pour s'assurer que le contenu républicain ne voit pas le jour. La leçon que nous tirons de ces événements est que sans défendre la forme révolutionnaire, on ne peut pas défendre le contenu révolutionnaire. Cela touche au coeur du problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui.
Lénine, le grand dirigeant de la classe ouvrière de Russie, a expliqué l'existence d'une lutte entre le contenu et la forme et souligné que le rejet de la forme mène au remaniement du contenu. La république naissante de la nation du Québec a été écrasée par les Britanniques et leurs pouvoirs de police ont établi ce qu'on appelle les institutions et traditions démocratiques du Canada. Il est impossible de concevoir que ces mêmes institutions et leurs fondements idéologiques et la conception du monde des propriétaires de la propriété privé centrée sur la préservation de leur pouvoir puissent servir à résoudre les problèmes d'aujourd'hui.
Les choses et les phénomènes se révèlent. Que révèlent les choses et les phénomènes sur la scène politique aujourd'hui ? N'indiquent-ils pas un besoin de moderniser la théorie politique ? Cette modernisation ne se fait pas en regardant le passé. Elle doit partir du présent. La discussion doit se concentrer sur ce que révèle la situation présente et examiner le passé sous cet angle. En commençant par le présent, c'est-à-dire en commençant par ce que le présent révèle et exige, nous regardons le passé seulement pour enrichir la révélation du présent et pour être mieux en mesure de nous attaquer à la situation actuelle. L'ensemble de toutes les révélations donnera un aperçu de ce qu'une chose ou un phénomène révèle dans les conditions et circonstances données. C'est pour cela que la conscience humaine est relative. La connaissance, pour être utile à l'être humain, doit comprendre toutes les choses et tous les phénomènes que le monde révèle. Elle doit être basée sur l'expérience de tout ce qui existe en ce moment.
La tâche à laquelle nous sommes confrontés, la tâche de moderniser la théorie politique canadienne et québécoise, n'est pas une tâche universelle ; elle appartient aux Québécois et aux Canadiens qui sont engagés dans la lutte pour créer une société moderne sans exploitation de l'être humain par l'être humain et s'unir à tous ceux et celles qui font de même ailleurs dans le monde. Partout dans le monde, les peuples y contribuent en développant leur propre philosophie et théorie politique, suivant leurs conditions. En dernière analyse, il y a une seule théorie, c'est la théorie du matérialisme dialectique et historique. Si tous s'attaquent à leur situation sur cette base, ils mettront à profit l'énergie colossale inhérente à cette théorie pour la modernisation de leur société et leur propre modernisation en tant que peuples et êtres humains. Nous ferons nous aussi notre contribution à cette théorie.
Nous désirons exprimer notre confiance dans notre succès parce que nous avons une riche histoire qui est basée d'abord sur la vie et sur les luttes à finir des peuples autochtones pour vivre en harmonie avec la nature et résoudre les problèmes des rapports entre humains. La Confédération haudenosaunee s'est guidée sur la Grande Loi de la Paix et les autres peuples autochtones avaient des guides semblables avant la Conquête. Nous avons les luttes des premiers voyageurs, des colons et des métis, lorsque les lois coloniales définissaient les règles et les actes de génocide et que les droits étaient définis suivant les définitions coloniales. Et nous avons toutes les manifestations des luttes du peuple pour s'investir du pouvoir de décider pendant 500 années de contact européen.
Ajoutons à cette histoire le fait que nous-mêmes sommes les filles et les fils et les représentants d'une classe ouvrière et d'un peuple instruits et combattants, doués d'un profond sens de justice, de démocratie, de paix et de liberté. Avec tous ces éléments en notre faveur, nous ne pouvons que réussir !
Le besoin d'institutions modernes basées sur la défense des droits de tous et toutes
Introduction
On mentionne souvent cette idée que Karl Marx a empruntée de Hegel selon laquelle tous les événements et personnages historiques se répètent deux fois. Marx précisait : « La première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. »

Au Québec, la tragédie de l' Acte d'Union de 1841 basé sur les conclusions du rapport Durham qui divisait le peuple entre « Canadiens-français » et « canadiens-anglais » se répète et prend différentes formes. La farce de la division du peuple sur une base linguistique et ethnoculturelle a assez duré !
Tragédie ou farce, la crise existentielle que vit le Canada est insurmontable tant que nous gardons la forme de l'État anglo-canadien aujourd'hui sous la mainmise des oligopoles au service de l'impérialisme américain. La cause de cette crise est que les gouvernants britanniques qui ont fondé le Canada par une proclamation royale en 1867 ont investi la Couronne de la souveraineté, dont les représentants détiennent les pouvoirs de prérogative, et depuis le peuple n'a jamais été capable de s'investir lui-même du pouvoir souverain. Aujourd'hui la souveraineté demeure entre les mains de la Couronne, à la disposition de grands oligopoles. Tous les aspects de la vie ont été soumis à des intérêts supranationaux en faveur d'oligopoles. Cela comprend tout depuis la privatisation des services public aux services privés de sécurité et du renseignement. C'est la même chose pour la nation du Québec que les Britanniques ont réprimée par la force comme condition pour imposer leurs institutions dites de démocratie de gouvernement autonome. Cet État anglo-canadien est aujourd'hui l'expression de la vieille politique pourrie de diviser le peuple pour le maintenir à l'écart du pouvoir souverain. Il empêche l'édification d'un État moderne et souverain basé sur la reconnaissance des droits. Il faut en finir avec l'historiographie qui divise le peuple et maintient le statu quo, qui nous plonge dans des crises de plus en plus profondes accompagnées d'un danger croissant de guerre mondiale.
Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 180e anniversaire des rébellions dans le Haut-Canada et le Bas-Canada, le renouvellement des institutions et du processus politique est bloqué peu importe quel parti politique est au pouvoir. Du « fédéralisme d'ouverture » au fédéralisme de coopération, de la profession de foi libérale à la défense du multiculturalisme à l'adoption par la Chambre des communes d'une motion professant une nation ethnoculturelle du Québec ainsi que les notions de « L'Autre 150 » qui veut des valeurs « canadiennes françaises » plutôt que des valeurs « canadiennes anglaises ». (Cette notion de « L'Autre 150 » laisse entendre que les Canadiens ont peut-être raison de célébrer, « mais pas nous ». Autrement dit, pas de problème avec la constitution canadienne et la couronne, sauf que le Québec en veut une pareille, sinon une pareille à celle de la France en crise !)

Carte des frontières du Haut-Canada et du Bas-Canada en 1840
De la prétention des conservateurs de Harper, avant l'actuel gouvernement libéral, de vouloir « en finir avec les vieilles querelles constitutionnelles », à la prétention de Justin Trudeau que le problème n'existe pas (alors que son gouvernement insiste pour que le Canada soit intervenant dans la poursuite en justice contre la Loi 99 de l'Assemblée nationale, qui déclare que seul le Québec peut décider de la question à poser dans un référendum)[1] jusqu'à, finalement, la renonciation de sa promesse de réformer le système électoral, le blocage se poursuit. Il est clair que l'État anglo-canadien et ses représentants ne veulent pas d'une constitution qui reconnaît le droit du Québec à l'autodétermination et qui redéfinit le partage des pouvoirs et les droits de tous sur une base moderne.
Cette subversion et ce blocage comprennent aussi l'adoption d'une politique d'intégration des immigrants qui viole le droit de conscience en imposant un serment d'allégeance à des « valeurs », qu'elles soient « canadiennes » ou « québécoises ». Cette politique n'a pas été introduite au Québec par un gouvernement dit nationaliste ou xénophobe, mais bien par le gouvernement libéral de Jean Charest. Sa réponse au rapport de la Commission Bouchard-Taylor fut de reprendre le slogan des accommodements raisonnables des bâtisseurs d'empire à l'époque de la conquête, puis à l'époque de la Rébellion et tout au long de la création des institutions dites démocratiques au Québec. Le contenu de cette politique a toujours été d'accommoder tous ceux qui s'opposent à la prise du pouvoir par le peuple. Voilà la vraie origine des accommodements raisonnables et voilà l'histoire des institutions démocratiques du Québec qui sont le blocage, le refus de répondre aux besoins réels de la société sur la base d'une définition moderne des droits. Cette politique est tout à fait impuissante à développer l'unité fraternelle du peuple, qui est une condition nécessaire au progrès de la société.
Cette subversion a son écho chez les partis politiques au pouvoir et dans l'opposition au Québec qui font de la langue, des « accommodements raisonnables », de la « diversité ethno-culturelle » et des « valeurs québécoises » des sujets de débat perpétuel et passionnel pendant que le peuple est dépourvu des moyens d'aborder ces problèmes lui-même et de leur trouver des solutions modernes. Au nom d'une crise identitaire, tout est promu sauf un projet d'édification nationale à l'image et avec les objectifs de la classe ouvrière, à qui l'histoire a assigné la tâche d'investir le peuple du pouvoir souverain. D'autres forces sont également emportées dans le tourbillon à cause de leur refus de prendre position, leur refus de voir que les partis politiques et le système électoral ne permettent plus au peuple de donner à d'autres un soi-disant mandat de gouverner en son nom. Elles s'illusionnent que les partis au pouvoir peuvent ou veulent régler les problèmes sur une base moderne.
Dans le cours de la lutte à la défense des droits de tous, il est important d'analyser comment le contenu et la forme des institutions dites démocratiques ont été imposés avec l'écrasement de la Rébellion et d'identifier la définition des droits des bâtisseurs d'empire que ces institutions défendent.
Notre enquête nous montre qu'au Canada tout est affaire de soi-disant accommodements raisonnables, plus particulièrement tout est affaire d'accommoder la classe ouvrière à ce que la bourgeoisie considère comme raisonnable et de surmonter les différends entre les factions de la classe dominante et ses agences en s'accommodant elles aussi les unes aux autres. Aujourd'hui, à cause du néolibéralisme et de l'objectif de rendre les monopoles les plus puissants concurrentiels sur les marchés mondiaux, la crise des accommodements raisonnables sert surtout à blâmer le peuple pour tous les problèmes, à l'accuser de racisme, de xénophobie, de favoriser des solutions d'extrême droite, etc.
En étudiant la question, nous nous sommes rendus compte que c'est la vieille politique de diviser pour régner qui est en crise et qu'on nous la sert maintenant dans une nouvelle bouteille, avec une nouvelle étiquette, l'étiquette de l'identité.
La politique identitaire est la politique que les colonialistes et bâtisseurs d'empire britanniques utilisent depuis le XVIIIe siècle pour diviser le peuple, pour semer la haine et les tensions afin de briser l'unité fraternelle du peuple. Cela est fait pour le maintenir à l'écart du pouvoir souverain et bloquer la résolution du problème de la subjugation des peuples autochtones et de la nation du Québec. Au Québec et au Canada, cette politique a depuis pris différentes formes historiques selon les besoins de chaque époque. Elle est au coeur de l'histoire du Canada et de tous les actes constitutionnels, de l' Acte de Québec de 1774 à la Charte Canadienne des droits et libertés de 1982 en passant par l' Acte d'Amérique du Nord Britannique de 1867. C'est la politique réactionnaire qu'on trouve à la base du soi-disant bilinguisme et multiculturalisme du gouvernement de Justin Trudeau avec son slogan « la diversité est notre force ».

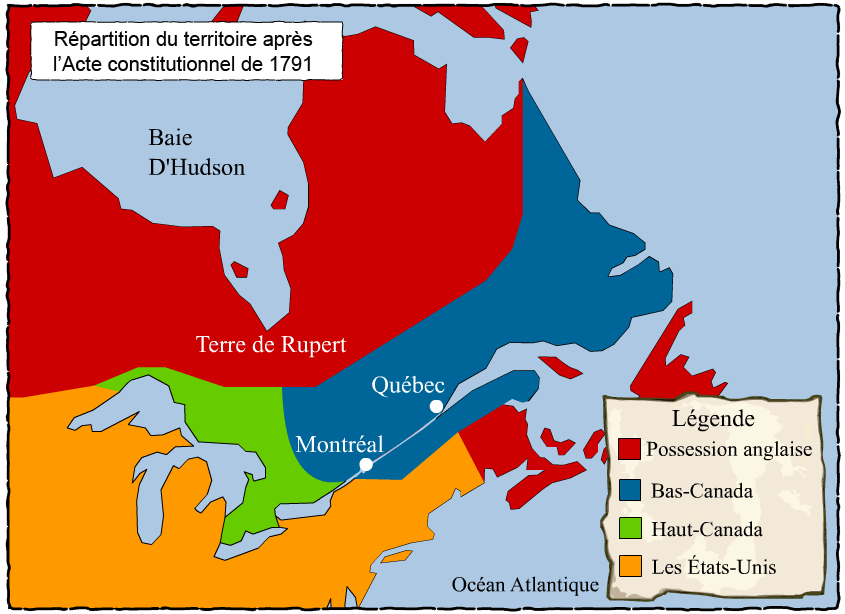
À gauche : territoire de la province de Québec
après l'Acte de Québec
de 1774. À droite : division du territoire
après l'Acte constitutionnel
de 1791. (Cliquer sur l'image
pour agrandir)
Il est essentiel d'aborder cette histoire comme la science l'exige, et comme le matérialisme historique l'enseigne, c'est-à-dire en tant que développement de la lutte de classe à la lumière du besoin historique d'harmoniser l'intérêt individuel avec l'intérêt collectif dans le contexte des intérêts généraux de la société tels que définis par la classe ouvrière et le peuple eux-mêmes. Une première tâche est de reconnaître que c'est seulement en tant que membres du corps politique que tous sont égaux. Il faut se défaire de cette pratique des démocraties dites représentatives dans lesquelles le seul rôle qu'on accorde aux citoyens est de faire une croix sur un bulletin de vote pour remettre leur pouvoir décisionnel à des gens qui gouvernent en leur nom mais qui ne les représentent pas.
Les points saillants de l'histoire constitutionnelle du Canada au cours de laquelle se sont développées et établies les institutions dites démocratiques sont en fait des périodes de haute trahison de la part des élites.
Nous présentons ici un bref survol de certains faits historiques qui permet de voir les formes qu'a prises la politique de diviser pour régner des colonialistes britanniques au Canada et ensuite de l'Église catholique et de toutes les élites, que ce soit celles qui représentent l'État anglo-canadien ou son pendant au Québec.
La définition des droits après la Conquête
Au lendemain de la victoire contre la France en 1763, les Britanniques se rendirent compte qu'en soi la victoire militaire ne suffisait pas. Notons que la révolution américaine avait commencé en 1765, à peine deux ans après l'adoption du Traité de Paris par lequel la France cédait la Nouvelle-France à l'Angleterre. À peine trois mois après la conquête, les soldats de sa Majesté faisaient face à de nouveaux dangers à la frontière américaine — un soulèvement autochtone dirigé par le chef outaouais Pontiac. Les Britanniques se retrouvaient dans une situation où il leur fallait gouverner un territoire récemment conquis alors que la révolte grondait dans leurs colonies plus au sud. Ils avaient besoin d'une population docile au service de leurs intérêts au Québec et à l'étranger dans leur rivalité avec les puissances coloniales européennes.
Les oppresseurs coloniaux adoptèrent une série de mesures qui, plus tard, dans l'empire britannique en Amérique du Nord, allaient être caractérisées comme étant la politique britannique des accommodement raisonnables mais qui était au fond la politique coloniale éprouvée du « divide et impera » (diviser pour régner).
Après avoir joué un rôle de premier plan dans la conquête militaire de la Nouvelle-France, notamment sous les ordres de James Wolf, James Murray fut le premier gouverneur de la Province de Québec après l'administration militaire qui dura jusqu'en 1764. Murray comprenait, mieux que la couronne britannique, la nécessité d'avoir l'appui de certains seigneurs français et du clergé catholique pour pacifier le reste de la population. Parce qu'il fallait mettre la colonie sous contrôle, sa majesté imposa le « serment du test ». Le « serment du test » existait en Angleterre depuis la reine Élisabeth et visait essentiellement l'exclusion des catholiques romains de toutes les charges administratives et judiciaires. Pour le privilège d'accéder à certaines fonctions, on devait renier l'autorité du pape ainsi que certains dogmes romains comme l'Immaculée Conception et la transsubstantiation. Ce n'est que plus tard, à cause de l'instabilité coloniale en Amérique du Nord, à la proclamation de l' Acte de Québec de 1774, que sera aboli le « serment du test » pour les catholiques.
Guy Carleton, deuxième gouverneur de la colonie nouvellement britannique, reconnut également la nécessité de se gagner l'appui des élites seigneuriales et cléricales. Il ordonna qu'on nomme plusieurs de ses représentants au conseil qui servait de gouvernement et que les fils de certains seigneurs soient nommés officiers de l'armée. Pour Carleton, il était nécessaire de prendre ces mesures et d'accommoder les élites francophones, particulièrement le clergé, notamment par l'intégration de cette élite au pouvoir en acceptant la religion catholique, la langue française, et certaines coutumes, car, jugeait-il, « aussi longtemps que les Canadiens seront privés de toute position de confiance et de places profitables, ils ne pourront oublier qu'ils ne sont plus sous la domination de leur souverain naturel ».
La préservation de la langue française, de la religion catholique et du droit civil français ainsi que des droits des seigneurs féodaux était également liée au besoin qu'avaient les Britanniques de restructurer l'économie. Beaucoup de capitalistes, marchands et entrepreneurs français retournèrent en France après la conquête. Une grande partie du clergé catholique quitta également, de même que des administrateurs, des juges, etc. Les Britanniques voulaient que les entrepreneurs et propriétaires fonciers qui étaient restés dans les campagnes se constituent en une nouvelle administration. Un clergé catholique bien implanté qui prêchait l'acceptation du statu quo et qui était étroitement lié à l'aristocratie féodale n'était pas sans utilité pour la classe dominante. Ces couches supérieures de la société québécoise étaient plus qu'heureuses d'accepter l'offre des colonialistes britanniques. C'est ainsi que sont nés les grands « accommodements » entre les élites coloniales britanniques et les élites francophones.
Cette politique prit une forme concrète avec l' Acte de Québec de 1774, sous le règne de Carleton, qui assurait la continuation du clergé catholique, du régime seigneurial, du vieux droit civil français et d'autres coutumes et traditions qui ne posaient pas de menace au pouvoir des conquérants. Cependant, l'Acte de 1774 ne garantissait pas l'établissement d'un gouvernement représentatif ni aucun droit véritable pour le peuple, ce qui allait devenir le cri de ralliement des Patriotes durant la Rébellion de 1837. En échange du droit de préserver leurs coutumes et leur religion, les habitants du Québec devaient prêter le serment d'allégeance à la couronne britannique. Deux colonialistes britanniques, York et Grey, écrivirent, en préparation de cet Acte : « ... les conquérants sages, après s'être assurés de la possession de leur conquête, agissent avec douceur et permettent à leurs sujets conquis de conserver toutes leurs coutumes locales, inoffensives de leur nature. »

Les patriotes dans les tranchées à la bataille de
Saint-Charles le 25 novembre 1837
L'Article V de l'Acte de 1774 accorde aux catholiques le droit de pratiquer leur religion et déclare les pleins droits du clergé. L'Article VI fait de même en ce qui concerne la religion protestante et son clergé. L'Article VII déclare qu'en échange, tout habitant du Québec doit faire le serment suivant :
« Je, A.B, promet sincèrement et affirme par serment, que je serai fidèle, et que je porterai vraie foi et fidélité à Sa Majesté le roi Georges... et que je ferai tous mes efforts pour découvrir et donner connaissance à Sa Majesté... de toutes trahisons, perfides conspirations, et de tous attentats, que je pourrai apprendre se tramer contre lui. »
L'Acte de 1791 maintiendra le même serment pour toute personne désirant être élue à l'Assemblée législative nouvellement créée. Très accommodante, sa Majesté autorise que le serment « soit prêté en anglais ou en français suivant le cas ». Aussi, l'Acte de 1791 assure la protection des titres des propriétés seigneuriaux au Bas-Canada et crée ce que l'on appellera les réserves du clergé dans le Haut-Canada. C'est en effet l'Acte de 1791 qui divisera pour la première fois le Canada entre Haut et Bas Canada. L'objectif est d'ouvrir le territoire aux loyalistes ayant déserté les 13 colonies après la révolution américaine. Mais surtout, l'Acte de 1791 vise à consolider le pouvoir colonial en restructurant l'administration de la colonie. On crée une Assemblée législative élue sans aucun pouvoir réel. On renforce le rôle et le pouvoir du Gouverneur et du Conseil législatif nommé par le gouverneur au détriment de l'Assemblée législative élue dont l'ensemble des lois doit être approuvé par le gouverneur et son conseil.
Ainsi, « la Clique du Château » — une référence au château Saint-Louis, résidence du gouverneur et siège du gouvernement — réunira la bourgeoisie marchande anglaise du Bas-Canada et dominera les affaires politiques, judiciaires et commerciales jusque dans les années 1830, au début du mouvement patriote.
Il est important de noter que les Britanniques ne se sont pas sentis obligés d'abolir le français. C'était en effet une des « coutumes inoffensives » qu'ils permirent à la population de conserver. Par exemple, le Conseil législatif avait le droit de tenir ses délibérations en français, bien que les procès-verbaux fussent rédigés en anglais. Les proclamations et les arrêtés étaient rédigés en anglais et en français. Les Britanniques se satisfaisaient parfaitement d'exercer leur pouvoir dans l'une ou l'autre des deux langues, en autant que leurs fins soient servies. Malgré tout, la question de la langue ne fut pas spécifiquement débattue à l'époque. Elle demeura sans solution. Formée sous les soins des colonialistes britanniques, la nouvelle élite dirigeante du Québec devint vite une partie de la famille royale. La question est que lorsqu'il s'agit de profits, la langue et la religion n'ont plus la même importance. Les classes dominantes dans tous les pays du monde parlent le langage de l'argent, obéissent à la loi de la jungle et ont foi dans le statu quo. Voilà leur seule langue et leur seule religion véritables.
La définition des droits donnée par la lutte des patriotes dans leur projet d'édification nationale

Un officier britannique lit l'ordre d'expulsion après la
défaite de la rébellion des patriotes,
ce à quoi les patriotes répondent le poing levé :
« Trahison ! »
Encore aujourd'hui, les pouvoirs en place et leurs historiens suivent la voie tracée par Lord Durham en réduisant la lutte menée par les Patriotes à un conflit interethnique, entre francophones et anglophones. Ce sont précisément les institutions de la couronne ne répondant pas aux aspirations du peuple et aux exigences de l'époque que refusèrent les Patriotes.
Voici une citation du fameux Rapport Durham qui déclarait, après l'écrasement sanglant de la rébellion des Patriotes de 1837-38 contre le pouvoir de la couronne britannique dans le Haut-Canada et le Bas-Canada, que c'était une affaire de « races » :
« Je m'attendais à trouver un conflit entre un gouvernement et un peuple ; je trouvai deux nations en guerre au sein d'un même État : je trouvai une lutte, non de principes, mais de races. Je m'en aperçus : il serait vain de vouloir améliorer les lois et les institutions avant que d'avoir réussi à exterminer la haine mortelle qui maintenant divise les habitants du Bas-Canada en deux groupes hostiles : Français et Anglais. »
Il n'en demeure pas moins que deux choses ressortent de l'étude de cette période de l'histoire. Premièrement, il est frappant de voir comment les Patriotes ont su identifier le blocage par les formes sociales de l'époque et avancer un projet d'édification nationale basé sur les idéaux les plus avancés de l'époque et répondant aux problèmes tels qu'ils se posaient alors. Deuxièmement, on remarque qu'aujourd'hui, les formes sociales et les institutions dites démocratiques qui bloquent l'avancement de la société sont celles directement héritées de ces bâtisseurs d'empires qui ont combattu les Patriotes et qui ont construit le Canada en niant la nation québécoise — et toutes les nations autochtones — et en attisant le racisme et en créant la division.
Les Patriotes ont su identifier le blocage par les formes sociales de l'époque. Il s'agissait essentiellement de vaincre le colonialisme et d'abolir le système seigneurial pour construire sur ces ruines une république répondant aux aspirations de l'époque. Les Patriotes d'ici, comme partout dans les Amériques au XIXe siècle, étaient des républicains qui se battaient contre un régime colonial. Cela se voit dans les 92 résolutions de 1834 qui affirmaient, entre autres, que le but était de créer les arrangements conformes aux intérêts de chaque habitant « sans distinction d'origine ni de croyance ». On le voit également dans toutes les résolutions adoptées lors de la vague d'assemblées publiques de l'été 1837 et dans la Déclaration d'indépendance de la République du Bas-Canada proclamée à l'hiver de 1838.
Ainsi, au coeur de cette grande expression de la volonté populaire, les Patriotes proclamèrent « par ordre du gouvernement provisoire » un important manifeste appelé « Déclaration d'indépendance de la République du Bas-Canada ». Ils y énoncèrent les principes et les droits démocratiques propres à une république. L'article 3 appelle à la défense des droits de tous : « 3. Que sous le gouvernement libre du Bas-Canada, tous les individus jouiront des mêmes droits : les sauvages ne seront plus soumis à aucune disqualification civile, mais jouiront des mêmes droits que tous les autres citoyens du Bas-Canada. » L'article 15 proclame que c'est le peuple qui rédigera sa constitution : « Que dans le plus court délai possible, le peuple choisisse des délégués, suivant la présente division du pays en comtés, villes et bourgs, lesquels formeront une convention ou corps législatif pour formuler une constitution suivant les besoins du pays, conforme aux dispositions de cette déclaration, sujette à être modifiée suivant la volonté du peuple. »
Cette lutte n'avait rien
d'une lutte interethnique. On le voit dans les
symboles patriotes, le drapeau patriote symbolisant l'unité du
peuple
du Bas-Canada. On le voit aussi dans différentes batailles
menées par
le parti patriote qui, par exemple, s'était porté
à la défense de la
pleine reconnaissance des droits civiques de la communauté juive
du
Bas-Canada. En 1807, Ezekiel Hart, un juif élu dans la
circonscription
francophone de Trois-Rivières, s'est fait refuser son
siège à
l'Assemblée législative. Le tout se termina en 1832
par l'adoption d'un
projet de loi déposé par John Nielson du parti patriote
qui abolissait
toute discrimination, en termes de droits civiques, à l'endroit
des
juifs.
La haine du peuple du Bas-Canada n'était pas dirigée contre les Canadiens anglophones ni contre le peuple britannique. Au contraire, le peuple du Bas-Canada et le peuple anglais partageaient une haine des impérialistes et des exploiteurs britanniques. Les échanges entre les organisations ouvrières londoniennes et les comités patriotes en témoignent. Après avoir tenu une assemblée de protestation contre les résolutions Russell et avoir soumis à la Chambre des communes une pétition soutenant les revendications des Canadiens, la London Workingmen's Association fondée par Karl Marx et Friedrich Engels avait envoyé un message au Comité central des Patriotes dans lequel on peut lire : « Puissiez-vous voir le soleil de l'indépendance luire sur vos cités croissantes, sur vos foyers joyeux, vos épaisses forêts et vos lacs glacés ! » Le Comité central des Patriotes répond en disant : « Nous n'avons aucune querelle avec le peuple d'Angleterre. Nous faisons la guerre uniquement aux agressions d'oppresseurs tyranniques qui vous oppriment aussi bien que nous. »
Il est même tout à fait anachronique de parler de lutte entre Canadiens-français et Canadiens-anglais, puisqu'à l'époque, tous étaient Canadiens tout court ! Un porte-parole patriote s'expliquait ainsi lors de sa comparution devant un comité de la Chambre des Communes : « Dans les documents écrits, tous sont appelés Canadiens qui sont du côté du Canada, et tous sont appelés non Canadiens qui sont contre le peuple canadien. » La division entre Canadiens-français et Canadiens-anglais est une invention des colonialistes exploiteurs et sert leur politique de diviser pour régner.
Les Britanniques continuèrent malgré tout, avec Lord Durham, de dire que 1837-38 était une lutte des francophones contre les anglophones. Cette caractérisation perpétue la politique de diviser pour régner des bâtisseurs d'empire du XIXe siècle et sert à détourner l'attention du coeur du problème. Comme aujourd'hui, le coeur du problème était les institutions dites démocratiques désuètes et le blocage par les formes sociales. Plutôt que de répondre aux exigences de l'époque et de renouveler ces institutions, les colonialistes se sont accrochés au statu quo en réprimant dans le sang la révolte de 1837-38. La Rébellion fut écrasée par la force des armes, avec la suspension des libertés civiles, des arrestations massives, l'incendie de demeures, la pendaison de 12 patriotes et l'exil forcé de 64 autres. Plus de 1 700 personnes furent jetées en prison. Rien qu'à Montréal, 816 personnes furent arrêtées en 1838, sur une population de 30 000 personnes. Par rapport à la population de Montréal aujourd'hui, ce serait l'équivalent de 40 000 personnes. De ce nombre, 108 furent traduits en cour martiale. C'est sans compter les centaines qui durent fuir aux États-Unis pour éviter la persécution, y compris dix accusés de « meurtre » qui faisaient face à la peine de mort s'ils revenaient au pays. Et tout cela sans parler des villages de la vallée du Richelieu qui ont été rasés, complètement brûlés. Ces événements marquèrent la suppression de la nation naissante du Québec dont l'existence continue d'être niée à ce jour en la privant de son droit à l'autodétermination en tant qu'entité légale indépendante, libre de former une union avec le reste du Canada si tel est son désir.
Les définitions des droits dans l'Acte d'Union de 1840
La réponse aux aspirations démocratiques des peuples du Haut-Canada et du Bas-Canada exprimées en 1837-38, après leur répression militaire et la pendaison des patriotes qui ont refusé de s'accommoder aux institutions britanniques, fut de dépêcher Lord Durham au Canada pour étudier la situation et faire ses recommandations à Londres. On a fait de Durham un symbole de la volonté d'assimiler les francophones. L'ensemble de son rapport est effectivement rempli de passages haineux à l'égard des habitants du Bas-Canada parlant français. Mais l'esprit du rapport traduit plutôt un profond chauvinisme et un mépris impérial pour tout ce qui n'est pas britannique ou au service des intérêts fonciers et commerciaux britanniques. Au-delà de ce racisme patent, il y a une volonté de faire de la jeune nation une colonie véritablement britannique, de langue anglaise certes, mais de culture britannique surtout, c'est-à-dire conforme aux institutions britanniques. C'était pour assurer la stabilité pour leurs intérêts financiers.
Le passage suivant met en lumière les véritables motivations de la politique de Durham qui n'est pas tant une question de faire disparaître une langue qu'une affaire de domination et de maintien du pouvoir colonial :
« En vérité, je serais étonné si, dans les circonstances, les plus réfléchis des Canadiens français entretenaient à présent l'espoir de conserver leur nationalité. Quelques efforts qu'ils fassent, il est évident que l'assimilation aux usages anglais a déjà commencé. La langue anglaise gagne du terrain comme la langue des riches et de ceux qui distribuent les emplois aux travailleurs. [...] Il s'écoulera beaucoup de temps, bien entendu, avant que le changement de langage s'étende à tout le peuple. [...] Mais je répète qu'il faudrait commencer par changer tout de suite le caractère de la province, et poursuivre cette fin avec vigueur, mais non sans prudence que le premier objectif du plan quelconque qui sera adopté pour le gouvernement futur du Bas-Canada devrait être d'en faire une province anglaise ; et à cet effet que la suprématie ne soit jamais placée dans d'autres mains que celles des Anglais. [...] Dans l'état où j'ai décrit la mentalité de la population canadienne-française, non seulement comme elle est aujourd'hui, mais pour longtemps à venir, ce ne serait de fait que faciliter un soulèvement que de lui confier toute autorité dans la province. Le Bas-Canada, maintenant et toujours, doit être gouverné par la population anglaise. Ainsi, la politique que les exigences de l'heure nous obligent à appliquer est d'accord avec celle que suggère une perspective du progrès éventuel et durable de la province. »
Il n'y a pas plus clair : pour assurer le « progrès éventuel et durable de la province », il faut empêcher que soit « confiée toute autorité dans la province » à sa « population ».
C'est dans cet esprit, et selon les recommandations de Durham, que fut adopté l' Acte d'Union de 1841 à l'occasion duquel on donna une partie du territoire du Québec à l'Ontario et une partie de la dette de l'Ontario au Québec ! C'est chez Lord Durham et dans l' Acte d'Union que l'on trouve les germes de la division du peuple sur une base ethnoculturelle.
L'évolution de la définition des droits dans la période 1841-1867
La période 1841-1867 est très intéressante : on nous la présente comme étant une période de grande victoire pour la démocratie au Canada. C'est effectivement une période très importante d'implantation des institutions que l'on dit démocratiques, mais en même temps, c'est en fait une période de haute trahison et de capitulation. Tous les hauts faits de l'implantation de ce qu'on présente comme étant la démocratie canadienne sont en fait des hauts faits de la trahison nationale de la part des élites du Québec. C'est pour cela que les institutions dites démocratiques sont des accommodements raisonnables qu'on a institués sur la base de la négation du Québec.
Durant cette période, l'idée du « bon sujet » était mise de l'avant par les élites accommodées. Le bon sujet est celui qui est en marge de la conduite des affaires politiques, celui qui s'en remet à la monarchie pour se faire guider et qui s'accommode des institutions dites démocratique de l'Empire.
Toute cette idée de bon sujet est énoncée par Papineau lors du débat sur le rappel de l'Union en 1849. Ce dernier affirme que les Canadiens-français sont tranquilles et loyaux à la couronne et que sur cette base l'Union est un désaveu envers les libertés des francophones. Cette idée est reprise plus tard par George-Étienne Cartier qui, d'une part, défend le huis clos des conférences sur le projet de Confédération et, d'autre part, estime que le bon sujet s'en remet à la volonté des parlementaires. Les « Canadiens-français » sont de bons sujets selon Cartier puisqu'ils ont permis de développer les institutions britanniques en Amérique.
Parmi ces élites accommodées, le représentant le plus illustre est sans doute Louis-Hippolyte Lafontaine. Anobli en 1854 pour ses bons services envers la couronne, ce dernier a été l'un des plus grands capitulards et le principal promoteur de la conciliation avec l'Union de 1840. Lafontaine y voyait même une opportunité, « un beau risque », dira-t-on beaucoup plus tard...
Dans une adresse du 25 août 1840, au lendemain même de l'Union, c'est en ces termes qu'il en parlait aux électeurs de son comté : « Elle [l'Union] est un acte d'injustice et de despotisme, en ce qu'elle nous est imposée sans notre consentement [...]. S'ensuit-il que les représentants du Bas-Canada doivent s'engager d'avance, et sans garantie, à demander le rappel de l'Union ? Non, ils ne doivent pas le faire. »
Dans le même discours, Lafontaine se rallie aux institutions politiques des bâtisseurs d'empire en invoquant la justesse de la solution Durham. Lafontaine rejetait « l'opposition à outrance ». Il disait qu'il valait mieux faire des compromis et accepter de jouer le jeu pour participer au pouvoir. Bref, concilier et abandonner le projet d'édification nationale sur une base républicaine en échange de miettes d'influence en soumission à la couronne britannnique. C'est ainsi qu'en 1842, Lafontaine acceptait de participer au gouvernement et à l'administration de la colonie de sa majesté. Il déclarait fièrement : « Oui, sans notre coopération active, sans notre participation au pouvoir, le gouvernement ne peut fonctionner de manière à rétablir la paix et la confiance qui sont essentielles au succès de toute administration. »
En 1849, alors qu'il s'opposait à l'abrogation de l'Union de 1840, il vantait les mérites de sa politique de capitulation et de sa participation au pouvoir colonial : « Mais si vous et moi, M. l'orateur, n'avions pas accepté la part qui nous fut faite en 1842, dans l'administration des affaires du pays, où en seraient aujourd'hui nos compatriotes ? Où en serait notre langue que, contre la foi des traités, un gouverneur avait fait proscrire par une clause de l'acte d'Union ? Cette langue, la langue de nos pères, serait-elle aujourd'hui réhabilitée, comme elle vient de l'être dans la manière la plus solennelle, dans l'enceinte et dans les actes de la Législature ? »
Cette politique de conciliation des Britanniques avec les institutions politiques qui ont pour but de maintenir le peuple à l'écart du pouvoir souverain pèse lourd non seulement sur le Québec mais sur tout le Canada encore aujourd'hui.
Cette politique de conciliation avec les institutions politiques qui ont pour but de maintenir le peuple à l'écart du pouvoir souverain pèse lourd sur le Québec encore aujourd'hui.
Conclusion

La bataille de Saint-Charles le 25 novembre 1837 (tableau de Lord Charles Beauclerk)
La Rébellion de 1837-1838 est un événement important dans l'histoire du Québec et du Canada et il faut en saisir la signification pour comprendre la situation aujourd'hui et ne pas se laisser détourner par le chantage des pouvoirs en place selon qui la souveraineté du Québec équivaut à « la destruction du Canada ». Au contraire, l'établissement de l'État moderne du Québec sur sa propre base demeure nécessaire pour résoudre la crise constitutionnelle en faveur du peuple, car cela mettra fin à l'emprise des institutions établies issues de la répression du projet d'édification nationale des patriotes de 1837-1838. Ce sont les institutions dites démocratiques basées sur les « accommodements raisonnables », les arrangements que les oligarques britanniques ont jugés « raisonnables » pour renforcer la domination coloniale britannique établie après la défaite de la France sur les plaines d'Abraham en 1759 et après que le Québec soit passé de colonie française à colonie anglaise. Le pouvoir britannique a divisé le peuple sur une base ethnoculturelle et enchâssé cette division dans l' Acte d'Union de 1840.
Depuis, la stratégie de diviser pour régner a servi, d'abord à l'État britannique et maintenant à l'État canadien, à imposer le diktat des élites dominantes au peuple du Québec et au peuple du Canada ainsi qu'aux peuples autochtones. Il est clair qu'après la Rébellion de 1837-1838, tous les patriotes qui refusaient de se réconcilier avec ces soi-disant accommodements raisonnables ont été soit pendus, soit exilés et que les institutions démocratiques actuelles du soi-disant gouvernement responsable, sorties de l'infâme Acte d'Union , ont comme but d'écarter le peuple de tout arrangement de partage du pouvoir. La situation actuelle montre que la cause pour laquelle les patriotes ont combattu en 1837-1838 appelle aujourd'hui la classe ouvrière à se constituer en la nation et à investir le peuple du pouvoir souverain de décider de ses affaires politiques, économiques, sociales et culturelles et de celles de la nation.
C'est d'autant plus urgent à l'heure où les gouvernements du Québec et du Canada intensifient la braderie des ressources naturelles et humaines, cherchent à établir de nouveaux arrangements qui facilitent l'intégration politique, économique et militaire du Canada et du Québec à la Forteresse Amérique du Nord et restructurent l'État au service des monopoles les plus puissants dans le cadre de leur quête de domination mondiale. Plus ils refusent de partager le pouvoir, plus ils parlent d'« accommodements raisonnables ».
Le résultat de ces politiques de destruction de la nation est que les élites dominantes ont plongé le Québec et le Canada dans une crise politique et constitutionnelle sans précédent. Leur refus d'ouvrir la voie au progrès de la société se voit dans leurs tentatives croissantes d'imposer la politique de division en fonction de la langue, de l'origine nationale, de la culture, des croyances, de la couleur de la peau, du sexe et autres considérations. Nous assistons quotidiennement aux querelles de factions qui rivalisent pour savoir qui est le meilleur représentant des valeurs du Québec et qui réduisent l'identité du peuple québécois à l'aspect linguistique. Elles divisent le corps politique en fonction de l'appartenance ethnoculturelle pour arriver à imposer un nouvel « accommodement raisonnable » et continuent de nier au peuple son droit d'être et son droit de décider des arrangements dont il a besoin pour s'épanouir.
Devant ces assauts contre la conscience, les travailleurs et le peuple du Québec peuvent ou bien continuer sur la voie tracée par les colonialistes britanniques il y a deux cents ans avec la politique consciente et meurtrière de diviser pour régner perpétuée par les élites au nom de « la force dans la diversité », ou bien trouver les moyens de mettre fin à cette situation et de bâtir l'unité fraternelle des peuples sur la base de la reconnaissance et de la défense des droits de tous. Seule la classe ouvrière peut parvenir à résoudre cette question par la voie du renouveau et du progrès contre la subversion et le blocage du renouvellement des institutions promus par les cercles dominants.
L'incitation aux passions sur la question de la langue, des différences ethnoculturelles et des valeurs ne vise pas le renouveau démocratique, elle fait partie de la vieille stratégie britannique de diviser pour régner. C'est la stratégie qui est à la base des institutions dites démocratiques qui privent toujours le peuple de son droit de se gouverner. Alors la tâche de la classe ouvrière et du peuple du Québec et du Canada est de briser toute tentative de prétendu « consensus social » de diviser le peuple sur des bases racistes. Le renouveau démocratique est la solution à ce problème qui dure depuis deux cents ans, soit la subjugation de la nation du Québec par les institutions dites démocratiques qui privent le peuple du pouvoir souverain.
À propos de Joseph Montferrand
|
|
Le Collectif Jos Montferrand, basé en Outaouais, prend son nom de Joseph Montferrand (1802-1864) qui a travaillé comme draveur et bûcheron dans le Haut-Canada et le Bas-Canada, surtout dans la vallée de l'Outaouais. Aussi appelé Joe Mufferaw, il est considéré comme un héros des travailleurs par sa force et son courage légendaires, surtout en opposition au traitement brutal des travailleurs canadiens par les employeurs britanniques. Ses exploits ont lieu en grande partie durant la période précédant la Rébellion de 1837-1838, durant ces années de protestations où l'insurrection grondait.
Selon les récits que les gens en ont fait, il est devenu célèbre à l'âge de 16 ans, en 1818, alors qu'il mesurait déjà six pieds quatre pouces. À l'époque, la marine britannique organisait des tournois de boxe sur ses navires de guerre dans différents coins du monde et déclarait un « champion mondial de la boxe ». Au Canada, les soldats sur les navires britanniques dans le port de Montréal raillaient et provoquaient la foule de Canadiens rassemblés, ridiculisaient leur impuissance devant leur « Champion mondial de la boxe ». Cette année-là, le jeune Jos Montferrand releva le défi. Il monta sur le ring et jeta au tapis le « champion du monde » d'un seul coup de poing. Jos fut déclaré « champion du monde » à son tour, avec une bourse en prix, mais il refusa le titre et donna l'argent aux pauvres gens dans le besoin.
Jos Montferant est immortalisé entre autres dans les chansons Johnny Monfarleau de La Bolduc, Jos Montferrand de Gilles Vigneault et Big Joe Muffera w de Stompin' Tom Connors.
Note
1. La loi 99 a été maintenue par une décision de la Cour supérieure du Québec le 19 avril 2018.
Lisez Le
Marxiste-Léniniste
Site web: www.pccml.ca
Courriel: redaction@cpcml.ca










